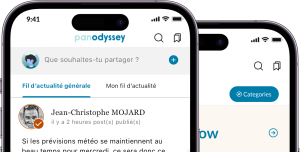Johnny Guitare (Johnny Guitar, Nicholas Ray, 1954)
 4 min
4 min
Johnny Guitare (Johnny Guitar, Nicholas Ray, 1954)

Voilà un western unique en son "genre". Pas seulement parce qu'il inverse les rôles sexués ce qui a valu à son passage le plus célèbre, celui du "remariage" d'être cité aussi bien par André TÉCHINÉ (dans "Barocco") (1976) que par Pedro ALMODÓVAR (dans "Femmes au bord de la crise de nerfs") (1988). Mais aussi parce qu'il transpire l'ambiance de chasse aux sorcières qui régnait alors aux USA, plongés en plein maccarthysme, le western jouant le rôle d'un simple décor en trompe l'oeil pour dissimuler la guerre civile larvée qui se jouait alors dans le pays. Comme le dit le scénariste du film, Philip YORDAN, "Johnny Guitar" est un film d'amour tourné avec des protagonistes qui se haïssaient. Une atmosphère de haine due au moins en partie à la chasse aux communistes qui sévissait alors à Hollywood et qui traversait les membres de l'équipe du film.
"Johnny Guitare" est un film tendu comme un arc, divisé en deux camps ennemis mais où règne à l'intérieur de chacun d'entre eux une atmosphère délétère. Presque tous les personnages ressemblent à des fauves sur le point de sauter à la gorge de leur adversaire (est-ce cette atmosphère de primitive animalité qui explique que dans la scène précédant le lynchage, Joan CRAWFORD se détache sur un décor de caverne?) ce qui rend particulièrement incongrus (et ironiques) les surnoms "Johnny Guitare" (Sterling HAYDEN) et "Dancing Kid" (Scott BRADY) pour qualifier des hommes armés et potentiellement violents. Potentiellement, car si leurs échanges verbaux sont lourds de menaces sous-jacente, ils sont obligés de réfréner leurs ardeurs guerrières sous l'emprise de Vienna (Joan CRAWFORD) la maîtresse-femme qu'ils désirent tous deux mais dont le caractère libre et indépendant attise la rivalité. Vienna est un personnage qui me fait un peu penser à Jackie Brown. Une femme de tête, une meneuse fière, "dure à cuire" qui assume son passé de "femme de mauvaise vie" (aux yeux des hommes) passé qui lui a permis justement de "s'en passer" mais qui souhaite dans son for intérieur s'ouvrir de nouveau aux sentiments. Dans l'autre camp, c'est également une femme qui mène le jeu, la propriétaire terrienne Emma Small (Mercedes McCAMBRIDGE) une furie psychorigide qui a transféré sa frustration sexuelle en folie vengeresse (et meurtrière) et mène en laisse une meute de chiens (les autres éleveurs du coin) qu'elle est prête à lâcher sur son adversaire. De ce point de vue-là encore, la première scène dans le casino-saloon de Vienna est surréaliste avec ces deux femmes opposées (énième variation hystérique de la sainte et de la putain) qui s'affrontent, l'une dominant l'autre (ce qui sera le fil conducteur du film) pendant que les hommes sont relégués dans les coulisses ou dans la position de spectateurs. Des termes qui conviennent bien à la théâtralité d'un film baroque aux couleurs aussi flamboyantes que symboliques (le rouge de la passion et le blanc de la renaissance de la pureté du sentiment pour Vienna, le noir du deuil et de la colère pour Emma) qui est basé sur la parole dans des espaces confinés.









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer





































































































































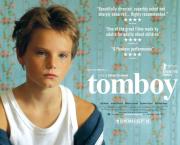















 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur