
11 - La Légende de Nil - Jean-Marc Ferry - Livre I - Les Diamants de Sarel-Jad - Chapitre V, 2
 33 min
33 min
11 - La Légende de Nil - Jean-Marc Ferry - Livre I - Les Diamants de Sarel-Jad - Chapitre V, 2
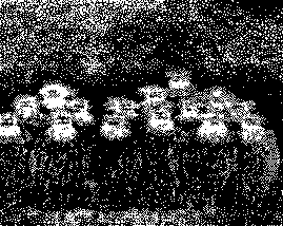
Leur première réunion eut pour objet direct de réaliser une enquête afin de connaître au mieux l’état actuel du problème. Il faut pour cela pouvoir compter sur des personnes réfléchies, ouvertes, capables de bien juger mais aussi de bien communiquer avec quiconque. Les enquêteurs devront nouer des relations dans tous les milieux, s’y insérer même, susciter des confidences et témoignages dont ils auront à tirer des conséquences de grande portée.
De moi, Nil, qui vous conte ma légende, sachez qu’à l’issue de sélections on parvint à retenir seize personnes d’expérience, avisées et de culture profonde. Ils n’auront pas le droit de se concerter entre eux durant toute la période requise pour mener l’enquête puis élaborer un rapport : chacun le sien. Ces rapports, les « Seize » devront les rédiger par écrit et les défendre oralement, le cas échéant, contre des contradicteurs.
Les comptes-rendus des seize « sages » se révélèrent convergents quant au constat des faits et au bilan de la situation. Ils brossèrent de la situation un tableau alarmant. Ils s’étaient pourtant appliqués à l’impartialité. Ils mirent ainsi en exergue des arguments positifs : l’innovation, les complémentarités de savoir-faire, l’enrichissement intellectuel que procurent les échanges, l’apprentissage mutuel d’autres mœurs ou visions du monde, l’élargissement de perspective qui en résulte ainsi que l’assouplissement des seuils de tolérance. Et puis le petit commerce crée des liens sociaux nouveaux. C’est le liant principal, à Syr-Massoug. À défaut de solidarité il invite à une civilité qui s’acquiert au fil des contacts avec des sensibilités étrangères qu’il importe de ne pas heurter. La civilité se marque par des égards, et l’art consiste dans le bon ton, car un excès de manières inquiète et indispose. On apprend ainsi la finesse, l’élégance des expressions, la distinction. Cependant, ces aspects portés à l’actif du bilan n’empêchaient pas que celui-ci fût sombre : l’anonymat domine, les gens dans la masse sont seuls avec eux-mêmes sans le regard des autres, l’esprit de solidarité a déserté la grande Cité et le « chacun pour soi » s’impose comme la maxime dominante.
Au fond, le bilan moral n’eût pas été si négatif, s’il n’y avait eu à déplorer le développement d’une pègre qui pratique le racket, les trafics illicites et même criminels, s’agissant du commerce d’êtres humains et de leur exploitation éhontée. Les enquêteurs soupçonnaient l’existence de réseaux criminels pouvant couvrir les trois espaces : Terres bleues des Nassugs, Terres noires des Aspalans et l’Archipel de Mérode. Ygrem s’en trouva bouleversé dans son cœur, presque désemparé. À l’évidence les mœurs simples ont perdu le pouvoir d’ordonner les relations entre les gens de la capitale. Faut-il alors que des lois aillent prendre la relève d’une moralité défaillante ? Mais, se demanda Ygrem, de quelle utilité peuvent bien être des édictions d’État face à des individus qui ne raisonnent que sur leur intérêt et n’en voient que l’immédiat ? C’est engager un jeu sans fin : traque, d’un côté, triche, de l’autre, un jeu indigne de sa majesté. Il enclencherait une dynamique perverse consacrant le règne de la défiance. Que vaut un pouvoir politique qui s’en remettrait à un ordre juridique lui-même assis sur la méfiance ? Ygrem estimait que répondre aux situations délicates à coup de règlements est une lâcheté. C’est la malhonnêteté de ces faux responsables qui préfèrent ne connaître de la politique que la police. Il fut d’avis que l’on doit certes réprimer les exactions, mais que l’on ne saurait les prévenir par des règlements rusés. La vraie responsabilité politique consisterait plutôt à restaurer les bases de la confiance, les conditions élémentaires d’un vivre-ensemble harmonieux.
Telle est la conviction d’Ygrem, et tel est le problème, à vrai dire, gigantesque, que le roi soumit à ses conseillers ainsi qu’à Ols et Almira qu’il avait conviés. Non, la réponse ne sera pas réactive. Elle ne se limitera pas à la police. La traque réglementaire des exactions anticipées ne mène à rien de solide. Ce qui s’impose à la vraie politique, c’est plutôt une réforme radicale. Telle fut la thèse de départ. Une révolution sociale est appelée par la révolution économique et ses conséquences.
De moi, Nil, qui vous conte ma légende, sachez que Ygrem était trop en prise sur la vie pour concevoir une « révolution » par décrets et ordonnances. Mais ses conseillers croyaient au pouvoir des lois. Le roi les avait préalablement assurés d’une absolue liberté de parole : la délibération ne serait féconde qu’à cette condition. Les conseillers se réjouissaient d’une décision aussi libérale, et ils purent en toute quiétude engager une discussion passionnée sur ce qu’est l’État, ce que sa souveraineté veut dire ; ce que signifie l’institution royale, et ce qui fait sa majesté ; ce qu’est enfin la loi et quels rapports elle entretient avec le droit et la justice. Les Seize étaient présents à la délibération entre les quatre grands conseillers d’Ygrem, mais ils n’intervenaient que s’ils étaient sollicités. Quant à Ols et Almira, ils buvaient les paroles de chacun des Quatre, ainsi que les répliques aux objections profondes d’Ygrem. Tout méritait attention. Le jeune couple eut le sentiment de vivre une expérience unique. C’est pourquoi Ols et Almira suivirent avec une concentration extrême chaque prise de position, chaque interprétation, chaque clarification. Ils comprenaient d’autant mieux les contenus et les enjeux des arguments, que, justement, la confrontation appelle à prendre parti pour ou contre, ce qui oblige à bien suivre sans perdre le fil de la discussion.
Ygrem proposa un premier tour de parole où chacun des Quatre exposerait son point de vue sans être interrompu par les autres. Le premier conseiller défendit ainsi la formation d’un État fort au pouvoir absolu :
— Il n’existe plus de moralité naturelle dans la ville des Nassugs. Mais est-ce encore la ville des Nassugs ? La moralité s’entretenait dans les familles. Mais les familles n’ont plus d’importance. Alors, quel substitut à la moralité, sinon le pouvoir des lois ? Il est vrai que les Nassugs n’ont jamais eu besoin d’autres prescriptions que celles qui vont de soi. Mais ce qui va de soi pour nous n’est pas évident pour tous. C’est pourquoi le respect de la légalité est à inculquer. Les lois doivent s’imposer à tous. Nul ne saurait faire exception pour lui-même. Il faut battre en brèche tout détournement, toute délinquance, y compris les exactions vénielles. Seule l’autorité royale en est capable. Il n’existe pas d’autre puissance publique que l’État politique, et pas d’autre État politique que celui qu’assure le pouvoir du roi. C’est dans le pouvoir royal que doit consister la souveraineté, support de la légalité.
Ygrem ne put s’empêcher d’intervenir pour demander au premier conseiller ce qu’il faut exactement attendre des citoyens. Sur quelle ressource le pouvoir royal pourrait-il reposer, s’il ne jouit pas de la confiance ? Comment la seule force de coercition pourrait-elle assurer cette confiance ?
— Nos enquêteurs vous ont répondu par avance, Sire : de fait la confiance n’existe plus. La méfiance s’est généralisée à Syr-Massoug. Les citadins se méfient les uns des autres. Ils ont désappris la confiance. Cela ne manquerait pas de réagir sur l’autorité royale elle-même. Dans la situation, il nous faut l’admettre, ce n’est plus sur la confiance que l’on doit miser. C’est sur l’obéissance, une obéissance absolue ainsi que doit l’être votre autorité. Tel est le propre de la souveraineté royale. L’obéissance au Souverain est absolue et inconditionnelle. Sans doute, le Monarque doit protection à ses sujets. C’est ce qui le différencie du tyran. Il a des devoirs mais c’est une affaire entre lui et sa conscience. Aucun Contrat ne doit donc soutenir la Souveraineté royale, car celle-ci ne s’exprime que par l’acte unilatéral qu’est la loi. C’est ce qui convient à la Majesté.
Sur un signe d’Ygrem le second conseiller prit la parole. Il s’agitait sur son siège tant il avait hâte de prendre le contrepied de son confrère :
— « Il n’existe plus de moralité dans la ville… ». Voilà le diagnostic. Et quel est le remède ? – Installer un État royal au pouvoir absolu, capable de faire respecter les lois par la contrainte, en imposant une obéissance sans faille ! C’est ce que préconise mon confrère. Or a-t-on songé aux conséquences d’une domination qui détruit l’initiative ? Faut-il, afin de « battre en brèche » la tendance de chacun à s’exempter de la loi commune, abolir toute liberté sociale ? Demandons plutôt ce qui fait qu’en dépit des imperfections et des vices de la ville les gens sont attirés par elle et y demeurent. Il n’y a plus de moralité, dit-on ? Soit ! Mais d’où vient qu’il y ait cependant société ? – Je réponds : c’est l’intérêt commun. Partons donc de ce qui existe plutôt que de ce qui n’est plus. Considérons l’intérêt présent plutôt que la vertu absente. Qu’y manque-t-il pour qu’alors se stabilise un ordre social convenable ? – Il y manque la sécurité des actions et des ententes, la garantie du long terme. Il faut, oui, un gouvernement. Mais plutôt que d’imposer l’obéissance absolue des sujets, faisons confiance aux citadins pour qu’ils comprennent d’eux-mêmes la nécessité de normes communes. Celles-ci doivent être librement consenties. Des voix s’élèvent maintenant pour exiger ordre et sécurité. Pas seulement la sécurité des biens et des personnes ; également celle des accords passés, des prévisions économiques, des placements, des investissements. Telle est la réclamation de nos industriels : ils refuseraient un État autoritaire et, d’ores et déjà, veulent les coudées franches. Alors, encourageons les citadins à se faire citoyens. Ils se donneront le minimum de contrainte nécessaire. En un sens ils se gouverneront eux-mêmes, non pas directement mais par des commis qu’ils auront choisis pour délibérer et former des compromis. Les citadins pourront estimer les résultats, les adopter ou au contraire les rejeter. Cependant, les députés devront régulièrement se présenter devant le Conseil de la ville pour faire leur rapport et entendre les critiques. Si les citoyens n’en sont pas contents, ils les remplaceront. Qu’en pensez-vous ?
Le deuxième conseiller se tourna vers ses deux autres confrères, quêtant une approbation. Mais il ne rencontra que des regards dubitatifs ou carrément incrédules. Le troisième conseiller, dont le tour de parole était venu, le fixa dans les yeux sans agressivité :
— Les hommes ne peuvent se gouverner tout seuls. Les délibérations de représentants ne donneront qu’un champ de foire, une empoignade d’intérêts particuliers dont ne peut sortir aucun bien commun. Il leur faut un maître qui impose un droit rationnel. Le droit doit émaner du Souverain, mais il doit être acceptable pour tous.
À ce moment, le roi, intrigué, intervint pour demander à l’orateur en quoi sa position différait de celle du premier conseiller, à supposer qu’elle en diffère. Le troisième conseiller s’attendait à cette question :
— Le problème est que les maîtres ne sont pas nécessairement moraux. Il est juste de dire que le pouvoir royal diffère de la tyrannie en ce qu’il agit pour le bien commun, non par ambition ou vanité personnelle. Mais qu’est-ce qui dans la pratique nous garantira que celui qui nous gouverne possède les qualités du bon monarque ? La prudence nous invite à poser que ceux qui nous gouvernent sont des hommes comme les autres ; qu’aucun n’est exempt de passions égoïstes. Le maître doit par conséquent être limité dans l’exercice de son pouvoir, de sorte que celui-ci ne sombre pas dans l’arbitraire. En clair : le roi n’est pas au-dessus des lois. Il doit lui-même se soumettre au droit. Quand on dit qu’il devra rendre compte devant le tribunal de sa conscience, on suppose que la moralité ne lui fait pas défaut. Mais pourquoi lui accorder cette vertu que nous refusons au reste des hommes? Non, il n’est pas raisonnable de parier que tout souverain sera assez sage ou vertueux pour se limiter lui-même. Or, voici le fond du problème politique : si les hommes ont besoin de maîtres, ces maîtres sont eux-mêmes des hommes comme les autres. Ils ont par conséquent, eux aussi, besoin de maîtres… Comment résoudre cette aporie ?
Le troisième conseiller voulut marquer une pause, sans doute afin que chacun prenne la mesure de la gravité du problème. Il avait réussi son effet : le roi, les conseillers, les enquêteurs, Almira et Ols, tous étaient maintenant suspendus à ses paroles :
— Sire, chers amis, la résolution de ce problème difficile requiert beaucoup d’attention et de réflexion. L’art politique consiste à contraindre les hommes à se respecter mutuellement en suivant le principe du Droit. Quel est ce principe ? – Le voici : chacun est libre du moment qu’il ne lèse pas la liberté d’autrui. Le principe du Droit n’est autre que la juste liberté. Son acquisition suppose un long apprentissage dont le succès n’est jamais garanti. Elle dépend au départ de la volonté politique, celle d’un maître qui œuvre pour le bien public. Au Souverain incombe ainsi la noble mission d’instaurer le droit, y compris celui qu’il devra lui-même respecter, ce qui revient à limiter son propre pouvoir. Et j’en viens au problème : comment le maître aurait-il intérêt à limiter son propre pouvoir ? Je m’accorde à l’idée qu’il convient de miser sur l’intérêt : le maître doit avoir intérêt à la réalisation d’un droit rationnel, et un droit qui, de plus, soit opposable non seulement aux sociétaires mais au gouvernement. Alors, comment cela est-il possible ?
Les autres conseillers étaient bouche bée à l’écoute du problème que le troisième conseiller osa soulever sur un fond soupçonneux que d’autres qu’Ygrem eussent jugé de la dernière impudence. Mais cette problématisation n’a rien de personnel. Le troisième conseiller ne doutait pas de la bonne volonté de son roi. Il réfléchissait au-delà d’un règne particulier. Ygrem comprit cela. Il réitéra sa disposition bienveillante à recevoir tout propos énoncé dans le souci de la vérité et invita l’orateur à poursuivre.
— Il importe, Sire, de favoriser le développement d’arènes où les citoyens de Syr-Massoug puissent discuter publiquement des choses qui les concernent. Je ne dis pas qu’ils se gouverneront eux-mêmes. À défaut de légiférer ils devraient pouvoir user de leur esprit critique dans un sens constructif. L’expérience qu’ils acquièrent dans la pratique des affaires les autorise à élaborer des propositions au sein des Conseils, des propositions qui peuvent éclairer le Gouvernement. Cependant, la liberté ne s’improvise pas. Elle doit être formée. C’est la fonction de ces arènes, conseils, associations et assemblées : faire éclore chez les citoyens un goût mûr pour la liberté publique. Celle-ci se gagne dans la concertation à propos d’affaires communes. Ainsi les projets deviennent-ils réalisables sans trop rencontrer l’obstacle d’intérêts et de volontés contraires. Le monarque doit, dans une telle liberté, reconnaître son intérêt, qui est celui de la puissance. Il existe un lien entre la liberté et la puissance. La liberté de la société est à l’État un gage de puissance. Voilà le secret. C’est au Souverain qu’il revient de libéraliser sa société, y compris par des voies autoritaires au départ.
Manifestement les deux premiers conseillers ne suivaient plus. Seul le quatrième conseiller semblait d’accord, tandis qu’Ygrem manifestait un intérêt accru. Il voulait savoir quel était ce « lien secret » entre la liberté d’une société et la puissance de son État. C’est ce qu’entreprit d’expliciter le quatrième conseiller :
— Un État est d’autant plus puissant que sa société communique, entreprend librement. Ainsi développe-t-elle ses connaissances. La connaissance est la clé de la puissance. Les Nassugs sont bien placés pour apprécier les développements que notre science a apportés dans nos moyens de production et de protection face aux dangers naturels. J’aimerais concilier les positions de mes deux premiers confrères, bien qu’elles paraissent contradictoires. L’une est autoritaire, tandis que l’autre est libertaire. Mais elles s’accordent quand on inclut le temps. Le souverain, en effet, s’assure d’abord d’une obéissance de ses sujets, et une telle obéissance est inconditionnelle. Ensuite advient la confiance : celle que les sociétaires s’accorderont progressivement les uns aux autres en apprenant à se respecter. De là procédera la confiance envers les institutions et l’État. C’est alors qu’à son tour le souverain pourra leur accorder sa confiance. Il traitera les sujets en citoyens avec la dignité qu’ils méritent. Cela veut dire : libérer la société. Ainsi se conçoit l’avènement d’une société régie par un droit accordant la liberté à ses membres.
Ygrem se tourna vers le troisième conseiller afin de savoir s’il approuvait l’explication. Un signe de tête méditatif donna quitus à l’interprétation proposée. Mais le quatrième conseiller n’aurait-il rien de personnel à proposer ? Partagerait-il sans plus la position qu’il venait d’expliciter ? C’est la question que lui posa le roi. Or, non : si le troisième conseiller avait certes soulevé un problème difficile, la difficulté profonde est ailleurs. C’est ce dont le quatrième conseiller était convaincu :
— Chacun, dit-on, est libre de faire ce que bon lui semble, du moment que l’exercice de sa liberté ne porte pas atteinte à celle des autres. Je ne crois pas qu’il faille s’en tenir à ce principe négatif : c’est insuffisant. Le contenu doit être déterminé par ce que requiert la vie en société, en tenant compte de sa complexité nouvelle. Chaque peuple se forge sa conception de la justice et de la liberté. C’est pourquoi la liberté à instituer ne doit pas être une forme vide. À cette difficulté s’ajoute une autre, plus profonde : un droit politique s’adresse à un peuple, mais un peuple n’existe pas avant sa Constitution politique. Voilà le cercle à prendre en compte pour une révolution véritable. On ne peut restaurer les mœurs simples, mais on peut former une moralité nouvelle, en prise sur la nouvelle réalité.
Une « moralité nouvelle » ! Comment peut-il exister une autre moralité que la moralité naturelle, la moralité ? Cette étrangeté laissa le roi songeur. Il lui semblait que jusqu’alors on n’avait que proposé de remplacer la moralité déficiente par une légalité sous-tendue par la souveraineté. Mais il n’avait pas imaginé une nouvelle moralité, appropriée à la situation de la ville. Le quatrième conseiller veut-il insinuer que la civilité en constituerait le tremplin ? Les rapporteurs ont bien souligné ce fait intéressant : la civilité est une invention citadine. À moins que la ressource ne soit à rechercher dans la suggestion du troisième conseiller : celle d’une publicité des discussions menées entre citoyens intéressés au règlement d’affaires communes… Ygrem entendait saisir concrètement comment on s’y prendrait pour former la base morale du droit. Telle est la question qu’il sollicita auprès du quatrième conseiller.
— L’État doit organiser la liberté contrôlée des affaires, mais la liberté dans la solidarité. Un esprit de corps est requis afin de former cette conscience, que tous dépendent de tous ; que chacun ne peut réaliser son intérêt propre qu’en travaillant à l’intérêt de l’ensemble, non l’inverse (ce disant, il fixa le deuxième conseiller dans les yeux). C’est un apprentissage social. On prend conscience du lien entre l’intérêt commun et l’intérêt propre par le truchement des associations, métiers et corporations. Chacun a besoin de tous, la vie familiale ne crée plus l’illusion d’autosuffisance, tandis que l’existence individuelle dépend désormais clairement de la société entière qui, elle-même, dépend de l’État. Telle est la nouvelle réalité. Elle n’a pas la simplicité de la vie ancestrale. Sa complexité requiert l’État, car seul l’État est en surplomb de la société. Seul il sait ce qu’il en est de l’intérêt général que les citoyens devront apprendre à reconnaître. Les professions et toutes les activités sociales méritent pour cette raison d’être reliées entre elles et à une administration publique composée de personnes compétentes, impartiales et intègres. Ainsi les sociétaires apprendront-ils à collaborer en respectant l’instance qui coordonne les intérêts : l’État.
Moi, Nil, qui vous conte ma légende, je vous invite à imaginer combien la discussion fut animée entre les conseillers. Les enquêteurs prenaient grand intérêt au débat, offrant des précisions et proposant même des rectifications à propos de faits allégués. Quant à Ygrem, il pria le Conseil de l’excuser, invita à continuer sans lui, et se retira. Il ne pouvait s’endormir, car germait l’idée qui allait rendre son règne célèbre chez les Nassugs et au-delà : le rêve des Quatre Cités…
Mais remontons bien des années en arrière : avant que la « révolution sociale » ne prît forme dans l’esprit du roi. C’était au tout début de la révolution technologique. Elle avait été d’autant plus rapide, qu’elle n’était quasiment pas passée dans les modes de vie. Oramûn, fils de Santem, revenait du long périple d’enquête, où l’avait conduit le soupçon d’une trahison qui serait à l’origine des exactions commises par les Aspalans dans l’île de Sarmande.









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer










































 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
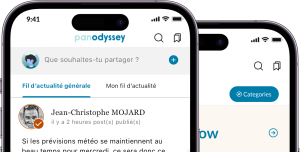





Mathias Moronvalle il y a 2 ans
Cela me rappel un livre que j'ai aimé, peut-être un conseil de lecture. Parleur ou les Chroniques d'un rêve enclavé de Ayerdhal, Réédition en 2009 chez Au diable vauvert (ISBN 978-2846262231) - Prix Ozone 1997.