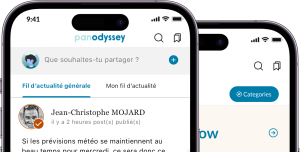8-Retour à Louvain (1536-1537)
 26 min
26 min
8-Retour à Louvain (1536-1537)
À Louvain où je suis depuis quelques semaines, j’assiste donc à cette horrible dissection sur la place publique. Qu’ai-je voulu voir en vérité que je ne sais déjà et qu’est-ce que j’espère découvrir entre les mains de ce boucher ? Mais tout ceci est de ma faute et je ne peux me plaindre.
J’ai 22 ans dans trois mois et je change une nouvelle fois d’université. Après mes années parisiennes, je retourne à Louvain avec mélancolie. Triste ville bourgeoise, austère et si peu en rapport avec mes goûts. Les affrontements repartent entre l’Empereur Charles-Quint et le roi François 1er et cela m’oblige à revenir dans le Brabant pour y poursuivre mes études. Ces deux monarques passent leur vie à guerroyer. François 1er vient d’avoir quarante et un ans, mais la santé de ce roi aimant la fête et les plaisirs est bien entamée. Mon maître Gonthier d’Andernach, son médecin personnel, a fort à faire pour le convaincre à moins de bombance, à mener une vie plus chaste et à se soigner autrement que par les pilules mercurielles de son ami Barberousse le corsaire ottoman aux ordres de Soliman le Magnifique. Mais François 1er reste sourd à ses suppliques, toujours attiré par les femmes et la table qui risquent de le perdre. Il n’a pourtant rien perdu de sa superbe et donne encore le change. Brillant devant un auditoire pour soutenir une conversation malgré une prononciation difficile due à une perforation du voile, conséquence d’une syphilis dont l’a gratifié une gourgandine de passage. Sa mémoire est aussi fidèle qu’aux premiers jours et il se complaît à animer toutes les conversations. Quant à Charles-Quint qui n’a que trente-cinq ans, son état est encore pire. C’est un homme usé par toutes sortes de maladies. L’empereur s’entoure de plus de trente médecins qui épient sa moindre toux et soignent arthrose, goutte, crises hémorroïdaires, malaria, asthme, crises d’épilepsie. Il réclame sans cesse du sucre faisant des malaises dès qu’il cesse d’en consommer. Son caractère allie mélancolie, qu’assurément il tient de son aïeul Charles le téméraire, à des accès d’agitation et de violence où l’on retrouve l’héritage de Maximilien. Son ascendance habsbourgeoise l’affuble aussi de cette lippe prognathe si caractéristique qui affecte son élocution, dont son fils Philippe II héritera, et qui lui confère cet air niais bien qu’il soit d’esprit vif.
La mort du duc de Milan, François Sforza, au mois d’octobre de l’année 1535, est l’occasion pour François 1er de revendiquer cette ville qu’il adore et qui revient pourtant de droit à Philippe II. Tout le comble. Le magnifique Duomo, véritable dentelle de pierre d’une hauteur jamais égalée pour une cathédrale, et dans laquelle Marco d’Agrate viendra plus tard, alors que j’étais médecin à la cour de Philippe II, y présenter dans le transept l’écorché de Saint Barthélémy, écorché que j’aurai l’occasion de voir et que je trouve criant d’exactitude. Milan toujours avec son église Santa Maria delle Grazie où Léonard de Vinci y a peint la Cène. Autant d’éléments qui ne peuvent qu’enchanter le souverain français. Les guerres pour sa possession dureront 3 ans, alternant succès et défaites dans les deux camps, mais Milan ne deviendra jamais française. Que de guerres, de morts, de blessés, de villes rasées, le peuple a-t-il dû endurer pour le bon plaisir des puissants et un aussi médiocre résultat !
Je retrouve avec bonheur mon jeune frère François qui vient de s’inscrire à l’Université ès art où il débute, sous l’insistance de mes parents, des études d’avocat. Cette proximité est peut-être la seule chose qui me fasse un peu aimer Louvain. Pourtant cette ville bourgeoise qui étale ses maisons aux pignons festonnés et aux teintes délicates, ces brumes matinales qui peinent à s’estomper, cette campagne verdoyante ponctuée d’étangs paisibles dans un cadre idyllique qui paraît somnoler, aurait dû me satisfaire. Il n’en est rien. Peut-être est-ce encore trop tôt pour un jeune homme qui n’aspire qu’à apprendre et à voyager. D’autres villes m’attirent bien davantage. Mes quelques dissections parisiennes ont toutefois fait parler d’elles et sitôt rendu, me voilà invité par la comtesse d’Egmont à assister à l’autopsie d’une jeune fille de la noblesse locale, morte sans qu’on en connaisse la raison exacte, mais qui présentait selon l’oncle une gêne respiratoire importante et une pâleur notable. Impressionné par l’incompétence et l’inexpérience du barbier chargé de la dissection, je décide de le remplacer au pied levé bien que je n’aie aucune compétence en ce domaine. D’emblée la striction nette de la région diaphragmatique m’apparaît évidente générée par un corset trop serré et expliquant sans nul doute la gêne respiratoire chronique. Mais pourquoi le teint exsangue ? Il n’y a là aucun rapport et cette pâleur excessive est certainement la cause du trépas. Y a-t-il eu étranglement de l’utérus qui, selon Rhazès, peut survenir en l’absence d’intervention de l’homme et cause possible de la mort ? Ceci n’explique cependant toujours pas la pâleur invoquée. L’utérus examiné ne me révèle aucun étranglement. J’en profite pour examiner, comme je le ferai toujours à l’avenir, les ovaires et les trompes attenantes dont on ne sait toujours que très peu de choses depuis leur description, il y a plus de 1500 ans, par Rufus d’Éphèse. À cette occasion j’observe dans l’ovaire de cette jeune femme un sinus empli d’une humeur aqueuse de couleur jaune comme celle d’un œuf alors que lors des deux dissections suivantes, sollicitées depuis par la comtesse, je n’observe que des cavités remplies d’une humeur blanche. Je n’ai aucune explication à ce phénomène. Mais là encore je ne vois pas de rapport avec le trépas de cette jeune femme. J’en fais part à la famille, avouant humblement mon incompréhension, bien que je craigne d’être taxé d’incompétence, mais je ne sais mentir. À ma grande surprise, mon honnêteté touche les parents qui me remercient chaleureusement de ma franchise. Combien d’inconnues dans la fabrique du corps humain nous faut-il encore percer à jour ? Une seule vie sera loin d’y suffire. Je profite de ces quelques mois à Louvain pour soutenir ma thèse sur ce médecin perse du IXe siècle, Rhazès -Razi-, que j’ai déjà évoqué en passant mon baccalauréat en médecine en 1532 avant de partir pour Paris.
Ma soutenance se passe beaucoup mieux que je ne l’espérais malgré un choix bien peu orthodoxe une fois de plus qui aurait pu faire grincer des dents mes professeurs. Je dois aussi disséquer un cadavre devant l’auditoire. Je procède plan par plan en réalisant de façon parfaite une dissection minutieuse des organes abdominaux dans un silence assourdissant. Ne me satisfaisant pas de ce travail et disposant encore de temps grâce à mon expérience, j’incise le thorax, décrivant les poumons, désignant le cœur et les artères qui en partent, ignorant la réaction épidermique de quelques religieux présents qui me rappellent que là siège l’âme du défunt et qu’il serait dangereux d’aller plus loin. Je m’en tire fort bien dans le temps imparti et reçois les félicitations du jury.
Ma soutenance de thèse n’est plus qu’une formalité.
Cette dissection a fait forte impression et l’université me propose de donner des cours d’anatomie aux étudiants en médecine. Pour me perfectionner moi-même dans une branche peu connue, mais plus que tout autre nécessaire à l’ensemble de la médecine, j’expose et décris la structure théorique de l’organisme humain en l’illustrant de dissections. Celles-ci, absentes à l’université depuis plus de 18 ans, font grand bruit. Si je gagne le respect et l’admiration de beaucoup d’élèves qui découvrent la véritable anatomie et comprennent mieux les cours, ces derniers attirent aussi les gens d’Église, soucieux d’entendre ce que je pourrai dire, mais aussi les bourgeois curieux et quelques professeurs intrigués par mon comportement. L’un d’entre eux, Jérémie Thriverius, méprise les jeunes médecins qui veulent s’exonérer en partie de la pensée galéniste et nous nomme les Luthériens de la médecine. Malgré ma dissection, mes tendances réformatrices en anatomie ne sont guère appréciées des théologiens, car mes doutes sur l’immortalité de l’âme et son siège n’ont toujours pas été digérés. Toujours hanté par le désir de m’améliorer sans cesse et de parfaire mes connaissances dans cette discipline, je reprends mes incursions au pied des gibets avec mon éternel ami, Gemma Frisius, devenu en quelques années un célèbre mathématicien et un physicien reconnu. Un matin la chance nous sourit. C’est une journée de franc beau temps pas si fréquent que cela sous nos latitudes. Le printemps s’éveille après un hiver qui a marqué les corps et les premiers bourgeons, tumescents en quelques heures, éclatent sous l’insistance du soleil. Nous devisons, parlant des évènements récents et notamment du contrat de Vannes qui vient d’être signé entre François 1er et les États de Bretagne, le duché devenant province française. Mais il a fallu avoir recours à l’argent, qui, en ce monde, règle toute chose ; les délégués des États de Bretagne ayant marqué leur franche hostilité à l’annexion pure et simple du duché.
- Charles VIII puis son cousin Louis XII avaient préparé le terrain en se mariant avec Anne de Bretagne, permettant à la France de rattacher ce duché à leur royaume puis de le garder, précise Gemma qui paraît mépriser ces manipulations françaises pour garder leur possession.
Je ne manque pas de renchérir, tellement conscient des jeux de pouvoir chez les puissants.
- En outre, ces deux rois, avant François, ont été sous le charme de l’Italie et y ont guerroyé.Charles fut même considéré comme le libérateur de l’Italie avant d’en être chassé…Et la guerre reprend !
Sans nous en rendre compte, nous franchissons la porte de Tirlemont qui, plein est, ferme l’enceinte fortifiée de la ville. Immédiatement, à une centaine de pas de Louvain, nous voilà dans la campagne, cernés de champs et de masures. Sur la place d’un modeste village, un gibet est dressé sur lequel les os desséchés d’un voleur notoire qui y vivait, comme le précise un panneau, se balancent. La torture a consisté à l’enchaîner au sommet de la potence et un feu, allumé sous ses pieds, l’a rôti lentement. La chair cuite à point a fait le régal des corbeaux qui ont pu festoyer plusieurs jours avec de telles agapes, écurant le corps. Seul persiste un squelette sans le moindre vestige de chair. L’occasion est trop tentante. Le crépuscule venu et avec l’aide de Gemma je grimpe au sommet du pilori pour tirer à moi cette charpente d’os. À mes pieds, Gemma s’empresse de cacher les éléments dans les fourrés voisins. Avec de grandes précautions, surveillant les alentours, nous réussissons à nous emparer de la totalité du squelette auquel manquent toutefois un doigt, une rotule et un pied. Après de multiples voyages, empruntant différentes portes, je récupère mon butin que je réassemble chez moi. Dans cette ville où je passe peu de temps, je deviens rapidement le maître des squelettes humains et des petits animaux, car je pratique désormais l’anatomie comparative qui me semble essentielle. J’invite mes élèves à pouvoir reconnaître n’importe quel os – humain ou animal – les yeux fermés. C’est une immense satisfaction de constater que les jeunes professeurs de l’université à qui j’expose l’anatomie humaine en illustrant mes cours de dissections, comprennent désormais leur nécessité. Ce squelette reconstitué me sert désormais pour les cours, clarifiant le fonctionnement de l’ensemble, notamment pour les articulations, car les ligaments sont encore présents en bien des endroits. J’ai d’ailleurs peaufiné la préparation du squelette lorsque la chair est largement présente. Je le dépouille du mieux possible de tous les tissus mous en préservant les ligaments puis je le saupoudre de chaux, le dépose dans un cercueil perforé où je fais circuler de l’eau à débit rapide - le cours d’une rivière est l’idéal - pendant une bonne semaine. Après quoi, je le fais sécher au soleil dans la position qu’il convient, de telle sorte que les ligaments en se rétractant maintiennent os et ensemble dans la bonne position. Quant aux os désolidarisés, je les fais bouillir pour enlever toute trace de chair restante et je les relie entre eux avec du fil de cuivre.
Dieu, le souverain Créateur des choses a sagement agi en façonnant la substance de cet élément, destinée à avoir le rôle de support pour le corps tout entier. La substance des os occupe la même fonction que les murs et les poutres dans les maisons, les poteaux dans les tentes, la quille et les flancs dans les navires.
Ce squelette remonté et articulé présente un intérêt didactique indiscutable pour mes étudiants, mais je découvre à cette occasion mon côté sombre. Cette carcasse qui m’attire irrésistiblement représente la finitude humaine et l’inutile vanité de l’homme au cours de sa vie remettant ce dernier à sa vraie place. Que veux-je prouver ? N’est-ce pas justement vanité que de vouloir changer l’ordre des choses, imposer une autre vue, un autre discours ? Comme il fallait le craindre, les calomniateurs, peut-être jaloux de mon succès grandissant, me rattrapent. Je ne suis qu’un profanateur de tombes et entretiens de bien mauvaises fréquentations. Ne m’a-t-on pas vu traîner plus que de raison avec Rutgerius Rescius, mon ancien professeur de grec au Collègium Trilingue, ami d’Érasme et maintenant imprimeur, qui serait davantage attiré par le gain que l’enseignement désintéressé des langues. Peut-être suis-je même hérétique puisque j’ai aussi fréquenté Gonthier d’Andernach qui fut mon professeur de grec au Collège avant de devenir l’un de mes professeurs d’anatomie à Paris. Or, cet homme est favorable aux idées réformistes. Jusqu’au Néerlandais Justus Velsius, humaniste, médecin et mathématicien dont je fais la connaissance pendant son séjour à Louvain. N’ayant aucun poste universitaire, il donne des cours publics de grec, de latin, de philosophie et de mathématiques. Sa pureté théologique est suspecte pour les cerbères de l’université qui finissent par l’expulser. Cette ambiance, ces rumeurs, ces jalousies me pèsent. Va-t-on un jour dénoncer mes escapades clandestines avec Gemma ? Son poste est envié et mon ami Gemma est forcément jalousé, donc suspect au même titre que moi. Bien qu’il soit paralysé de ses jambes, l’université est bien capable de lui attribuer aussi le vol de squelettes alors que sa participation reste plus solidaire que physique. Je ne peux m’y résoudre. Mes critiques acerbes sur le siège présumé de l’âme, toujours attribué au cœur depuis Aristote, m’ont valu la rancune des théologiens. Le vent du départ commence à souffler en ce début d’année 37. Pourtant je pressens que je ne peux partir sans laisser quelque chose, mais il est encore bien tôt pour écrire un ouvrage d’anatomie. Après de longues discussions avec Rutgerius Rescius qui m’ont donc été reprochées, je lui soumets l’impression de paraphrases pour le neuvième livre de Rhazès, consacré aux médicaments. Ce Rutgerius, très érudit et qui avait été, comme je l’ai dit, mon professeur de grec au Collège, avait repris après son mariage 12 ans plus tôt l’imprimerie de Thierry Martens avec qui il était précédemment associé. Il accepte mon idée et je lui confie mes écrits en février 1537. J’ai pris soin de dédicacer l’ouvrage à Nicolas Florenas qui m’a recommandé auprès du maître parisien Jacques Dubois. Le principe consiste à corriger la traduction latine du nom des médicaments quand elle est inexacte. Les médecins arabes en effet ne traduisent pas directement les textes originaux grecs, mais des ouvrages déjà traduits et interprétés comme le fait l’un des médecins grecs les plus célèbres du VII siècle, Paul d’Égine qui fit ses études à Alexandrie et dont la source initiale est celle d’Oribase, médecin grec du IV siècle qui lui-même a déjà réalisé des compilations d’Hippocrate et Galien. Paul d’Égine vient d’ailleurs, près de 10 siècles après sa mort, refaire parler de lui avec pour la première fois l’impression de son livre de chirurgie et ses considérations sur le traitement des plaies de guerre par flèches et projectiles de fronde ainsi déjà qu’une technique des ligatures vasculaires lors des amputations. L’ouvrage que je proposais devrait soulager considérablement le travail de recherche des étudiants. Par contre, quand le nom arabe désignant une potion, la thériaque par exemple ou les remèdes topiques, est bien connu, je le maintiens et utilise une paraphrase ou ajoute une explication si je l’estime nécessaire à la compréhension. Bien qu’une fois encore je suis vivement critiqué pour avoir osé corriger une traduction souvent imparfaite d’un ouvrage essentiel, certains de mes pairs me félicitent chaleureusement convaincus que c’était nécessaire et je garde en mémoire ces mots d’un confrère, enchanté par ces paraphrases : parce qu’il est lu dans une mauvaise traduction, il déplaît. Maintenant, on l’apprécie davantage. Et c’est à toi, Vésale, que nous pouvons à juste titre attribuer cela ; l’honneur t’en revient sans aucun doute. Va, je te suis.
Jean-Jacques Hubinois / Vésale, le trublion de la Renaissance / Amazon
Photo: istock









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer


























 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur