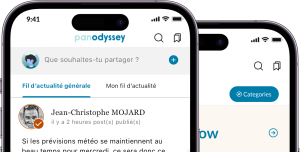12- Padoue
 22 min
22 min
12- Padoue
Ces planches d’anatomie sont les premiers résultats de mes travaux, fruits d’observations, de dissections, d’interrogations, de questionnements, de vérifications qui me permettent de proposer ces dessins qui sont pour moi la réplique la plus proche tentée de la réalité. Ce n’est que le seul et unique critère retenu. Je crois aussi que le livre médical en soi ou des planches anatomiques similaires perdent leur autorité dogmatique pour devenir un auxiliaire ou un substitut pour l’enseignement qui a lieu de visu. Le livre devient une aide à la compréhension et non un document à apprendre sans le comprendre. Je veux enfin enseigner à mes élèves que le doute scientifique doit être une constante permanente dans tout esprit qui se revendique méthodique et critique. C’est la seule manière de progresser encore et encore.
Ce succès qui m’honore et récompense un énorme travail survient dans un siècle où le monde bouge, s’intéresse et s’interroge, où échanges et voyages se développent. Désormais ce ne sont plus les lieux de pèlerinage où l’on se rend, mais bien les beautés des villes et de la nature qui attirent les voyageurs. Les discussions scientifiques, la connaissance deviennent accessibles à un grand monde grâce à l’imprimerie, ce qui me vaut d’être connu et reconnu par toutes les universités célèbres qui me sollicitent désormais pour des cours magistraux. En janvier 1540, les étudiants de Bologne m’invitent à venir illustrer de mes dissections anatomiques les cours théoriques enseignés par Matthaeus Curtius, l’un des professeurs d’anatomie les plus réputés d’Italie du Nord. La ville est belle, comme toutes les villes italiennes et, une fois encore, je suis envoûté par son charme. Malgré la saison, le ciel est bleu et le temps doux. Le soleil d’hiver diffuse sa lumière tamisée sur les vieilles pierres de la Piazza Maggiore avec sa basilique San Pétronio. Les palais médiévaux rivalisent de beauté et le palais dei Banchi sur cette place que je longe chaque jour pour me rendre à l’université, encore inachevé, promet d’être exceptionnel. Bologne peut s’enorgueillir aussi de posséder ces très hautes tours médiévales qui sont partout symbole de la puissance et de la richesse des familles locales, et elles rivalisent de hauteur et d’audace. La plus haute frôle les cinquante toises et la vue de son sommet est admirable. L’un des étudiants les plus acharnés à ma venue est un étudiant d’origine allemande, Baldasar Heseler, qui vit à Bologne avec sa famille et sa jeune sœur. La famille est aisée et il me propose de séjourner chez ses parents ce que j’accepte avec grâce. C’est cet élève qui racontera plus tard comment se passaient les dissections avec son maître Curtius et ce qu’il m’arriva avant la fin des cours magistraux. Les séances s’étalent sur quinze jours au lieu des trois semaines traditionnelles et je dispose de trois cadavres d’hommes et de six chiens. Mes cours sont la réplique de ce que j’ai initié à Padoue. Bien peu comparables à ceux de Curtius, selon Heseler, cours exclusivement théoriques qui se déroulent de la façon suivante : lecture d’extraits du livre de Mondino de Luzzi, auteur d’un Anatomia plus d’un siècle auparavant, auxquels Curtius oppose des opinions de Galien qui ne se discutent pas. Il ne pratique aucune dissection. Je ne finis jamais mes cours au grand regret de la majorité et probablement la totalité des étudiants qui m’ont plébiscité. Vingt-six séances plus tard, Curtius me fait savoir que je ne suis plus le bienvenu dans son université. Il ne fallait pas égratigner Galien même au nom de la science et de toute manière mes allégations restent pures inventions. Cela modifie aussitôt l’opinion favorable que ressentent pour moi les parents de Baldasar et mes approches auprès de leur fille ne sont plus les bienvenues. Un gendre professeur en médecine est chose flatteuse, mais en aucun cas un enseignant interdit de cours. Je m’interroge sur la part d’aveuglement ou la force des préjugés chez ces professeurs galénistes même devant l’évidence. Est-ce la jalousie ou la haine qui dictent leurs comportements par refus de se remettre en question ? Comment comprendre. Pourtant dans l’histoire la connaissance évolue sans cesse et les modernes triomphent toujours. À partir de cet instant, je me considère professeur itinérant, étant sollicité dans différentes villes d’Italie, en tout premier lieu, excepté Padoue, Pavie, Pise et Bologne. Une année passe ainsi où j’alterne voyages pour les cours, recherches et publications. Cette période reste la plus heureuse de ma vie. Je n’ai aucune charge, pas de soucis de famille et je suis sollicité pour enseigner dans de nombreuses universités. J’en profite pour prendre parti sur le lieu d’élection de la saignée en cas de syndrome pleurétique qui oppose là encore classiques et modernes et je ne peux que donner raison à l’école moderne de Pierre Brissot contre Galien. Cet engagement reste le fruit d’observations faites sur le corps humain et de longues discussions avec des médecins auxquels je m’oppose. Ce sont mes expériences et ma longue pratique des dissections qui guident mon choix et je note, pour la première fois l’existence de la veine azygos dont j’estime le rôle majeur en cas de veine du foie obstruée. Cette veine est en effet unique et j’ai pu observer qu’elle draine les petits vaisseaux du côté droit notamment les veines intercostales droites, côté où elle se trouve, mais également du côté gauche du thorax et, si l’on veut drainer par la saignée les inflammations de la plèvre ou tout autre syndrome pleurétique il n’y a pas d’autre façon de faire que de saigner du côté droit et particulièrement au niveau de la veine axillaire droite de l’avant-bras. C’est par une longue lettre de plus de 60 pages que je choisis de m’exprimer, lettre que j’adresse à Nicolas Florenas, ami de la famille et parrain de mon frère Nicolas qui est entré au service de Charles-Quint en 1530. Cette lettre, genre que je choisis pour donner mon avis éclairé en tant qu’anatomiste, me permet une plus grande liberté d’expression qui ne pouvait se concevoir si j’avais préféré écrire un ouvrage. C’est également à cette occasion, par mes dissections répétées, que je peux affirmer que cette veine finit son trajet dans la veine cave supérieure et non la veine cave inférieure comme l’affirmait Galien. L’université de Padoue, reconnaissante et admirative pour mon travail qu’elle considère comme admirable et incomparable, source d’enthousiasme chez les étudiants, décide aussitôt de m’augmenter de façon substantielle et je touche dorénavant soixante-dix florins par an. J’entreprends enfin les premières lignes de ce que je considère comme mon œuvre majeure, De humani corporis fabrica, la fabrique du corps humain, où je souhaite passer en revue toute l’anatomie humaine en plusieurs fascicules, apport essentiel pour l’étudiant désirant comprendre et apprendre.
Cette même année le roi de France signe à Villers-Cotterêts un Édit qui, je le sais, fera plaisir à Ambroise Paré dont j’ai eu des nouvelles par un ami de passage qui me confirme que sa notoriété ne cesse de grandir. Il semble avoir fait des miracles comme médecin de guerre, notamment en Provence lors des affrontements avec les troupes espagnoles. Cet Édit décrète l’emploi obligatoire du Français au royaume de France, notamment pour régler les affaires de justice. Lors d’un passage à Turin j’ai également le plaisir de retrouver mon cher Rabelais. Il reste dans les pas de Guillaume du Bellay, gouverneur du Piémont et frère du cardinal et il m’annonce qu’il vient de publier sa « Lettre de Gargantua à Pantagruel » toujours sous son pseudonyme d’Alcofribas Nasier car il estime qu’il ne peut signer de son vrai nom un ouvrage aussi fantaisiste. Nous dînons ensemble dans une vieille auberge du centre de la ville. Mon ami n’a rien perdu de sa gouaille et de son humour. Ni son amour du bon vin et de la bonne chère. C’est un plaisir de l’écouter me raconter ses projets d’écriture, sa passion pour Rome dont il a désiré en établir un plan avant d’abandonner l’idée estimant que celui rédigé par Bartolomeo Marliani est plus détaillé que le sien. J’apprends à cette occasion qu’il a deux enfants nés hors mariage que le pape Paul III va légitimer.
— Je dois cette reconnaissance à Guillaume. Cet homme est extraordinaire et possède toutes les qualités dont il est permis de rêver. Diplomate, homme politique et homme militaire remarquable, il est en outre très généreux et n’a jamais tiré avantage de ses postes diplomatiques pour s’enrichir. Notre bon roi François le tient d’ailleurs en grande estime.
Rabelais s’arrête soudain, essuie ses lèvres charnues et incarnates d’épicurien et me toise amicalement.
— Et toi mon cher ami, avances-tu dans tes projets ?
— Je commence à concrétiser mon rêve, celui de publier un atlas anatomique complet destiné aux médecins et aux étudiants. C’est une tâche immense…
— Et combien nécessaire, mais ne crains-tu pas que certains étudiants n’aient quelques difficultés avec le latin… Souviens-toi d’Ambroise, pourtant le plus compétent d’entre nous en chirurgie. Cela lui pose quelques problèmes avec ses maîtres qui le regardent de haut !
— Robert Estienne, l’imprimeur du roi vient, fort judicieusement d’éditer un dictionnaire latin français et français latin qui sera une aide indiscutable et il survient à point nommé. C’est essentiel aussi pour mes ouvrages actuels et à venir, car j’utilise exclusivement cette langue. Ils seront ainsi accessibles au plus grand nombre.
Quand Rabelais me quitte après une nuit de ripaille et de discussions, il m’offre généreusement un exemplaire de son dernier ouvrage et me souhaite la plus grande réussite dans mes projets. De mon côté, je l’exhorte à ne pas trop défier les théologiens de la Sorbonne et ne pas tendre une oreille trop réceptive aux thèses des réformés. L’année passe comme les précédentes à Padoue où je me plais de plus en plus, fréquente des amis dans les cercles bourgeois de la ville avec qui nous échangeons nos points de vie, nos ambitions, nos lectures dans cet Ancien Monde en pleine effervescence.
Le premier jour de l’année 1540 se dessine sous un heureux présage, Charles-Quint et François 1erorganisent une entrée solennelle dans Paris pour marquer la fin des guerres entre nos deux pays. Dans le courant de cette année, les étudiants de Bologne m’invitent à pratiquer des dissections anatomiques dans leur université. Je travaillerai avec le professeur Matteo Corti qui y enseigne l’anatomie depuis 1534 et avec qui j’ai eu des discussions très tendues après ma lettre sur la saignée qu’il a vivement critiquée. Il est convenu que Corti assurerait cinq leçons et que de mon côté, j’intercalerais des cours de dissections en parallèle. Jamais, je n’avais eu l’occasion de disposer d’autant de cadavres puisque, outre les trois cadavres humains, l’université pour mes études anatomiques comparées m’avait également confié le corps d’un singe, de six chiens et de nombreux petits rongeurs. Les jours de dissection se suivent et ma stupeur ne cesse de croître. Je retrouve une multitude de différences dans les corps que je mets à nu et que je confronte avec les affirmations de Galien. Et le singe dont je découvre pour la première fois l’anatomie corrobore ce que je suspectais sans en être certain. Galien ne se trompait pas, mais il n’avait jamais disséqué des corps humains, il s’agissait de singes ! C’en est trop et malgré le grand désordre qui anime mes pensées, je me tourne vers Corti qui ponctue chaque phrase de son pontifiant Galien a dit pour le mettre au défi de nier, corps de singe et d’homme disséqués à l’appui, les différences qui s’étalent devant ses yeux. Avec une évidente mauvaise foi, ce méprisable professeur quitte l’église Saint-François escorté de ses thuriféraires sans oublier d’invoquer l’autorité incontestable de Galien que l’on ne peut remettre en cause sous peine d’être coupable d’hérésie. Avant de quitter Bologne, je termine comme toujours mes dissections jusqu’au squelette et décide de monter l’un des squelettes humains ainsi que le squelette du singe dont j’ai pu disposer. Cela permettra à chacun, et pour la postérité de juger des différences.
Le Nouveau Monde bruisse à son tour de mille et mille échos. En mars, un événement qui quelques années plus tard accablera les noirs d’Afrique parvient à nos oreilles. Le prêtre jésuite Bartolomé de las Casas dénonce auprès de Charles-Quint la cruauté des blancs envers les Indiens. La controverse de Valladolid va bientôt naître et se faire entendre dans tout l’Ancien-Monde, mais nous n’en savons encore rien. Un autre personnage, pour le plus grand malheur de mon ami Michel Servet, revient dans la cité genevoise avec une nouvelle liturgie et des idées politiques réformatrices. Calvin va dorénavant promouvoir la réforme à Genève et dans toute l’Europe. Mais de tout cela je n’ai cure. Depuis que je suis nommé, voilà maintenant trois ans, par le sénat de Venise au poste de lecteur en chirurgie et d’anatomiste à l’université de Padoue, je poursuis mon enseignement et publie mes recherches. J’initie également mes élèves à l’examen clinique dans l’Hôpital San Francesco Grande de Padoue où j’ai été nommé médecin. Je mène tous les jours ces derniers au lit des patients où ils décrivent leurs symptômes, rédigent une observation et posent le diagnostic. Mon élève Realdo Colombo - qui plus tard me succédera et attaquera mes travaux en prenant la défense de Galien - m’y a rejoint. Un matin, alors que nous faisons la visite pour découvrir les nouveaux entrants et les examiner, nous demeurons perplexes devant une lésion cutanée qui s’étend sur toute la partie interne de la cuisse chez une pauvre femme âgée qui ne semble plus garder toute sa raison.
— Que vous est-il arrivé en cet endroit ? En l’interrogeant, je désigne cette ligne irrégulière qui court, creuse sa cuisse et ne nous évoque rien de connu.
La femme me regarde sans comprendre et je ne suis pas plus avancé.
— Cette lésion résiste au grattage et semble avoir érodé la peau sans la léser, commente mon ami. Ça n’est pas une cicatrice quoi qu’il en soit.
Nous inspectons cette malheureuse sur tout le corps, à la recherche d’éléments autres qui nous guideraient pour le diagnostic comme nous l’enseignons à nos étudiants, mais sans résultat. Soudain, l’explication jaillit devant nos yeux incrédules. Cette pauvre femme ne se lève pratiquement plus et elle urine sur elle ! Le jet en bout de course reprend le sillon tracé par de nombreuses mictions précédentes.
Réaldo et moi partons d’un éclat de rire inextinguible. Une preuve de plus que rien ne peut remplacer l’expérience et la pratique, les ouvrages ne venant qu’en complément pour ancrer les idées !
Photo: Rabelais /Evene/ Le figaro









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer


























 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur