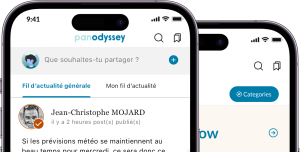18- De sombres nuages (1554-1559)
 23 min
23 min
18- De sombres nuages (1554-1559)
À la fin de l’année passée, mon jeune frère François meurt de la peste alors que je passais mon temps à guerroyer avec l’empereur pour des raisons futiles à mes yeux, peste qu’il avait contracté à Vienne où il avait été nommé magister sanitatis, c’est-à-dire médecin de cette épouvantable maladie. J’apprends son décès plusieurs jours après sa survenue alors que nous faisons le siège de Metz et je ne peux me rendre à son enterrement. Cette absence involontaire de ma part m’affecte terriblement. Non seulement parce que c’est mon frère, mais aussi parce que c’était avant tout le plus fidèle et le plus désintéressé des amis. Il avait aussi assuré une large diffusion de ma longue lettre sur la racine de Chine, où j’énumérais avec amertume mes griefs sur tous les médecins galénistes, dont le chef de file était mon ancien maître Jacobus Sylvius, qui niait toujours, avec la plus grande mauvaise fois, que Galien, quelles que soient ses compétences avait commis des erreurs car il n’avait jamais pu disséquer des cadavres humains.
La réponse de Sylvius, à laquelle j’ai pris le parti de ne pas répondre, a été cinglante et de la plus grande incorrection. « Inclinez-vous, Vésale, devant la véracité de vos maîtres… dont vous déniez avec ignominie les travaux »… Jusqu’à dire avec la plus grande grossièreté : « J’implore Sa Majesté Impériale de punir sévèrement ce monstre… de l’exclure pour qu’il n’empoisonne plus l’Europe de son haleine pestilentielle »…
Ces phrases lâchées lui firent au demeurant beaucoup plus de tort que de bien et il perd, à cette occasion, beaucoup de fidèles élèves qui ne peuvent que constater de visu que je dis la vérité. Cependant les rares détracteurs restants devinrent encore plus acharnés contre moi.
Un an avant la mort de François, j’ai eu aussi quelques soucis avec Bernadino Montana de Montserrate qui semblent augurer d’années difficiles où les nuages s’accumulent sur ma tête. Ce médecin et chirurgien espagnol, né en Catalogne, travaille également à la cour de Charles Quint. Il a étudié la médecine à Montpellier et parle donc, outre le latin, parfaitement le français. Il m’avait sollicité pour que j’accepte une traduction de mon ouvrage La Fabrica en espagnol, me faisant miroiter de gros avantages financiers et une belle notoriété en Espagne où je suis très mal considéré. L’ouvrage paraît sous le titre El libro de Anothomia del hombre, traité dans lequel je dois renoncer à beaucoup de texte et de gravures d’origine. Mais le plus méprisable vient du fait que cet individu signe l’ouvrage de son nom sans que le mien n’apparaisse nulle part. Quelques années plus tard, en 1556, l’Espagnol Juan Valverde de Asmusco édite L’histoire de la composition du corps humain en réalisant un pillage en règle des planches de La Fabrica dans un format plus petit.
Après mon frère François, deux fort tristes nouvelles me touchent en cette année 1553. Mon cher Rabelais meurt au printemps à Paris, rue des jardins, sur la paroisse de Saint-Paul. Depuis quelque temps, il était revenu dans la capitale où, grâce à la bonté du cardinal du Bellay, il bénéficiait d’une prébende dans l’église collégiale de Saint-Maur et une cure à Meudon. Rabelais, que j’aimais tant, meurt entouré des siens et jusqu’au bout, dit-on, l’humour l’accompagne en rédigeant l’épitaphe suivante : Je n’ai rien, je dois beaucoup, je donne le reste aux pauvres… Son œuvre qui vient d’être mise à l’index par le Librorum prohibitorum a peut-être précipité sa fin. Mais le pire reste à venir. L’année se clôture par une horrible nouvelle lorsque j’apprends la mort abominable réservée à Michel Servet. Cet ami que je considère comme l’un des médecins et des théologiens les plus érudits de son temps vient d’éditer anonymement à compte d’auteur Christianismi restitutio où son nom est vite découvert. Cet ouvrage lui attire une condamnation à mort par les catholiques et les réformés réunis, l’accusant dans chaque camp de nier la divinité du Christ. À Vienne où il réside et exerce la charge de prieur d’une confrérie qui a pour mission d’aider les pauvres de l’Hôtel-Dieu, Michel est jugé par contumace après s’être évadé pour échapper au procès. Une effigie en bois de mon ami et son livre La restitution du christianisme sont brûlés sur la Place de Ville. Dans sa fuite, Michel se réfugie à Genève où prêche Calvin et où il s’estime à l’abri de tout jugement trop sévère, comptant sur l’esprit de tolérance de ce dernier. Mal lui en prend. Il est arrêté et incarcéré dans des conditions inhumaines. Son jugement est mené par un proche de Calvin et on lui refuse l’aide d’un avocat. La délibération est sans appel et Michel est condamné à être brûlé vif avec son ouvrage le 26 octobre 1553. Le bois humide, gorgé d’eau, prend difficilement, prolongeant son horrible supplice. J’apprends qu’il s’en est suivi une longue polémique à laquelle Calvin réplique de façon cinglante, assurant que des propos semblables à ceux écrits par l’accusé méritent plus qu’une une mort simple, mais imposent une fin cruelle et douloureuse. Quels effroyables propos dans la bouche d’un homme qui se veut exemplaire. Je crains en fait que l’usage de bois humide ait été délibéré.
Un ami très cher disparaît ainsi, tout à la fois médecin émérite, anatomiste hors pair, écrivain, théologien sans oublier l’un des plus grands esprits actuels. Étrange époque où, dans bien des domaines, la science progresse, que ce soient la médecine, l’exploration de continents grâce aux progrès de la navigation, l’astrologie, l’anatomie, l’imprimerie, autant d’avancées dont il convient de se réjouir. Pourtant, souvent, un vent conservateur, parfois rigoriste, souffle dans la direction inverse s’opposant à cette révolution en marche, inexorable, comme pour l’arrêter ou en freiner le cours.
Semaine après semaine, je sens une désillusion et une humeur mélancolique poindre chez mon royal sujet de complexion flegmatique et dont la santé ne cesse de s’altérer. Ses crises de goutte ne cessent plus car ses excès sont incessants, consentant à ne boire des tisanes et à faire abstinence que pour quelques jours avant de reprendre ses repas gargantuesques. Après la racine de Chine, il revient aux tisanes de bois de Gaïac qu’il décrète plus efficaces et qui restent bien sûr sans effet sur son corps tellement sollicité. Il présente de longues périodes de tristesse indéfinissable, difficiles à rompre. Rien ne semble plus vouloir le distraire dorénavant et le souverain désabusé broie du noir. Il me nomme comte palatin et j’ai droit à une pension à vie, mais je reste muselé, obligé de suivre la cour où qu’elle aille, que ce soit pour faire la guerre et soigner les blessés ou m’occuper des grands de cette cour espagnole qui me méprise. J’en profite pour écrire, à défaut de disséquer, ce qui ne m’est plus possible faute de temps et par manque de tolérance. Je me contente de donner mon avis sur des questions d’ordre médical comme cette fameuse lettre sur la racine de Chine pour laquelle, outre ses injures, Sylvius a demandé une condamnation auprès de l’empereur. Ce dernier un peu contraint s’était donc vu, malgré lui et malgré la confiance qu’il m’a toujours témoignée, amené à saisir une commission à Salamanque, chargée d’enquêter sur les implications religieuses de mes méthodes de travail, médicales ou lors des dissections passées. Le conseil statue finalement en ma faveur, mais les attaques ne cessent pas pour autant.
Heureusement, Charles Quint vient séjourner un temps à Bruxelles. Je redécouvre ma fille Anne, frêle jeune fille de 9 ans, que je n’ai pas vue depuis des années. Elle ressemble trait pour trait à sa mère, pourtant je prie pour que son caractère ne soit pas semblable au sien, acariâtre, frivole et égoïste. Il est vrai que ma vie n’est qu’itinérance, passion pour l’anatomie et dissection, qui m’ont fait négliger mon épouse. Mais pouvais-je faire autrement ? J’en profite pour agrandir encore et embellir notre maison que je ceins de hauts murs qui abritent des écuries et un immense verger. Je tente sorties et discussions avec ma petite Anne, essayant de combler les années d’absence. Ma fille m’enchante par sa vivacité d’esprit et très vite, toute timidité disparue, nos rapports deviennent agréables en apprenant à se connaître. Je passe de longs moments avec elle, sachant que ces rapports ne dureront pas, car tôt ou tard l’empereur, qui occupe le château des ducs de Brabant qu’il fréquente depuis son enfance, quittera la ville quand sa santé sera un peu moins chancelante. Souvent nos pas nous mènent le long de la Senne dont la physionomie ne cesse de changer avec les travaux périurbains et la construction des canaux qui ont démarré quelques années plus tôt signant le déclin de la rivière. En outre les meuniers, pour accroître leur rendement, ont élevé le niveau des étangs au détriment de celui de la rivière. La Senne est devenue un ruisseau tari l’été ou réduit à un rivelet boueux que les poissons ont déserté. Quant aux étangs, plus profonds, ils sont aussi devenus plus froids, ce qui chasse là aussi les poissons qui recherchent une eau plus propice à leur survie et leur fraie. Les viviers d’élevage ferment tous l’un après l’autre, car la carpe qui a conquis l’Europe et nourrit les cours princières voit ses alevins disparaître. Bruxelles grandit. Tous ces travaux la transforment et elle paie les conséquences inéluctables de tout développement urbain.
L’été est là, pesant, infesté de moustiques qui se complaisent dans ce climat tempéré où ils prolifèrent autour des étangs qui cernent la ville. Depuis 10 jours, pluie et vent ont déserté la région et l’évaporation des points d’eau rend l’air humide et accablant. Le moindre vêtement, trempé, colle au corps tandis que l’ombre convoitée ne soulage plus le citadin hébété par cette ardeur estivale si soudaine et bien inhabituelle.
À la mi-juillet, le futur roi Philippe II quitte le port de Corogne, proche de Saint-Jacques-de- Compostelle pour le sud de l’Angleterre aux fins de se marier avec Marie Tudor, future reine d’Angleterre, mariage célébré dans la cathédrale de Winchester. Cette union ne fait pas l’unanimité côté anglais, car la présence du culte réformé devient majoritaire. Pour mettre les époux sur un plan d’égalité, Charles transmet à son fils le royaume de Naples auquel il adjoint le titre de roi de Jérusalem. Philippe qui est prince des Espagne, duc de Milan et héritier des ducs de Bourgogne devient ainsi un roi de statut similaire à cette jeune reine.
Les mois défilent à Bruxelles où l’empereur préfère son été plus clément qu’à Séville ou Grenade. Il n’a pas retrouvé pour autant son allant et s’enfonce doucement dans une torpeur, presque indifférent à son entourage, dédaignant toujours les balades à cheval. Il est vrai que ses paquets hémorroïdaires le font souffrir et lui interdisent ce dernier plaisir. Mais l’essentiel pour moi est de redécouvrir une vie loin de tout tumulte, d’envisager de m’installer et d’apprivoiser ma jeune Anna à qui je fais découvrir la ville et ses attraits et éveille ses sens à la critique et l’observation ce qui me vaut, pour une raison que j’ignore, les foudres de sa mère.
Nous sommes déjà au mois de novembre, exceptionnellement clément cette année et je n’ai pas vu passer l’été. Je reçois dès les premiers jours du mois un pli de mon ami Ambroise qui m’informe qu’il va recevoir le bonnet de maître ès arts courant décembre. Depuis le XIIIe siècle, le collège Saint Côme, où siège l’association professionnelle des chirurgiens siège dans les dépendances de l’église Saint Côme. Les chirurgiens qui en font partie, reconnaissant la compétence de mon ami et sensibles à sa réputation, acceptent de s’adjoindre Paré comme chirurgien, un peu poussé par l’insistance royale. Cependant, mon ami ne parle pas un mot de latin et le comprend encore moins, condition pourtant obligatoire pour briguer ce titre. La faculté de médecine de son côté s’oppose à cette nomination arguant de sa piètre connaissance pour cette langue. Convié à me rendre à sa nomination, je décide de partir sans tarder pour Paris, certain que Charles Quint ne bougera pas de Bruxelles cet hiver.
La nomination a lieu tôt dans la matinée à l’intérieur de ce collège qui jouxte le couvent des Cordeliers construit sous Louis IX. En face de mon ami, les professeurs sont assis sur une estrade qui domine l’auditoire et le jury est composé de maîtres en chirurgie et de quelques médecins opposés à la nomination d’Ambroise. J’entrevois derrière le pupitre maître Coincterel, l’ancien supérieur de Paré, quand il travaillait à l’Hôtel-Dieu qui ne quitte pas des yeux son élève. La séance commence et le dialogue a lieu exclusivement en latin. Je suis effrayé. Ambroise est incapable de comprendre, encore moins de répondre. Pourtant tout semble se dérouler du mieux possible et mon ami répond aux questions avec lenteur, je dirai même avec application comme s’il cherchait le terme le mieux approprié pour répondre. Je suis maintenant impressionné. A-t-il appris le latin sur le tard ? Mais soudain tout déraille. À une question posée, Paré entame une réponse sans rapport avec la question. Maître Coincterel, apoplectique, s’agite derrière son pupitre, esquissant des gestes de la main qui semblent correspondre à un chiffre…
Paré se tait, tousse et reprend la parole, un peu confus tandis que l’auditoire ne réagit pas et semble ignorer cet égarement. Une heure s’écoule sans que rien de notable ne se passe. Au terme de cette confrontation, les maîtres en chirurgie accordent le bonnet de maître à mon ami à la majorité malgré ses contempteurs de la gent médicale.
Paré quitte la salle sous les applaudissements nourris de la salle après avoir balbutié, toujours en latin, les remerciements habituels.
Je retrouve mon ami à la sortie de la confrérie. Maître Coincterel attend avec moi, ravi de voir son brillant élève si justement récompensé.
Paré nous étreint en nous rejoignant, le visage radieux et l’œil brillant, semblant ravi d’avoir joué un vilain tour à ces messieurs les médecins et mes deux confrères s’esclaffent bruyamment en se congratulant.
— Ils n’y ont vu que du feu, mon cher Vincent, conclut Ambroise, un peu calmé.
— Ils ont pourtant changé l’ordre des questions, reprend maître Coincterel, retrouvant son sérieux.
Je comprends aussitôt de quoi il s’agit. Ambroise n’a pas appris un mot de latin, têtu comme il est et toujours aussi convaincu de l’inanité d’un tel effort. Les questions-réponses venant invariablement dans le même ordre, il s’est contenté d’apprendre par cœur les réponses à fournir ! Je participe immédiatement à leur joie, aussi enchanté que mes compères du bon tour joué à la Faculté de Médecine sous la houlette de Vincent Coincterel, l’instigateur de cette supercherie.
Photo : Couvent des Cordeliers
Jean-Jacques Hubinois / Vésale, le trublion de la Renaissance /Amazon









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer


























 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur