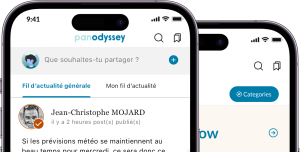6- Départ pour Paris (1533-1536)
 23 min
23 min
6- Départ pour Paris (1533-1536)
. Je suis horrifié dès ma première journée par l’étalage de cette déchéance humaine, abandonnée à son sort. Pour comble de malheur, quelques mois après mon arrivée, Paris, une nouvelle fois, est frappé par une poussée de peste, la même que celle de 1348 qui fit, dit-on, près d’un mort sur deux dans toute l’Europe. Cette nouvelle épidémie fait suite aux prémices survenues deux années plus tôt dans la capitale. Elle semble maintenant vouloir s’installer et prendre une autre ampleur. Mais un malheur apportant parfois une heureuse conclusion, je fais un matin dans ce contexte une rencontre opportune dans le service de Maître Coincterel. Dans une salle voûtée où résonnent les gémissements des pestiférés, où larmes et puanteur sont le lot commun de chaque moribond regroupé là, deux jeunes compagnons chirurgiens de mon âge sont penchés sur un mourant parcouru de frissons dont les aisselles et le cou laissent apparaître de volumineux bubons sur lesquels s’interrogent mes deux apprentis-chirurgiens. Je n’ai encore jamais vu de peste bubonique, mais je comprends à leur discussion que ce patient en est atteint. On sait maintenant que la maladie se propage dans un contexte d’insalubrité publique, d’atmosphère viciée et de promiscuité faisant fuir à la campagne ceux qui peuvent se le permettre, les autres se claquemurant chez eux, refusant tout contact avec la population. On va jusqu’à créer des Prévôts de santé, qui s’enquièrent des maisons infectées, séparent les malades des personnes saines, marquent d’une croix blanche les maisons abritant des pestiférés et veillent à ce que les domestiques n’en sortent qu’avec une verge blanche à la main. Une multitude de rats morts jonchent les pavés sans que l’on ait pu expliquer cette étrangeté bien paradoxale s’il s’agit d’une maladie venant de l’ire de Dieu envers les hommes comme semblent l’affirmer les médecins et les religieux, car comment imaginer que ces rongeurs aient eux aussi quelque chose à se reprocher aux yeux de Dieu. Cela semble bien difficile à admettre. Penchés sur l’agonisant, vêtus de leurs habits de ville, portant pour toute protection un linge imbibé de vinaigre et de cannelle qui recouvre leur bouche et leur nez, ils devisent courageusement au lit du malade. L’un d’entre eux tient un bistouri d’une main résolue et s’apprête à inciser ce bubon noirâtre.
— Regarde Thierry comme le cataplasme émollient que nous appliquons depuis deux jours a permis d’amollir cette grosseur. Il nous faut le percer à présent afin d’en faire sortir le mal. Et cette incision doit forcément, selon moi, être pratiquée au point le plus déclive pour s’assurer de son entière évacuation.
— Ne crains-tu pas, mon bon Ambroise, de disséminer l’infection plus loin ?
Le dénommé Thierry qui semble pourtant l’aîné écoute son collègue avec une admiration non feinte. Ambroise ne s’appesantit guère sur les propos de son ami et, d’un geste précis, entaille largement la masse noirâtre qui libère un flot de pus verdâtre qui empuantit encore plus l’air si cela est possible et me fait déguerpir avec un haut-le-cœur. Ces conditions d’hygiène déplorables me choquent sachant que ces déjections vont finir leur course dans le lit de la Seine toute proche, mais que faire d’autre ? Où abandonner si ce n’est dans un fleuve le pus, le vomi et les excréments que ces misérables évacuent ?
Je constate à cette occasion, que je n’ai guère d’allant spontané pour ces gestes in vivo qui me répugnent, alors qu’ouvrir des cadavres en état de putréfaction avancé ne me gêne pas. Il y a là une singulière bizarrerie.
Au bout de quelques semaines, cette nouvelle poussée cesse comme elle a commencé, emportant avec elle quelques milliers de Parisiens et une partie du personnel médical affecté à l’Hôtel-Dieu. Si celle-ci pouvait être la dernière ! J’ai remarqué, comme mes collègues, que cette peste a pris deux aspects bien différents : la forme bubonique que nous connaissons et une forme beaucoup plus redoutable et insidieuse au départ qui se traduit très vite par de la fièvre, une toux incessante accompagnée de crachats noirâtres, une abondante transpiration et la mort s’ensuit généralement en quelques heures. Ces malades ne présentent pas de tumeur bubonique que ce soit à l’aine, au cou ou aux aisselles, mais la contagiosité extrême d’une personne à l’autre plaide pour une même maladie. Mais si là encore Dieu a voulu punir les humains, pourquoi son ire doit-elle prendre deux masques aussi différents ? Et il faut bien avouer que les processions de flagellants qui défilent dans la ville et se sont fouettés pendant trente-trois jours pour conjurer le fléau de Dieu n’ont pas obtenu beaucoup de résultats.
Le désir d’ouvrir ces corps et d’inspecter les poumons me tourmente. Mais aucun de mes maîtres ne m’autorise à effectuer la moindre dissection anatomique bien qu’elles aient pour but de découvrir l’explication de la mort de ces miséreux atteints de ce mal pulmonaire. Comment vouloir soigner un malade si l’on ne cherche pas à comprendre de quoi sont morts ces moribonds ? Les quelques corps que j’ai déterrés dans des cimetières proches de Louvain avec mon ami Gemma m’ont montré à quel point ces dissections sont nécessaires. Mais j’ai l’occasion de surprendre un dialogue entre les deux compagnons-chirurgiens qui avaient drainé le bubon du moribond. Avec l’aval et la protection de leur supérieur, maître Coincterel, ils ont l’intention de pratiquer une autopsie dans les sous-sols de la Faculté. J’ignore toutefois comment les aborder pour qu’ils acceptent ma venue. Je raconterai pourtant comment la chance me sourira. Les journées chirurgicales à l’hôpital se suivent à présent avec leur routine revenue : soin des plaies de toutes sortes, le plus souvent par armes, trépanation, réduction des fractures et des luxations, traitement des fistules.
Il n’est pas rare d’avoir aussi à pratiquer des amputations où, je dois bien le reconnaître, je n’excelle pas, peu tourné en réalité vers ces actes délabrants.
Comme je le disais, l’occasion m’est donnée de me rapprocher des deux compagnons chirurgiens par un événement qui me concerne. J’ai longuement parlé des rares dissections pratiquées rue de la bûcherie par un prosecteur sous la directive d’un maître, imbu de lui, qui entonne par cœur les phrases de Galien en désignant approximativement à l’aide d’une baguette les éléments disséqués. Ce matin-là, mon maître Jacobus Sylvius se trouve sans assistance au collège de Tréguier, le prosecteur étant absent et il se propose de pratiquer lui-même la dissection. C’est alors que tous les étudiants de l’amphithéâtre, sans se concerter, me plébiscitent pour relever le défi et exécuter la dissection. Mes propos, largement répandus, ma notoriété débutante en anatomie, ont piqué leur curiosité et ils veulent certainement me tester.
— Vé-sale, Vé-sale, Vé-sale !
Les voix enflent peu à peu si bien que le maître ne peut plus parler. Quand l’agitation se calme, Sylvius se tourne vers moi et, avec un grand sourire, me désigne de son bras tendu le cadavre allongé sur une estrade en pierre, creusée en ses bords d’une gouttière et d’un orifice déclive par où les liquides sourdent des corps martyrisés pour finir leur course dans une bassine à même le sol. J’admire beaucoup Sylvius que je considère comme le seul vrai anatomiste parmi nos professeurs. L’honneur d’être choisi par mes pairs et accepté du maître me flatte donc beaucoup.
— Mon cher Andréas, veuillez me rejoindre, déposez votre casaque brodée, dégrafez votre pourpoint et retroussez vos manches. Je ne voudrais pas que les fluides qui s’échapperont lors de votre dissection viennent souiller d’aussi beaux habits…
Je ne sais s’il n’y a pas un peu de jalousie ou d’ironie dans ces propos pourtant bien anodins, mais dont le ton pourrait le laisser penser. L’amphithéâtre, en tous les cas, ne se prive pas d’un rire bruyant et communicatif qui emplit la salle, ce qui, je le crains, est le but recherché par mon maître. A-t-il été vexé que, se proposant pour disséquer, la salle ait préféré que je prenne sa place ? Le faste de ma tenue l’a-t-elle exaspéré ? Sylvius est excessivement pingre bien que nanti d’une belle fortune et il vit comme un miséreux. Son avarice est telle, dit-on, qu’elle l’amène à endurer les hivers les plus froids sans se résoudre à allumer le moindre feu. Comme à l’accoutumée, Sylvius propose que l’on s’intéresse aux muscles abdominaux puis aux viscères, organes que l’on examine presque exclusivement. J’incise le cadavre longitudinalement en sa partie médiane de la fourchette sternale à la symphyse pubienne, contournant proprement l’ombilic. Le professeur suit ma progression en nommant brièvement les muscles abdominaux rencontrés que je dissèque parfaitement. La ligne médiane étant avasculaire, je ne rencontre aucun suintement et le travail se fait rapidement. L’aponévrose du grand oblique décollée et réclinée, je découvre son muscle que je détache de bas en haut pour le rabattre latéralement. Dans la salle le silence est total et d’un rapide coup d’œil, je m’aperçois que les regards sont rivés sur mon travail. Sylvius lui-même, d’abord souriant et condescendant, semble désolé que je m’en tire avec autant d’aisance. Les cadavres descendus de leur gibet aux abords de Louvain avec mon ami Frisius et les dissections interdites que nous avions pratiquées en secret dans une masure abandonnée avant de rendre les corps à la terre pour une sépulture digne m’avaient aguerri et ce travail ne rencontrait aucune difficulté pour moi. De la même manière je détache proprement la gaine du grand droit découvrant ces deux faisceaux musculaires épais et parallèles à la ligne médiane que je rabats délicatement à leur sommet après une mise à nu parfaite. Le débit de mon maître s’est accéléré, jetant à peine un regard de temps à autre dans ma direction, récitant en latin comme une litanie les textes de Galien, les enjolivant parfois de remarques personnelles, fruits de ses recherches. Courant derrière ses propos, j’attaque plus en dehors le plan du petit oblique puis du transverse à partir de l’aponévrose profonde du grand droit que je désigne à l’assistance en suivant la récitation de Sylvius qui semble de plus en plus furieux que je ne ressente aucune difficulté à anticiper ses doctes propos, sélectionnant du doigt l’élément cité en latin, en précédant sa baguette qui tombe à chaque fois trop tard. Cette mascarade cesse dès l’instant où j’incise le péritoine et que je récline l’épiploon, découvrant les viscères abdominaux, ce qui libère immédiatement une odeur pestilentielle qui envahit la pièce où nous nous trouvons.
— Merci, Andréas pour votre brillante dissection.
La phrase claque comme un couperet et je n’ai pas le temps de réagir ni remercier Jacques Dubois. Sans autre mot mon maître a quitté les lieux pendant que le bedeau recouvre le cadavre du drap présent. Une fois de plus, nous nous arrêtons à la dissection des plans musculaires sans pousser plus avant l’exploration du contenu abdominal !
Pendant que je me rince les mains à l’aide d’une solution vinaigrée, un concert d’applaudissements qui m’est destiné accompagne ma prestation et un groupe de quelques étudiants se rapproche de l’estrade.
— Félicitations pour ton excellente prestation. Nous sommes loin Thierry et moi d’avoir acquis une telle aisance dans la chirurgie des plans !
En face de moi, s’agitent les deux compagnons médecins rencontrés à l’Hôtel-Dieu. L’homme qui me parle présente un visage sympathique et cherche à engager la conversation. Il est brun de peau, porte une barbe bien taillée et doit avoir quelques années de plus que moi. Son visage est avenant, mais il paraît engoncé dans sa fraise qui pourtant est bien discrète. Son pourpoint, pour partie élimé, me laisse présager qu’il est de petite famille, contrairement à son ami Thierry qui porte de riches vêtements. L’un comme l’autre arborent une tenue sombre et austère qui peut laisser penser qu’ils aient été conquis par la religion réformée.
— Des collègues chirurgiens, j’imagine ?
— Surtout deux nouveaux admirateurs qui t’invitent à une taverne proche pour discuter anatomie !
Nous quittons immédiatement l’ait vicié de cette salle d’anatomie pour remonter au grand jour où un soleil de faïence est en partie voilé par les vapeurs dégagées des étuves des rues voisines et du brouillard qui s’élève des berges de la Seine toute proche. Par contraste, l’air ici nous semble vivifiant et fort agréable. Nous longeons la Seine quelques centaines de mètres en suivant son cours pour nous enfiler dans la rue de la Huchette sur la rive gauche. Sur le chemin j’en apprends davantage sur mes deux condisciples. Le premier et le plus loquace qui m’a abordé dans la salle d’anatomie s’appelle Ambroise Paré. Il vient de Bretagne, issu comme je m’en doutais d’une famille modeste et il loge dans la rue où nous nous trouvons chez l’un de ses frères, Jehan, coffretier à Paris. Cela fait maintenant trois ans qu’il est apprenti-chirurgien à l’Hôtel-Dieu chez maître Coincterel. Quant à son ami, Thierry de Héry, plus âgé que Paré il est en train de faire fortune grâce à l’application de frictions mercurielles dans la grosse vérole, méthode ramenée de la bataille de Pavie alors qu’il soignait dans l’armée du roi François 1er. La rue de la Huchette, comme à toute heure, est animée et les odeurs qui se dégagent des échoppes des rôtisseurs embaument l’air, chassant celles moins ragoûtantes des bouchers et des équarrisseurs dont les déchets viennent parfois souiller les pavés. Les ribaudes sont de la partie en cette fin de journée et lancent des œillades attirantes aux trois étudiants que nous sommes.
Ambroise m’invite à me méfier des larrons, nombreux dans cette ruelle étroite et bondée, où il est si simple de décrocher une bourse dans la plus totale impunité, vu que ces coupeurs de bourses sont passés maîtres dans cet art. Nous nous attablons au cabaret « Au lys d’or » où Ambroise semble avoir ses entrées et peut-être plus si j’en juge par l’empressement que met l’une des serveuses à nous satisfaire.
— Alors, raconte-nous ton parcours, d’où es-tu avec pareil accent et d’où te vient cette faculté à disséquer ? attaque Ambroise dès que nos bières sont servies.
— Je suis Brabançon et j’ai débuté mes études à Louvain avant de poursuivre à Paris…c’est à Louvain que j’ai commencé la dissection des cadavres que nous allions décrocher, un ami et moi, aux gibets voisins. C’est ainsi que j’ai pu me former à la dissection.
Cette conversation se fait en Français, car je m’aperçois vite qu’Ambroise ne parle ni peu ni prou le latin, ce qui constitue un fort handicap pour un barbier-chirurgien qui a l’ambition de poursuivre des études de chirurgie. L’ordonnance de Villers-Cotterêts qui, quelques années plus tard, officialisera le François comme langue parlée dans le royaume, n’est pas encore promulguée.
— On ne peut en effet n’accepter que ce qui est démontrable par la pratique clinique et anatomique, affirme le sentencieux Thierry.
Dessin anonyme: Faculté de chirurgie, rue de l'école de médecine.
Vésale, le trublion de la Renaissance /Jean-Jacques HUBINOIS / Amazon









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer


























 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur