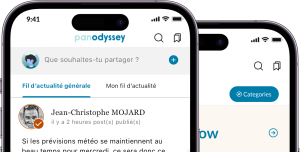La fille de l'architecte ou l'enchantement
 26 min
26 min
La fille de l'architecte ou l'enchantement
La grosse mouche se posa sur l’un des multiples dessins, plans et calques étalés sur la grande table de travail en merisier. L’architecte la chassa d’un revers de main vif tout en maugréant. Quelques secondes plus tard elle atterrit effrontément au beau milieu du plan du théâtre de Besançon sur lequel il travaillait depuis plusieurs heures.
« Ah non ! Encore cette mouche ! » Explosa-t-il tout haut.
-
L’architecte frappa un grand coup avec le plat du té qu’il tenait à la main. Le geste avait été si prompt que l’insecte n’avait pu s’échapper et la violence du coup l’avait écrasée. Une vilaine tache souillait maintenant le dessin minutieux de la façade. L’architecte, en colère, se leva et alla tirer le cordon d’appel des domestiques. Son majordome se présenta quelques secondes plus tard.
.
— Monsieur m’a demandé ?
— Oui Georges. Il y a vraiment trop de mouches ici. Cela fait la deuxième que je tue cet après-midi. Je ne comprends pas, nous ne sommes pourtant pas en été.
— C’est peut-être à cause des chevaux, Monsieur. Depuis que le Prince de Rohan a plus que doublé la surface de ses écuries, on peut y compter une bonne douzaine de chevaux ; et à quatre pas d’ici.
— Sans doute, sans doute. Vous reste-t-il de cette essence de géranium ou de citronnelle ? Il me semble que c’était assez efficace l’été dernier.
— Oui Monsieur. Je vais en asperger les rideaux et les bords de fenêtre. Mais on m’a récemment parlé d’une plante beaucoup plus efficace : le pyrèthre du Caucase, une sorte de chrysanthème dont on fait une poudre avec les fleurs séchées.
— Hé bien, Georges, trouvez-moi cette poudre et nous l’essaierons.
— Bien, Monsieur. Dois-je aussi allumer les bougies, il commence à faire sombre.
— Oui bien sûr, Georges.
.
Le calme était revenu dans le grand bureau. On entendait seulement le clic régulier et feutré du mécanisme d’échappement de la grande horloge comtoise qui trônait au fond de la pièce. L’architecte l’avait ramenée d’un de ses multiples voyages aux salines d’Arc-et-Senans, son grand œuvre, sa cité idéale, dont il avait supervisé la construction dans les moindres détails. De temps à autre on entendait le claquement des sabots des chevaux et le crissement d’une voiture roulant sur les pavés de la Place Royale. On était fin mars et, malgré la hauteur majestueuse des fenêtres qui donnaient sur la Place, la lumière du soir s’assombrissait rapidement. Les lambris de chêne avaient pris une couleur dorée sous les derniers rayons rasants du soleil et les stucs tarabiscotés du plafond s’étaient creusés d’ombres contrastées avant que l’obscurité n’envahisse la place. Georges descendit le lustre central, alluma une à une les bougies, remplaçant celles qui étaient usées, puis il tira sur la chaîne pour remonter le lourd appareillage.
.
— Merci, mon brave Georges. Je vais pouvoir travailler encore un peu avant le dîner.
L’architecte retailla méticuleusement un crayon, tenta de gommer au mieux la vilaine trace laissée par la mouche écrasée et se pencha à nouveau sur son dessin. Un nouvel attelage passa encore bruyamment sous les fenêtres de l’hôtel particulier dont il occupait les premier et deuxième étages. Il repensa au prochain voyage en Italie qu’il voulait faire dès le printemps de cette année 1781. Le crayon à la bouche, il se mit à rêver, le regard errant sur les petits personnages des scènes pastorales de la tapisserie murale qu’il trouvait d’un autre âge. Il entendit grincer la porte donnant sur le couloir qui menait aux appartements et se retourna, pensant qu’il s’agissait à nouveau de son majordome.
— Constance, ma chérie !
— Bonsoir, Père. Votre travail avance-t-il comme vous le souhaitez ?
Constance referma avec soin la porte derrière elle et s’approcha doucement, tête baissée, comme si elle eût quelque chose à cacher ou quelque requête embarrassante. Son visage était d’un arrondi parfait, aux yeux très bleus et allongés, rehaussés de sourcils à peine visibles, au nez fin, et à la bouche souriante. Ses longs cheveux blonds bouclés coiffés à la mode anglaise étaient retenus par un ruban de velours bleu vif dont la couleur tranchait avec le blanc éclatant de sa robe. Elle était maintenant contre le bureau de son père. Cherchant ses mots, elle se saisit machinalement d’une très jolie tabatière en or qui retenait un des angles d’un plan d’architecture. Instantanément celui-ci s’enroula tel un ressort.
.
— Constance, mon enfant, ce n’est pas un jouet ! Repose cette tabatière, je m’en sers pour tenir les papiers.
— Mais, Père, je ne jouais pas et je…
— Repose-là, te dis-je. De plus j’y tiens énormément. C’est un cadeau que m’a fait Madame du Barry lors de ma dernière visite à Louveciennes…
— Madame du Barry, Madame du Barry, pff !, coupa Constance, avec un brin d’insolence. Vous ne cessez de nous parler d’elle. Auriez-vous oublié votre propre femme et vos enfants ?
— Ecoute, petite fille : c’est à elle que je dois ma carrière et ma nomination comme Commissaire des Salins de Franche Comté. Et si tu bénéficies de la meilleure éducation qui soit, des meilleurs précepteurs de Paris, de cette belle maison, Place Royale, de cette domesticité, et aussi de ces belles robes que tu portes, c’est beaucoup grâce à elle. Tu devrais donc avoir un peu plus d’égards à son sujet.
— Pardon Père si je vous ai blessé. Mais vous me parlez comme à une enfant. Avez-vous oublié que j’ai quinze ans dans trois jours ? Je suis une femme ! Et vous devriez même me voussoyer, désormais.
— Mon Amour, pardonne-moi mon emportement. Mais tus sais, heu,… vous savez, belle demoiselle, vous serez toujours ma première petite fille jusqu’à ma mort. Au fait, tu… vous vouliez me demander quelque chose ?
— Oh oui Père, répondit Constance, un élan d’enthousiasme dans la voix. Voilà : depuis quelque temps vous parlez de retourner en Italie pour approfondir vos connaissances de l’architecture grecque…
— Oui, en effet, il s’agit des ruines de Paestum, que j’ai déjà visitées il y a une dizaine d’années. Les fouilles avaient commencé il y a trente ans et quelques restaurations sommaires avaient été effectuées. Mais je pense que depuis mon dernier voyage de nouvelles merveilles ont dû être révélées. Je dois absolument y retourner pour mener à bien mon projet du théâtre de Besançon. Le gros œuvre est déjà très avancé et je dois faire vite.
— Père, emmenez moi !
.
Constance avait mis tant de détermination dans sa requête que son père en eut le souffle coupé. Il se leva et fit le tour de la table de travail, réfléchissant tout en mâchonnant son crayon.
.
— Hé bien, si tu… si vous insistez… et si votre mère est d’accord, je vous emmène.
Constance, folle de joie, se jeta dans les bras de son père et l’embrassa. A cet instant Georges entra dans la pièce un journal à la main.
— Oh ! Excusez-moi, Monsieur, je voulais vous informer que le dîner est prêt. Et voici votre Gazette de l’Europe.
— Merci Georges, répondit L’architecte. Ne vous excusez pas, c’est tout naturel qu’un père embrasse sa fille.
Puis il commença à feuilleter son journal.
— Ho ! Incroyable ! Constance, écoutez ça : un savant anglais, William Herschel vient de découvrir une septième planète qu’il a nommée Uranus, comme Uranie, la muse de l’astronomie. N’est-ce pas merveilleux de constater que notre univers de connaissances s’élargit chaque jour grâce à des hommes passionnés et talentueux ? Une septième planète ! Voilà qui me met de bonne humeur, j’adore le chiffre sept.
* * *
.
C’est ainsi que deux semaines plus tard Claude-Nicolas Ledoux, architecte de la Ferme Générale, membre de l’Académie Royale, et sa fille Constance, foulaient le sol de Salerne, la grande ville la plus proche des ruines de Paestum, l’ancienne Poséïdonia.
.
Dès le lendemain de leur arrivée, très tôt le matin, ils affrétèrent une voiture pour se rendre à Capaccio, le village jouxtant le site de Paestum. Le soleil était très vif pour un mois d’avril, surtout à cette heure matinale, et Constance, qui avait peu voyagé jusqu’alors, était émerveillée de ces paysages doux et rugueux à la fois, de ces pins parasol magnifiques, de ces oliviers torturés, des mille espèces d’herbacées courant entre les rochers : lavandes sauvages, thyms, myrtes et ajoncs qui longeaient le chemin. Jamais elle n’avait vu palette de couleurs si riche et si variée : des tons pastel s’étalant du bleu gris des oliviers au vert sombre des ifs. La couleur du sol, elle, variait du blanc vif des allées sablonneuses aux couleurs rouille de l’argile. Après avoir franchi l’une des quatre portes de l’enceinte, Claude-Nicolas et Constance aperçurent le majestueux ensemble formé par le temple de Neptune et celui dédié à Héra, nommé la Basilica. Ils s’arrêtèrent à proximité de cet édifice, à l’ombre d’un grand pin. Claude-Nicolas commença à installer son matériel, aidé par Constance. Puis il déploya un grand carnet à dessin pour croquer certains détails des colonnes de cette Basilica. Constance s’était peu à peu éloignée, curieuse et fascinée par tant de richesses architecturales. Elle s’était dirigée vers des tombes en forme de maisonnettes de pierre couvertes de lauzes. Au loin, on entendait des ouvriers s’affairant à dégager les gradins de l’Ekklesiasterion, une sorte de petit amphithéâtre circulaire où était rendue la justice. L’une des tombes semblait plus grande que les autres. Sans doute était-ce celle d’un grand personnage. Elle y pénétra par une porte de pierre, très basse, et attendit un moment pour adapter sa vue à la pénombre. Pour se donner du courage, elle chantonnait une aria de l’opéra Aucassin et Nicolette de Grétry qu’elle avait vu avec son père l’année précédente à la Comédie Italienne. A peine avait-elle pénétré dans l’antichambre du tombeau qu’elle entendit un sifflement reprendre en écho sa propre mélodie. Constance, intriguée, avança prudemment en questionnant :
« Il y a quelqu’un ? ».
Mais aucune réponse ne lui parvint. Personne devant elle, ni à gauche, ni à droite. Toutefois, il lui semblait percevoir le vacillement d’une flamme dans une chambre dont l’entrée se situait en face d’elle. Le sifflement continuait à se faire entendre. Soudain, elle sentit une main sur son épaule et frissonna. Elle se retourna brusquement et vit un jeune homme bizarrement habillé d’une sorte de tunique blanche, de semelles à lanières, d’une cape en peau de mouton, blanche également, et tenant à la main droite un gros pinceau.
.
— Bonjour Mademoiselle, dit-il en latin puis en dialecte napolitain. Je m’appelle Pythodôros, et vous ?
— Mon nom est Constance, répondit-elle, rassemblant ses connaissances d’italien, un brin d’inquiétude dans la voix. Je viens du royaume de France, de Paris. Mon père est architecte. Mais que faites-vous ici dans cet accoutrement ?
.
Pythodôros regardait Constance avec un sourire gentil. Son visage était très clair et entouré de jolies boucles brunes retenues par un ruban. Son nez était droit et fin, presqu’en prolongement de son front. Constance se sentait un peu rassurée par la douceur du regard du jeune homme et ne semblait pas insensible à sa beauté.
.
— Hé bien je termine la fresque que j’avais commencée il y a… quelques siècles.
— Comment ça « quelques siècles » ? Et de quelle fresque parlez-vous ? Vous moquez-vous de moi ?
— Venez, répondit Pythodôros, saisissant la main de la jeune fille.
.
Constance le suivit à l’intérieur de la chambre mortuaire. Une torche éclairait la pièce et l’on pouvait découvrir une magnifique peinture murale représentant une rivière, un arbre dénudé et un plongeur sautant du haut d’une colonne. Constance était émerveillée. Le sol était jonché d’une dizaine de petites coupelles en terre cuite contenant chacune une couleur. Et à côté, une jarre d’huile. Elle regarda Pythodôros, pleine d’admiration et s’adressa à lui.
.
— C’est magnifique ! C’est vous qui avez peint cette fresque ?
— Oui, ma belle. Je suis le peintre Pythodôros, élève de Phidias, déclama-t-il une main à plat sur son torse. Je suis Grec comme lui et suis venu ici lorsque les Lucanii ont chassé les Sybarites. Un grand archonte est mort et j’ai été désigné en ce temps là pour décorer sa chambre mortuaire afin qu’il repose en paix. Vous voyez, le plongeur ? C’est une allégorie. C’était mon idée. Cela représente le passage de la vie à la mort : au-dessus, les cieux ; en bas, le fleuve Léthé. Malheureusement, je n’ai pu la terminer à l’époque parce que… la guerre… la mort… tout ça…
.

.
— Mais… Phidias vivait il y a plus de deux mille ans ! Qu’est-ce que c’est que toute cette histoire ? Interrompit Constance.
— Oh, je savais bien que vous ne me croiriez jamais, répondit Pythodôros, le regard perdu vers le sol. Vous pensez sans doute que je suis fou ou faible d’esprit. C’est ça ?
— Non, ce n’est pas ce que j’ai voulu dire… Enfin… C’est quand même très étrange ce que vous me racontez là et…
Constance entendit la voix lointaine de son père qui l’appelait. Pythodôros mit son doigt sur la bouche de Constance et dit :
« Chut ! Au temple de Neptune ! »
Puis il posa son doigt sur sa bouche comme pour un baiser.
.
Constance sortit de la tombe tout émue et confuse. Il lui semblait que le temps et l’espace s’étaient mélangés. Elle ne savait plus très bien où elle était ni à quelle époque. Comme si elle avait subi une sorte d’enchantement. Son père continuait à l’appeler mais elle ne répondait pas, marchant à l’instinct vers lui. Lorsqu’il l’aperçut, il l’appela à nouveau plus fort pour attirer son attention et vint à sa rencontre.
.
— Constance, mon enfant ! Où étiez-vous, je me faisais du souci. Mais vous semblez toute retournée. Allez-vous bien ? Il passa son bras affectueusement autour d’elle.
— Oui Père. Mais j’ai l’impression d’avoir fait un rêve, éveillée. J’ai vu dans cette tombe une peinture magnifique… Ou alors est-ce le fruit de mon imagination.
— Une peinture ? Montrez-moi cela. Les peintures grecques sont si rares car elles ont, pour la plupart, été détruites par les mousses et les lichens et n’ont pas traversé les siècles comme les sculptures ou les monuments.
.
Constance et son père se dirigèrent alors vers la tombe qu’elle avait visitée. Claude-Nicolas pénétra le premier et traversa l’antichambre puis entra dans la chambre mortuaire. Le noir total ne lui permettait pas de distinguer quoi que ce soit. Il sortit une bougie de la besace qu’il portait en permanence avec lui, et l’alluma. La lumière vacillante, bien que faible, laissait deviner une magnifique peinture. Constance chercha du regard la torche et les coupelles de couleurs mais il n’y avait rien qui ressemblât à ces objets qu’elle avait pourtant vus. Nulle trace non plus de Pythodôros. Son visage se troubla.
.
— Cette peinture est vraiment très ancienne et pourtant si bien conservée ! C’est incroyable. Rendez-vous compte, Constance, que ces monuments datent de plus de quatre cents ans avant Jésus-Christ ! On jurerait qu’elle vient d’être peinte par endroits. Il faut absolument que je recopie cela. On dirait un plongeur ! Comme c’est curieux.
— Père, aviez-vous besoin de moi ?
— Non, je voulais juste vous rappeler qu’il est l’heure de nous restaurer. Mais avant, il faut que je note tout ça. J’ai laissé les provisions près du temple. Allez m’y attendre, je vous rejoindrai.
.
Pendant que Claude-Nicolas tirait de sa besace un petit carnet et un crayon, Constance sortit du tombeau et se dirigea vers le temple de Neptune. Malgré ses dimensions imposantes, l’ensemble architectural lui apparut bien proportionné et élégant. Elle gravit les quelques marches puis déambula sous le péristyle, pensant au doux visage de Pythodôros. Soudain au détour d’une colonne Pythodôros surgit, la faisant sursauter.
.
— Vous m’avez fait peur. Ce n’est pas gentil. Mais où étiez-vous passé ? Et vos coupelles de peinture, l’huile, la torche ? Tout avait disparu quand j’ai voulu montrer votre fresque à mon père.
— Je ne peux rien vous dire. Seulement que je suis bien ici avec vous. Faisons quelques pas ensemble à l’ombre de ce péristyle, vous voulez bien ?
— Tout de même, vous me semblez très mystérieux.
.
Constance et Pythodôros marchaient lentement. Parfois celui-ci passait de l’autre côté d’une colonne et surgissait tel un diablotin d’une boîte, ce qui la faisait éclater de rire. D’autres fois, il lui prenait les mains, les embrassait, sautillait et tournait en passant son bras au-dessus d’elle. On aurait dit deux enfants. Claude-Nicolas était maintenant revenu et appelait Constance. Une nouvelle fois Pythodôros passa derrière une colonne et… disparut. Constance fit le tour de la colonne : personne. Il était impossible que Pythodôros se volatilisât comme par enchantement.
« Oui, Père ! Je suis là. Je vous rejoins » répondit-elle une fois revenue de sa stupeur.
Elle descendit les marches et se dirigea vers le temple d’Héra où son père l’attendait.
.
— Que faisiez-vous toute seule sous ce péristyle à sauter comme un cabri et à rire.
— Mais, Père, je n’étais pas toute… Je riais parce que je suis heureuse d’être avec vous et puis, toute cette beauté me rend d’humeur légère.
— Je vous propose de déjeuner sous ce porche, voulez-vous ?
.
Constance s’était rendu compte que son père l’avait crue seule, ce qui expliquait à ses yeux la bizarrerie de son comportement. Comment n’avait-il pas aperçu Pythodôros, au moins une fois entre deux colonnes ? Tout ce mystère rendait Constance songeuse. Au point que son père le remarqua et lui en fit la remarque. Elle sortit alors de ses pensées et lui sourit avec beaucoup de tendresse.
.
L’après-midi se déroula tranquillement. Claude-Nicolas étudiait sans relâche tout ce qui pouvait l’aider dans la conception du théâtre de Besançon et, d’une façon générale, dans son art. Constance se promenait au gré de sa curiosité. Elle imaginait la vie à l’époque grecque puis à l’époque romaine dont on venait de dégager d’autres vestiges. Lorsque le soleil se fut caché derrière l’horizon, Constance et son père organisèrent une couche sous deux magnifiques pins parasols à l’aide de grosses couvertures. En effet, Claude-Nicolas voulait profiter des premières lueurs du matin pour continuer ses travaux de dessin plutôt que de rentrer à Capaccio. Le temps était doux et clair et promettait une nuit parsemée d’étoiles. La fatigue aidant, père et fille s’endormirent très vite, bien serrés l’un contre l’autre pour combattre le froid mordant de la nuit calabraise. Claude-Nicolas fit quantité de rêves dans lesquels se mêlaient Paris, Arc-et-Senans, Louveciennes, Besançon et toutes ses œuvres. Constance, elle, ne rêva que du beau Pythodôros. Elle revoyait sans cesse les images de sa promenade joyeuse sous le péristyle du temple de Neptune, la façon dont il lui baisait les mains, son sourire, sa douce fantaisie. La nuit fut calme et sereine à tous deux.
.
Dès l’aube, Claude-Nicolas se leva en s’étirant. Il lui restait encore à étudier les gradins de l’Ekklesiasterion dont l’acoustique avait quelque chose de magique. Etait-ce la qualité de la pierre, sa forme, les petites cavités disposées sous chaque gradin ? Cela lui semblait important pour bien concevoir l’intérieur du théâtre de Besançon. Déjà avait germé dans sa pensée l’idée révolutionnaire que chacun, quelque soit sa condition, puisse être assis et profiter du spectacle. Il voulait aussi disposer l’orchestre non plus sur la scène, mais dans une fosse entre acteurs et spectateurs, et il réfléchissait au moyen d’installer une machinerie de scène. En étudiant les dramaturges grecs, il avait appris que cela avait existé quelques deux mille ans auparavant. Il posa un regard plein de tendresse sur Constance. Elle dormait en souriant et il la trouva belle. Il se sentait fier d’avoir une fille aussi gracieuse qu’elle. Puis son regard fut attiré par un éclat doré autour de son cou. Il s’approcha et souleva délicatement le haut de la couverture en tentant de ne pas la réveiller.
.
— Qu’y a-t-il ? cria Constance, réveillée en sursaut.
— Pardon, ma chérie, je ne voulais pas vous réveiller. Juste voir ce collier…
— Quel collier, Père ? Je n’en ai point amené. Puis, passant la main autour de son cou : mais qu’est ceci ? Un cadeau de vous, mon père ?
— Mais non, mon enfant, pas du tout ! Oh, ce n’est pas que je n’aimerais pas vous faire de cadeau. Faites-moi voir. C’est extraordinaire, on dirait… Mais oui, c’est bien un collier de l’époque attique. Ici de l’or et là, ce sont des émeraudes. Magnifique bijou ! Quelle beauté ! Où l’avez-vous trouvé ?
— Père, je peux vous jurer que je n’ai ni trouvé, ni volé ce collier, que ce soit dans les vestiges des temples ou dans les tombes funéraires. Comment est-il arrivé autour de mon cou ? Mais alors, serait-ce peut-être…
.
Constance se redressa d’un bond sur sa couche, se frotta les yeux et balaya l’horizon du regard. A cinquante pas, adossé à une colonne du temple d’Héra, Pythodôros se tenait debout, guilleret comme un enfant, et lançait des brassées de baisers en direction de Constance. Elle souleva un peu la main, s’assura que son père avait son attention sur le collier, et fit un léger signe discret de la main. Claude-Nicolas, curieux du geste de sa fille, porta alors son regard dans la même direction que celui de Constance mais il ne vit que les robustes colonnes commencer à prendre une couleur de miel au fur et à mesure que le jour se levait.
.

.









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer






































 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur