
22. La Légende de Nil - Jean-Marc Ferry - Livre I, Les Diamants de Sarel-Jad - Chapitre IX, 1, 2
 20 min
20 min
22. La Légende de Nil - Jean-Marc Ferry - Livre I, Les Diamants de Sarel-Jad - Chapitre IX, 1, 2

Oramûn comptait embarquer sans attendre pour Is, puis Syr-Massoug. Mais Ferghan insistait pour qu’il demeure quelques jours encore sur Sarel-Jad. Il tenta de persuader Oramûn de faire une randonnée à trois :
— Ôm sera notre guide. Hormis les chiens sauvages en grande meute, elle ne craint pas les animaux, pas même les lions géants. En la suivant, on apprend beaucoup. Si tu veux, elle nous mènera de l’autre côté de la plaine. Asber m’a assuré que les diamants s’y trouvent ; peut-être dans le ventre de l’un des volcans qui dominent la lisière forestière. J’ai récupéré les ceintures des trafiquants. Nous aurons ce qu’il faut pour le voyage : fléchettes, couteaux, haches, massues, et des cornes d’appel. Et puis, tu devais ramener Asber à Syr-Massoug, je crois…
Ôm surgit à ce moment. De moi, Nil, qui vous conte ma légende, sachez que, depuis qu’ils s’aiment, Ôm ne quitte pas Ferghan. Ensemble ils ont déjà parcouru la grande plaine. À la façon d’un jeune chat, elle se mit à frôler les hanches de Ferghan avec son flan, en va-et-vient, puis leva son visage vers lui avec insistance. Elle avait envie de jouer. Ferghan aussi, mais, devant Oramûn, sa dignité l’en empêchait. Il regarda Ôm et lui parla doucement. Elle écoutait avec attention et parut comprendre, puis elle partit comme une flèche en direction du Nord. Ferghan lui emboîta aussitôt le pas. Oramûn n’avait plus qu’à suivre. La progression était dictée par Ôm, un parcours atypique, qui, aux yeux d’Oramûn, ne ressemble en rien à une exploration « humaine ». Ôm lui paraissait zigzaguer de façon rhapsodique, mais elle sait manifestement où elle va. Oramûn s’attacha à mémoriser chaque geste d’Ôm. En fait, sa progression dans la plaine est jalonnée d’innombrables petits actes : regarder, toucher, sentir, écouter, et percevoir d’autres choses encore. Alors qu’Ôm semblait leur imposer mille et cent détours, Oramûn fut stupéfait, à la tombée du jour, de constater le chemin parcouru. Il en aurait accompli à peine plus de la moitié avec ses compagnons.
Le soir venu, ils allumèrent un petit feu entre cinq pierres. Ferghan apporta des grenouilles dodues qu’ils firent griller à l’aide de ces broches de fortune que les acacias offrent en abondance. On entendit le rugissement-feulement d’un grand lion de la plaine. Ôm écoutait, laissant s’épanouir sur son visage une expression de béatitude. Pourquoi ?
— Et pourquoi ne parle-t-elle pas comme nous ?
Oramûn ne put retenir la question.
— Notre langage la fait rire. Elle le moque, parfois : « nolalalalanola», dit-elle en chantant. Pour elle nous ne disons rien de réel. Nous racontons un rêve. Ça la remplit d’étonnement, et ça l’amuse. Au début, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends.
— Que comprends-tu, Ferghan ?
— Qu’en pensant comme nous pensons, au fond, nous parlons, nous ne faisons que parler. Nous nous disons nous-mêmes. Nous enchaînons des phrases : « nolalalalanola… ». Mais le monde n’est pas une phrase, ni plusieurs, ni toutes nos phrases. Ôm pense qu’elle touche le monde avec sa voix. Elle dit des choses du monde, parce qu’elle les appelle, les mime, les provoque… C’est sa manière à elle, la manière qu’a son langage d’être rivé aux êtres. Il imite leur comportement, danse avec eux. À côté de cela, notre langage à nous raconte nos pensées. Il fait récit de ce que nous comprenons.
Oramûn n’attendait pas une telle réponse de Ferghan. À son tour de devoir comprendre l’humanité de Ôm. Il la regarda qui venait de s’endormir.
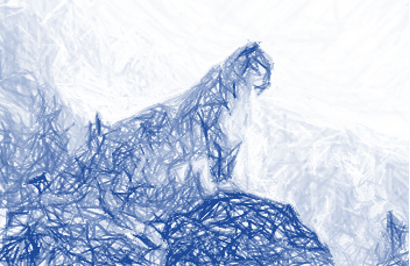
La chaleur fut torride dès le lendemain matin. Ôm tournait autour des deux hommes qui s’éveillaient juste. Elle veut reprendre le voyage. La plaine est comme écrasée par le soleil. On ne voit pas d’animaux. Ôm progresse plus lentement que la veille, elle semble surveiller davantage. Une troupe de grands lions dormait non loin, et ce fut la fête : Ôm se précipita vers eux, chantant et gesticulant. Elle s’arrête, se courbe, se penche d’un côté et de l’autre, saute sur place.
Les bébés lions ne dormaient pas. Les lionnes se contentent d’ouvrir un œil pour le refermer. Le grand lion se montra plus éveillé, ne quittant pas Ôm des yeux, qui, subitement, court vers lui. Elle lui parle en dansant, tandis qu’avides de jeu les lionceaux se prennent dans ses jambes. Mais l’agilité d’Ôm est telle qu’on dirait que ses pieds ne touchent pas terre, comme voltigeant sur un matelas tourbillonnant de poussière. Oramûn et Ferghan eurent peur, quand Ôm passa en virevoltant tout contre l’énorme tête du lion ; et ils eurent plus peur, encore, lorsqu’elle se jeta à son cou, tentant de ses petits bras d’entourer l’épaisse crinière… Mais le grand lion semblait à son aise. Il se hissa, d’abord sur ses pattes de devant, puis sur celles de derrière. Ôm se tenait auprès de lui, elle lui arrivait à l’épaule. C’est alors que Ferghan et Oramûn purent mesurer le gigantisme de l’animal. Les lionnes finirent par se réveiller, moins avenantes. L’une d’elles est hargneuse. Elle voit d’un mauvais œil que ses bébés jouent avec Ôm. Elle se lève en grognant, agressive à l’endroit d’Ôm qui se réfugie contre le lion. Puis, comme s’il y allait de son honneur, Ôm marche vers la lionne, lui parlant avec fermeté. C’est qu’elle n’apprécie pas d’être soupçonnée de quelque malveillance à l’égard des lionceaux. Elle « argumenta » son courroux jusqu’à ce que la lionne, lassée de l’explication, se fût rassise.
Les deux hommes étaient éberlués, et Ferghan presqu’autant qu’Oramûn. Tout s’est déroulé dans une perfection d’harmonie, grâce à quoi, d’ailleurs, la scène improbable put s’accomplir sans incident, comme si rien n’était plus naturel. La seule dissonance, durant la traversée de la plaine, fut marquée par le passage d’une petite meute de chiens sauvages. Ils étaient affamés et comme fous. Ils se jetèrent sur le petit groupe. Ferghan et Oramûn eurent juste le temps de lancer leurs fléchettes. Chacune porte à son but. À chaque impact, on entendait un bref hurlement de douleur. Les fléchettes étaient lancées avec vigueur et adresse. Elles s’enfonçaient profondément dans la chair, et les chiens finirent par abandonner leur harcèlement. Plus loin, Ôm avait perçu la présence d’une meute autrement conséquente : près de soixante-dix têtes au lieu des huit individus de la petite meute. La réaction fut instantanée : Ôm bifurque et, se courbant au point que son ventre paraît toucher la terre, elle se met à courir en ondulant avec une célérité sidérante, à la façon d’un varan. Les deux hommes suivirent comme ils purent, s’efforçant d’imiter le « reptile ». Au bout de quelques minutes ils étaient hors de vue et d’odorat des chiens sauvages.
En progressant vers le Nord en direction de la forêt qui borde les volcans, la grande plaine remonte. Oramûn réalisa qu’elle doit sans doute sa forme presque circulaire au fait qu’elle serait un gigantesque cratère peut-être causé par l’écrasement d’un astéroïde. En arrivant à la lisière forestière, il constata que les ramifications de la rivière ont disparu sous terre. Ôm humait l’air devenu plus frais. D’un environnement de savane on était passé à la végétation d’une forêt primaire semi-tropicale, en bord de plaine. Mais, en gagnant les montagnes, la forêt devient plus sombre et froide. Des mousses et fougères tapissent le sol, de grands résineux abritent une faune plus familière à Ferghan qui a passé son enfance à parcourir les forêts profondes des Terres noires, à la frontière occidentale des Terres bleues, près du grand fleuve. Les deux hommes et la jeune femme établirent leur campement contre la caverne d’un rocher. La nuit venue, on entendit le râle d’un félin ; sans doute, une panthère argentée. Oramûn en avait entrevu la silhouette de loin. Sa fourrure presque angora éclatait sous le soleil, juste au-dessus de la lisière forestière, à flanc de montagne. Les deux hommes se sentirent frais, au lendemain, leur sommeil n’ayant été troublé qu’à deux reprises par les vaticinations d’une harde de sangliers. Quant à Ôm, comme à l’habitude, elle les attend, pressée de continuer la route.
Enfin, le groupe atteignit la zone des grottes souterraines, là où se pourraient trouver les diamants. Ôm menait la troupe. Non que cela ait été concerté. Mais elle se dirigeait avec une telle sûreté, bien qu’avec la même aversion pour les lignes droites, que Ferghan et Oramûn lui firent confiance, s’en remettant chez elle à un sens qui leur échappe. Elle se redressa brusquement, aux aguets, pencha la tête pour écouter, à gauche, la tourna lentement vers la droite. Ses yeux s’ouvrirent tout à coup plus grands. Elle regarda fixement en direction d’un point invisible et, pour la première fois, se dirigea résolument tout droit, faisant signe aux deux hommes de la suivre. Le groupe entra dans une caverne à flanc de montagne. Ôm, toujours, les guidait. Elle s’engagea avec eux dans une galerie sombre. On entendit un bruit d’eau qui tombe en flaques. Le sol est glissant et froid. Ôm s’arrêta encore, se faisant réceptive aux moindres signes censés la guider vers un objectif encore inconnu… jusqu’à ce qu’enfin elle tombe en arrêt devant une sorte de grand toboggan ; probablement, le lit d’une ancienne cascade. Il plonge en pente raide sur plusieurs mètres. Ôm s’allongea au bord, appuyée sur les avant-bras, et penchant la tête dans le couloir, comme pour déceler un appel, tourna le visage vers les deux hommes :
— Quelqu’un se trouve au fond !
C’est ce que voulait dire son visage. Oramûn comprit le message aussi clairement que Ferghan. Il se précipita aux côtés d’Ôm, tendant l’oreille vers le fond du couloir. Il n’entendait rien, mais Ôm se faisait insistante. Ferghan intervint :
— Ôm me dit être certaine qu’un homme appelle.
C’est Oramûn qui prit la décision : il faut descendre au fond du gouffre. Mais comment ? Or Ferghan et lui ont à leur ceinture les matraques prises aux Aspalans. Elles sont tissées de fibres solides, assemblées très serrées. En les déliant, on obtient des cordes. Mises bout à bout, on aurait une bonne longueur. Oramûn appela par trois fois. À la troisième, on entendit une voix d’homme. C’était Asber. Péniblement, un dialogue s’engagea. Oramûn prévint Asber qu’une corde lui sera jetée. Par chance, elle atteignit le fond du gouffre. En vieux marin, Asber eut vite fait de se la nouer solidement à la taille, et les deux hommes le remontèrent. Après avoir recouvré quelques forces, il raconta :
— Zaref m’a poussé dans le gouffre. Il voulait que je meure lentement d’inanition et de froid. J’ai pu m’alimenter un peu avec des insectes et des larves, mais j’étais certain de mourir. Qui aurait pu me trouver ici ? Et comment ?
Le regard d’Asber se fixa sur Ôm.
— Je comprends. C’est elle, bien sûr.
Asber ferma les yeux, épuisé. Il était couvert de meurtrissures, bleus et plaies sur les bras et le torse.
— Zaref, en partant, m’a jeté des pierres. J’ai cru qu’il voulait me lapider. Mais il cherchait juste à me faire mal. Il est parti en me souhaitant de mettre longtemps à mourir.
Oramûn voulait cependant savoir où se trouve le port d’attache de Zaref à Sarel-Jad ; où il amarre ses navires ; où il stocke ses pierres précieuses, singulièrement les diamants.
— Il faut cheminer au long de la galerie que vous venez d’emprunter. Avant le lit de l’ancienne cascade, il y a une bifurcation. On prend à droite et on suit la galerie principale. C’est comme un raccourci. Au bout de trois heures de marche continue, on parvient à la mer : une caverne vaste et haute, très vaste, très haute. Zaref y a ses caravelles. Quant aux diamants, je ne sais pas… Il a dû les charger sur un des navires. J’ignore quelle direction il a prise. J’étais au fond du trou ! Je ne sais pas non plus s’il a pu trouver Nïmsâtt. J’espère que non.
— Nïmsâtt ?
— C’est l’épouse de son père défunt. Elle est à peine plus âgée que Zaref… Nïmsâtt aimait tant son mari, un homme très savant. Il me disait qu’elle est plus savante que lui. Il faut la protéger contre Zaref.
Oramûn estima qu’il n’en saurait pas davantage d’Asber. Mais il tenait à le ramener avec lui, ainsi que le lui avait demandé Almira. Le plus simple est de suivre la galerie qui mène aux navires de Zaref. Là, il prendrait une caravelle. Tant pis pour le catamaran qu’il avait garé tant bien que mal dans le chenal des hautes herbes, à la jonction occidentale des deux massifs ! Il irait en reprendre possession plus tard. Beaucoup plus pénible fut pour lui de renoncer à faire escale à Is. Oramûn pensait sans cesse à Yvi. Son image ne le quittait presque jamais. Dans ses rêves, il la voit son épouse, en entente si intime et confiante avec elle que tout son être se sent saisi d’un amour profond que rien ne saura éteindre. Cependant, Oramûn admettait qu’il lui faut à présent se rendre à Syr-Massoug sans tarder davantage. Quant à poursuivre Zaref, cela n’a pas grand sens, tant que l’on ignore sa destination. L’essentiel, pour l’immédiat, est de pouvoir contrer ses plans.









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Beitragen
Beitragen










































 Du kannst deine Lieblingsautoren unterstützen
Du kannst deine Lieblingsautoren unterstützen





