
Chapitre 11 : Entre ombre et lumière
Su Panodyssey puoi leggere fino a 10 pubblicazioni al mese senza effettuare il login. Divertiti 9 articles da scoprire questo mese.
Per avere accesso illimitato ai contenuti, accedi o crea un account cliccando qui sotto: è gratis!
Accedi
Chapitre 11 : Entre ombre et lumière
Dès lors, les tensions dans mon cou se sont, quelque peu, dénouées. J’avais le sentiment d’avoir pu m'alléger du fardeau que je portais, je l’avais confié. À la police certes, et une part de moi sait que l’affaire sera probablement classée, si toutes les preuves patiemment accumulées leur semblent trop minces, s'ils jugent que ce n’est pas vraiment grave, qu’il n’y a pas eu de crime ou de délit, que sais-je ? Mais je n’étais plus la seule dépositaire du fléau qui me collait à la peau, et d’une certaine manière, ça me soulageait. À ce moment-là, je ne craignais plus la suite. Je me sentais en paix, auréolée de cette harmonie fragile que l’on puise dans le sentiment d’avoir fait ce qu’il fallait. Du côté du “stalker”, c’est le calme plat, il semble presque m’avoir oubliée… Derrière les éclats de son masque d’enfoiré désormais brisé, William fait toujours grise mine. Je le vois sombrer, devenir presque translucide, éteint, comme s’il pren
Questo è un articolo Prime
Per accedervi, iscriviti alla Creative Room "Si je ne t'ai pas, personne ne t'aura" di Juliette Norel
Vantaggi dell'iscrizione:

Accesso completo a contenuti esclusivi e archivi

Accesso preferenziale a futuri contenuti

Commenta le pubblicazioni dell'autore e unisciti alla sua community

Ricevi una notifica per ogni nuovo articolo
Iscriversi significa sostenere un autore a lungo termine
Iscriviti alla Creative Room English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español


 Contribuisci
Contribuisci


























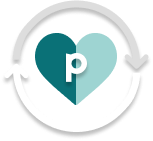 Puoi sostenere i tuoi scrittori preferiti
Puoi sostenere i tuoi scrittori preferiti
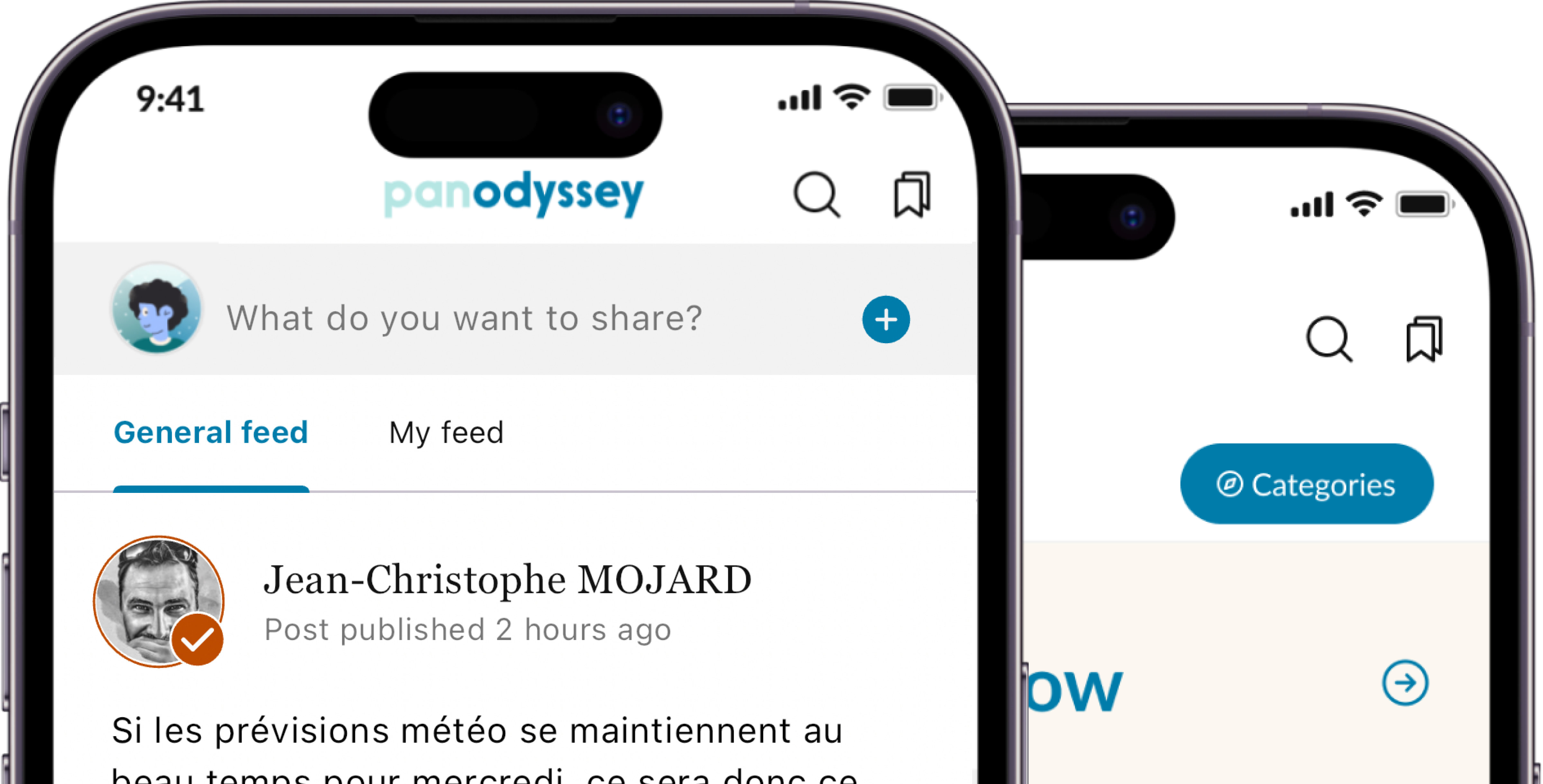





Jackie H 3 mesi fa
Comme je comprends Juliette vis-à-vis de William... être obligée par la loi de faire confiance, même en tant que père, à un homme qui l'a trahie en tant que mari et même simplement en tant qu'être humain, et qu'elle sait manipulateur, c'est tout simplement IMPOSSIBLE... moi aussi à sa place j'aurais eu peur pour ma fille ! On n'est jamais vraiment tranquille, on ne *peut* pas l'être... 😲