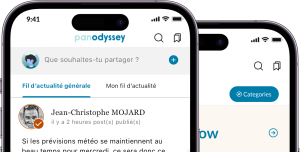Chapitre 10 : Les flocons de Themis
 22 min
22 min
Sur Panodyssey, tu peux lire 10 publications par mois sans être connecté. Profite encore de 9 articles à découvrir ce mois-ci.
Pour ne pas être limité, connecte-toi ou créé un compte en cliquant ci-dessous, c’est gratuit !
Se connecter
Chapitre 10 : Les flocons de Themis
Finalement, je crois qu’à partir de cet instant, une partie de moi s’est enfin libérée. Quelque chose avait changé en dedans. J’apprenais à être égoïste, à me détacher totalement de ce que les “autres” pouvaient bien penser de moi, de mes choix, de ma vie. Je continuais ma route, empruntais les mêmes chemins au quotidien, mais c’était en moi que s’était opérée une transformation intérieure. C’était presque une renaissance. Je m’étais délestée de tout ce poids inerte sur mes épaules, cette peur, réminiscence de l’enfance, que l’on nourrit à l’idée de décevoir notre famille, nos amis, n’avait plus de prise. Cela modifiait tout et redistribuait les cartes des interactions sociales qui, jusqu’à hier, me semblaient primordiales, mais qui aujourd’hui me paraissaient dénuées de sens, vides de substance. Les conversations superficielles, les jugements silencieux, tout cela n’avait plus d’emprise sur moi. Je me sentais légère, comme si une chap
Il s’agit d’une publication Prime
Pour en profiter, abonne-toi à la Creative Room
"Si je ne t'ai pas, personne ne t'aura"
de
Juliette Norel
Tu pourras :

Accéder à des contenus exclusifs et aux archives complètes

Avoir un accès anticipé à des contenus

Commenter les publications de l’auteur et rejoindre la communauté des abonnés

Être notifié à chaque nouvelle publication
S’abonner, c’est soutenir un auteur dans la durée
S’abonner à la Creative Room English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español


 Contribuer
Contribuer


























 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur