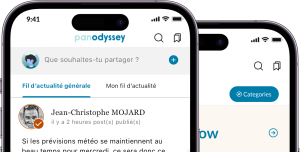Après les frontières
 14 min
14 min
Après les frontières
Voici donc rassemblées les notes du journal que j’ai tenu sans prétention intellectuelle ni littéraire, pendant 4 ans, de 1995 à 1999.
J’avais alors un statut d’étudiant, et sortait en effet d’une année d’études inachevée, en Licence de Lettres.
J’étudiais comme d’autres vagabondent. Je n’avais pas envie de « devenir prof » depuis une expérience quasi initiatique à Argenteuil qui m’avait vacciné contre l’enseignement. Ou plutôt, pour être précis, qui m’avait vacciné contre cette forme d’enseignement ceinte dans cette machine très justement nommée Education nationale, et qui n’a plus grand. Chose à voir avec l’Instruction publique. J’ai quitté la France, autant pour en finir avec mes études que, plus profondément, trouver un sens à ma vie. Je suis allé voir ailleurs si j’y étais. J’ai quitté la France comme on quitte une femme pour une autre. C’est toujours une mauvais idée ce genre de rupture. On a toutes les chances de trimballer ses problèmes avec soi. Ce que bien sûr je n’ai pas manqué de faire.
Paradoxalement, je suis parti enseigner, car je n’avais alors pas envisagé d’autres solutions, ou du moins d’alternatives rapides. J’avais cette proposition de donner des cours dans une école secondaire d’une ville du nord de la Lituanie. Et je me disais que ce travail-là serait une opportunité de rencontrer des gens que je ne pouvais pas croiser chez moi, de me confronter à une autre culture, d’autres mentalité, d’autres moeurs. Je n’ai pas hésité longtemps. Je me souviens d’ailleurs m’être dit clairement « tu trouveras autre chose à faire plus tard, une fois installé ».
Avant toute chose, il faut au lecteur d’aujourd’hui contextualiser ce qui va suivre.
Tout d’abord, une évidence - ce journal n’avait pas été écrit pour être lu par quelqu’un d’autre que son auteur. Ça n’est qu’aujourd’hui, 20 ans plus tard, sollicité par quelques amis qui voulaient en savoir davantage sur cette éclipse lituanienne, ainsi que par ma propre mémoire qui commençait à mélanger les lieux, les évènements et les gens, que j’ai décidé de le publier.
Je n’ai donc rien changé des lignes que j’ai écrites, j’ai simplement ajouté ci et là des commentaires utiles à la compréhension de ce récit heurté, de ce texte à trou.
Ensuite, ce journal a été écrit pendant une période qu’il est bon de situer, car il me semble que beaucoup de son intérêt réside dans cette période-là, qui commence en octobre 1995 et se termine en décembre 1999. Mais ce n’est pas seulement la fin d’une époque, c’est aussi la fin d’un siècle. Cette fin-là, nous la vivions sans téléphone portable et sans internet. Deux petits détails en somme. Tout comme le téléphone portable, internet n’est apparu dans ma vie qu’à mon retour en France, au début de l’année 2000 (sans doute, une minorité de français avaient déjà un téléphone portable, et un accès à internet chez eux, avant).
Cette époque était à cet égard un paradis perdu. Elle permettait de couper les ponts et les liens sans être obligé d’aller vivre en pleine Amazonie ou au milieu de l’océan. Elle facilitait le voyage sans le réduire à un déplacement.
C’était une époque où à 20 ans il n’était pas scandaleux de ne pas savoir où situer la Lituanie sur la carte de l’Europe, et n’en n’avoir aucune de représentations.
S’il est possible au lecteur de fermer les yeux un instant, et d’imaginer cette époque, il jouira d’une certaine liberté de penser. Vivre sans ce déferlement d’images, sans cette accumulation d’informations, sans que tout soit en permanence à disposition… sans les réseaux sociaux et ces multiples cordon ombilicaux.
C’était donc une époque où le temps comptait car tout prenait du temps. Beaucoup. (il me fallait chiner un vinyle dans les brocantes pour découvrir un album ou un artiste, et souvent c’était le fruit du hasard, et souvent aussi j’ai cherché sans succès quelque livre ou quelque ami).
Une époque où l’accumulation d’informations ne se confondait pas avec l’apprentissage. Une époque, en somme, encore faite pour apprendre. Une époque où l’on pouvait passer brusquement de l’adolescence à l’âge adulte.
J’en appelle à l’indulgence du lecteur - ce journal a été écrit par un jeune homme, dont je n’ai pas voulu trahir les états d’âme ou la pensée. Puisse le lecteur d’aujourd’hui lui pardonner ses maladresses et tenir compte de son immaturité.
Pour finir, je n’ai pu m’empêcher de commenter ce que j’ai recopié. Manque d’humilité. Mais aussi : il me semble que ces commentaires qui viennent d’aujourd’hui, complètent très bien ce qui a été écrit hier. Un dialogue avec soi, une perspective, une tendresse d’adulte envers le jeune homme qu’il était et qui n’est plus. Je me suis fait discret.
1995-1996
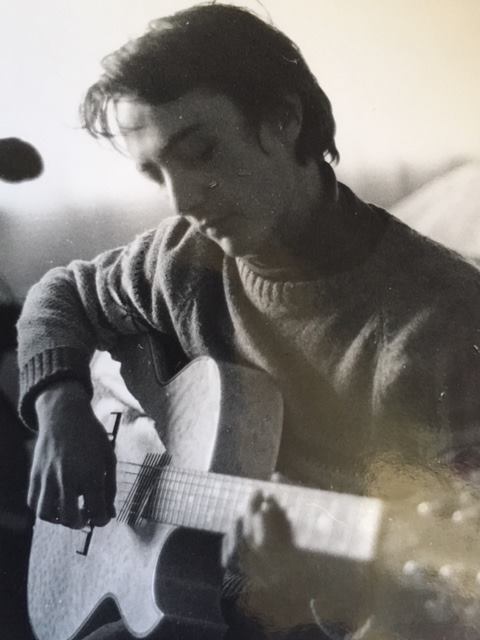
Dimanche 29 octobre
Qu’est-ce que je fait là ? C’est incompréhensible. Ma fenêtre donne sur la gare. Devant la gare il y a un petit champ avec une vache. Je la regarde, immobile à ma fenêtre, aussi immobile qu’elle, qui regarde les gens. Comment raconter le temps qui ne passe pas, et tout ce que j’aperçois dans le cadre de la fenêtre ?
Dimanche 5 novembre
Pourquoi n’ai-je pas écrit plus tôt ? Je suis là depuis plusieurs semaines déjà. J’ai pu poster des lettres et même en recevoir - de ma famille, de mes amis Philippe et Marc. Je confie beaucoup de choses à travers ces correspondances, mais tout de même pas tout…
Marc, je le comprends maintenant, a dû se sentir bien seul il y a deux années, lorsqu’il est arrivé en Lituanie, en pionnier. Il m’a donné le nom d’un couple de médecins, les Bekeris, sans doute d’origine allemande vu leur nom, à qui je me suis promis de rendre visite afin de leur transmettre ses amitiés et de faire connaissance avec eux. Marc était très lié à eu, et leurs enfants, dont le jeune Rokas. Je n’envie pas Marc, et pourtant je le jalouse : il a tout de même eu la présence d’esprit d’initier ces échanges.
La chambre dans laquelle j’écris fait partie, paraît-il, des plus grandes du foyer. Il y a une pièce de quinze mètres carrés environ, avec un lit, un canapé, un bureau, une table, deux chaises. Le mobilier est laqué, marron foncé. Les couleurs du canapé et du lit hésitent entre le marron et l’orange, sans beaucoup d’enthousiasme pour l’une et l’autre de ces couleurs. Contigu à cet espace, un WC et un lavabo. La cuisine collective est dans le couloir, les douches aussi. Mais je n’ai pas à me plaindre, car nous sommes deux ou trois, à ce qu’on m’a dit, au rez-de-chaussée. Les étudiants sont une centaine, et je ne crois pas qu’ils aient plus de quatre douches…
En fait, si, je me plains. Du froid. Quel bourgeois je fais ! Je viens d’un pays où l’eau chaude coule sans effort des robinets, où les caprices des radiateurs sont aussi rares et anecdotiques que ceux du ciel. Ici, il fait 16 degrés dans ma chambre - je ne sais pas ce qu’il va en être cet hiver ! Et … pour le moment il n’y a pas d’eau chaude. J’ai d’abord pris des douches froides, en m’échauffant avant comme un dingue, je transpirais sous la douche, mais depuis quelques jours, je me suis mis au diapason des étudiants, je ne me lave plus. Enfin, je ne me douche plus. Je me lave par petits bouts, par étapes, comme un rituel - au lavabo des toilettes. L’eau couleur rouille coule sur le lino, couleur rouille lui aussi. Comme il n’y a pas de tout-à-l’égout, le papier-toilette empli la poubelle. On dirait que je suis le personnage d’un roman noir d’après-guerre.
Il s’en faudrait de peu. Ce voyage dans l’espace est en vérité un voyage dans le temps.
Je me souviens de ces premières impressions. Il y avait dans la rue piétonne de Siauliai, qui s’appelle la Rue de Vilnius, un studio photo. Et le photographe de cet atelier faisait des portraits en noir et blanc incrustés dans des cadres rétro très kitch. Je n’ai pas pu résisté et je suis aller me faire tirer le portrait. Je me souviens de cette photo qui semblait tout droit sortie des années 50. Je me souviens qu’il y avait aussi un photographe ambulant, qui allait et venait, infatigable, arpentant cette unique rue piétonne, centrale, de la ville. Il avait un vieil appareil, ce genre d’appareil que les collectionneurs s’arrachaient déjà en France, à l’époque. Il cachait son visage sous un bout de drap noir et tirait ensuite je ne sais comment une photo, qu’il apportait au client patientant sur un banc. Je me suis souvent répété : tu vis aujourd’hui ici une époque qui ressemble plus à celle de tes parents qu’à la tienne. Les jeunes sont insouciants, il y a peu de distraction, un unique cinéma avec en prime des affiches peintes à la main reproduisant les affiches originales des films étrangers. Les théâtres sont plein, il y a peu de voitures, pas de diesel, le camion du laitier passe régulièrement livrer dans la cour de l’immeuble, il existe deux ou trois stations de radio, à l’école les élèves se lèvent pour saluer collectivement leur professeur, à la cantine on sert des plats cuisinés sur place, et il y a ça et là des terrains vagues, de ces terrains où l’on s’aventure à tous âges, et qui manquent tant à l’enfant français d’aujourd’hui pour être un enfant accompli. C’est-à-dire pour jouer complètement. Car qu’est-ce qu’un enfant sans terrain vague ?









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer










 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur