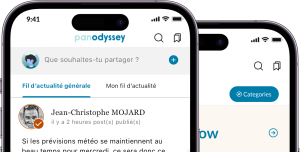En 2068, le revenu de base est instauré…
 35 min
35 min
En 2068, le revenu de base est instauré…
Nouvelle initialement écrite dans le cadre d'un concours organisé par Le Mouvement Français pour un Revenu de Base, et publiée sur leur site. Bonne lecture !
-----
— Vous n’avez pas d’étoiles, à Paris ?
Alban détourne le regard du ciel. Elsa s’approche de lui, les yeux rieurs, et lui tend une bière en s’asseyant. La musique leur arrive tamisée, en même temps que le bruit de la rivière. Le feu, autour duquel danse le reste de la bande quelques dizaines de mètres plus loin, projette ses crépitements de lumière sur leurs visages. Short et T‑shirt, robe légère, pieds nus, il est minuit et le Jura leur offre une de ses chaudes nuits de mars.
— Si, mais je ne prends pas assez le temps de les regarder, dit Alban. Je devrais, pourtant, quand je pense à ma mère qui n’a pas pu en profiter comme elle aurait dû.
— Avant qu’ils n’arrêtent les éclairages de nuit ?
— Oui, répond Alban en trinquant. Elle est décédée seulement quelques mois après le décret.
Alban arrache machinalement des brins d’herbe qui l’entourent. Il les frotte entre ses doigts, dérangeant du même geste quelques fourmis paniquées. Plus loin, des vers luisants sont comme des diodes au milieu de la nuit, qui rivalisent avec les astres brillants.
— Ma pauvre maman. Parfois, continue-t-il, je me dis que nos parents ont vraiment eu une vie de merde.
— Parce qu’ils ne voyaient pas les étoiles ?
— Non ! Enfin, pas seulement ça. C’est plutôt, t’imagines… être obligé de travailler pour vivre ? Mes parents avaient une grande bibliothèque, en partie héritée de mon grand-père qui lisait beaucoup. Chaque matin, j’ai vu mon père se connecter sur son ordinateur. Il s’installait dans le salon, notre appart était trop petit pour qu’il puisse avoir un bureau à lui, et il télétravaillait 8 à 10 heures par jour, quatre jours par semaine, devant les livres de mon grand-père. Je ne l’ai jamais vu faire une seule pause pour prendre un bouquin et se poser tranquillement dans le canapé. Au bout de 10 minutes d’inactivité, son écran se mettait en veille et ses supérieurs étaient prévenus.
— Je ne sais pas s’ils étaient si malheureux que ça, moi mes parents adoraient leur travail. Enfin, je crois qu’ils aimaient bien. Ils étaient super potes avec leurs collègues.
— Ils faisaient quoi déjà ?
— Elle s’occupait des réseaux sociaux de plusieurs boites. Elle bossait depuis un espace de coworking à Besançon. Et lui avait un de ces jobs à rallonge. Tu sais, un truc avec plein de mots anglais.
— Key Operations Regional Manager ?
— Non, je me souviens plus bien. C’était en lien avec la relation client, pour une startup allemande, je crois.
— International Interactions Agent ?
— T’es con ! dit Elsa en riant.
— Functional Working Performance Facilitator ? Main Relational Engineer ? Customer Success Specialist ?
Elsa lui donne une tape dans l’épaule, il fait sembler de tomber à la renverse et se redresse.
— En tout cas, poursuit Elsa, je crois que ça lui plaisait.
— Il était bien obligé, sinon un Chief Happiness Officer venait lui masser les mains ou l’obliger à faire du reiki !
— Arrête je crois qu’il en a fait…
— Ahah ! Moi je me souviens du profil LinkedIn de ma mère. Dans mon collège, on nous avait appris à créer un compte. Alors je l’avais ajoutée, son intitulé c’était : « Je crée du contenu qui vous rend #impactful et #boost vos performances ». Tu parles d’une blague !
— Ouais. Après, je pense que c’était pas les plus à plaindre. Enfin, mes parents en tout cas.
— C’est pas la question, Elsa. Je sais pas, ça me fascine cette espèce d’acceptation collective qui a duré des décennies, alors même qu’ils produisaient et consommaient chaque année plus de choses qu’on en utilise aujourd’hui au cours d’une vie. Et pourtant y avait ce verrou psychique dont parle Meyer. Tous les jours, ils bradaient leurs temps à faire des trucs débiles. Bordel, même quand les robots les ont massivement remplacés ils ont persisté dans leurs jobs à la con et leur durée minimum de travail !
— Il est bien le livre de Meyer ? Je l’ai entendu à la radio l’autre jour.
— Ouais, super ! C’est pour moi la meilleure analyse de cette époque. Enfin, il décortique tous les mécanismes de manière magistrale. L’héritage libéral des Lumières, l’irruption du modèle capitaliste porté par la Révolution Industrielle, le mythe du Progrès triomphant, l’Homme transformant la Nature … tu vois, jusqu’à l’installation dans les mœurs au 19e du travail comme socle de la société. Ce qui est pas mal, c’est qu’il reprend et affine l’analyse sur le fameux triptyque de la valeur travail en ce temps-là : croissance, revenu, essence.
— Croissance, revenu… essence ? interroge Elsa en énumérant les mots sur ses doigts.
— Yep. Évidemment, c’était pas aussi clair pour les gens de l’époque, mais c’est comme ça que la valeur travail est devenue centrale dans les sociétés. En augmentant la production, en conditionnant les revenus, et donc la survie, et en permettant l’accomplissement des individus. Et après, Meyer montre bien comment ces notions ont été remises en question, fin 20e et début 21e siècle. Avec les réflexions sur les limites de la croissance et l’écologie, l’explosion des bullshit jobs, l’automatisation, les crises à gogo, le creusement des inégalités… On voit où ça nous a menés, comment tout s’est cassé la gueule. Faudrait que tu lises le bouquin, je te le recommande. Même si ça reste très technique et que ça manque un peu de psychologie. Je veux dire, son histoire de verrou psychique est intéressante, mais perso ça ne me convainc pas sur le pourquoi des millions de personnes ont accepté aussi longtemps un système aussi délirant.
— Faut croire qu’on n’est pas si rationnels que ça. Finalement t’as peut-être raison, c’est nous les plus chanceux.
— Attends ! L’inertie climatique n’est pas encore à son zénith, te réjouis pas trop vite, répond Alban avec un soupir nerveux.
Elsa baisse la tête. Alban la regarde. Quelques mèches rousses, dont le feu fait ressortir l’aspect cuivré, lui barrent les joues. À 43 ans, il la trouve toujours aussi jolie. Parfois, il se demande s’il a fait le bon choix de revenir à Paris.
— Désolé Elsa, continue-t-il, tu me connais je m’emballe un peu sur l’avenir. Mais tout se passera bien. Tu as Teva, et puis ton fils aussi. Il m’a l’air super débrouillard pour son âge. Enfin, je veux dire…
— T’inquiètes Alban, y a pas de mal. Parle-moi plutôt de toi, t’en es où dans tes projets ?
*****
Alban était né en 2025. Il avait grandi dans la grande banlieue parisienne, où son père réparait les machines d’usines. Quelquefois, il l’amenait avec lui. Encore aujourd’hui, Alban se rappelle ces énormes bras motorisés et parfaitement coordonnés. Des géants de métal sans visages, d’un jaune pétant pour être visibles, et qui répétaient inlassablement les mêmes gestes aussi précis que puissants dans d’immenses hangars. Et leur musique qui résonnait dans un rythme immuable, semblable au tictac d’une horloge. Durant son adolescence, les robots devinrent suffisamment intelligents pour se réparer eux-mêmes. Son père avait eu de la chance : il était devenu technicien de surveillance. Son travail se faisait entièrement à distance, mais lui demandait d’être alerte devant son ordinateur. Quand un problème survenait sur une chaîne de montage, il commandait aux robots les réparations à effectuer (reporter la responsabilité d’un incident sur un humain plutôt qu’un robot simplifiait les démarches auprès des assurances) et produisait un email à son responsable, qui produisait un rapport quotidien à un superviseur général, qui produisait un rapport contenant tous les rapports de sa zone géographique, puis le remontait à la Direction des Données, qui ne lisait pas vraiment les rapports, mais en organisait les chiffres (« nombre de pannes », « temps moyen des pannes », « vitesse de réaction »…) et les remontait à la Direction Générale, qui se félicitait des bons résultats des robots dans le rapport trimestriel à destination des actionnaires.
En tant que salarié du secteur industriel, chose rare, son père avait pu bénéficier de belles indemnités au début de la Longue Récession. Alban se souvenait de sa première réaction, alors qu’il venait d’être licencié : « j’espère que ça va repartir vite, pour mes trimestres de retraite ».
Sa mère travaillait comme copywriter indépendante et aidait les marques à optimiser leurs ventes avec des mots. Elle avait étudié les techniques de persuasion et de marketing digital dans des MOOCs et des livres blancs. Avec des séquences mails automatiques, des publicités sur les réseaux sociaux, des landing pages, des lead magnets… elle cherchait à construire un phare de lumière, projetant le nom de ses clients, au milieu de la tempête marketing qui assaillait tout internaute traçant son chemin sur le world wide web.
Elle avait succombé à une tumeur cérébrale, au début de la Longue Récession, avant d’avoir pu achever son projet de roman. Faute de temps.
Après le bac, quelque peu désœuvré, Alban s’était tourné vers la sociologie. Il avait réussi les concours de la faculté privée de Nanterre et était en troisième année lorsque la Longue Récession débuta. Comme tout le monde, au début, il s’était dit qu’il s’agissait d’une crise passagère. Les spécialistes habituels se voulaient rassurants : une récession, ça ne dure jamais bien longtemps. Il y avait trop de bateaux, trop d’avions, trop de voitures, trop de mouvement pour que l’immobilisme s’enracine. Sur les plateaux télé, certains s’inquiétaient des charges qui pesaient sur les entreprises et les indépendants, arguaient que la semaine de quatre jours instaurée quelques années auparavant était une erreur, voulaient fermer les frontières aux réfugiés climatiques du Sahel ; d’autres se demandaient s’il n’était pas temps de réinstaurer l’impôt sur la fortune, de recréer des grands hôpitaux publics afin d’assurer des soins aux gens n’ayant plus de revenus, d’augmenter la taxe sur les robots pour financer la pauvreté.
Plus la société s’engluait dans la crise, moins Alban s’en préoccupait. Sa mère était malade, son père sombrait dans la dépression, et l’océan de béton autour de lui imposait un voile gris devant ses yeux. Aussi, avait-il fini par s’enfuir. Qu’aurait-il pu faire d’autre ?
Il était parti dans un écovillage du Jura, espérant recolorer ses iris. Un jour il consolidait un toit, le lendemain repiquait des poireaux. Il participait aux tâches collectives en général le matin, et passait ses après-midis à lire des romans et des livres de sociologie. Le soir, il s’enivrait avec des amis de son âge, dont Elsa. Ils jouaient à des jeux de société ou des jeux vidéo, s’essayaient piètrement à la musique, voguaient dans les eaux troubles des amours de jeunesse. Alors que le monde s’effondrait, que même les plus grandes richesses vacillaient, la vie d’Alban s’écoulait tranquillement. Liquide, adaptant sa forme à tout ce qui pouvait l’accueillir. Il mélangeait les expériences.
La mort de sa mère fut comme une bulle de savon qui éclate. Pendant deux années, il l’avait eu collée au corps, fragile, sans jamais vraiment la regarder toutefois. Quand sa mère mourut, il eut comme l’impression de s’évaporer. Il était rentré pour l’enterrement et avait découvert son père en pleine décomposition. La crise perdurant, ses indemnités avaient été réduites à peau de chagrin, au point qu’il risquait de finir à la rue. Alban n’avait pas trouvé le courage de repartir. Il était retourné dans sa chambre d’ado, en banlieue parisienne. Le temps que son père aille mieux, se disait-il, le temps que son père retrouve un travail et puisse vivre.
Partout dans le paysage français, des gratte-ciels aux clochers, la crise s’étendait ; comme un brouillard général qui s’infiltrait dans les chaumières et dans les cœurs. Sans perspectives plus réjouissantes, bien obligé de gagner sa vie en plus de celle de son père, Alban s’était essayé au microtravail. Sur les plateformes en ligne, il remplissait des formulaires, décrivait des images, rédigeait des textes optimisés SEO, s’amollissait dans des vapeurs éphémères. Pour quelques euros grappillés, par-ci par-là. À l’époque, une mythologie circulait sur internet à propos de certains micro-jobbers, véritables Stakhanov modernes, qui réussissaient à gagner plus que le nécessaire. Grâce à des techniques d’organisation venue de Chine, à l’optimisation de leur temps ou tout simplement grâce à leur « mindset de la réussite ». Ils s’exprimaient dans les émissions YouTube, s’affichaient dans des webinaires, vendaient leurs secrets aux cohortes de malheureux aspirants à un avenir meilleur. Alban, lui, ne devait pas avoir le bon mindset, il gagnait à peine de quoi payer le nécessaire. Le remboursement du prêt immobilier, les charges, des pâtes et des compotes. Dans leur appartement de banlieue, ils étaient mous comme des ballons de baudruches, à se ratatiner lentement sur eux-mêmes. Ou bien prêts à éclater.
Les instances européennes ne faisaient rien à part injecter des liquidités dans les banques. Le système était solide, disaient les cravates et les tailleurs, la croissance allait repartir, comme en Afrique. Des millions, des milliards de chiffres numériques venaient renflouer des caisses flottantes, éthérées, n’existant que pour quelques — uns ; mais sans jamais toucher la réalité crasse. Celle de la bouffe qui ne nourrit pas, des maladies qu’on ne soigne pas, des livres qu’on n’achète pas, des voyages qu’on ne rêve même pas.
Ce ne fut qu’à la fin des années 40 que le changement pointa le bout de son nez, dans un quartier d’Athènes appelé Exàrchia. Vivant depuis longtemps en autogestion, lassés du système en phase terminale qu’on leur imposait, ses habitants avaient décidé de frapper leur propre monnaie et de la distribuer entre eux. Des programmeurs la créèrent ex nihilo. Les habitants l’appelèrent Misthos, en hommage aux temps anciens, et décidèrent collectivement de l’adosser à l’euro, rappelant ainsi que la première matière de la monnaie est la confiance. Elle circula rapidement entre les objets connectés, d’un smartphone à une montre, d’une carte à une skinchip, dans tout ce qui contenait une puce sans contact. En quelques semaines, de nombreux commerces émergèrent, et la consommation locale avec eux. Le système D s’était généralisé, organisé, jusqu’à devenir une économie florissante et autonome.
La révolution essaima rapidement en Europe. Des villages, des localités, et même des grandes villes comme Barcelone ou Toulouse suivirent l’exemple grec. Les États opposèrent une lutte médiatique et judiciaire, des barricades idéologiques, refusant de reconnaître ce qui se jouait sous leurs yeux. Le Parlement Européen s’embrasait d’un débat qui ne trouvait aucun débouché. La Commission craignait la fin de son pouvoir centralisé.
2048 était comme un atavisme historique.
Dans sa petite ville de banlieue, Alban fut de ceux qui, à leur tour, décidèrent de créer une monnaie locale afin de la redistribuer sous forme de revenu ; sans aucune contrepartie. La transformation fut quasiment immédiate. Alban vit le retour au réel et au local de l’économie. Il vit des artisans relancer leurs affaires, des amis devenir NIMAculteurs, comme on les appelait, et vendre leurs bras dans des SCOP agroécologiques fraîchement établies. Il huma la foule des marchés revenus à la vie, alors que les grandes surfaces étaient désertées depuis longtemps. Dans son quartier, une jeune styliste remit le béret au goût du jour. Ici et là, des groupes de musique s’organisaient, des poètes improvisaient dans des cafés. Un air de Belle Époque s’ancrait dans les territoires.
Alban redevint solide.
Il milita pour une généralisation du revenu universel au niveau national. Il l’obtint. La France fut le premier pays d’Europe à reconnaître ses monnaies locales et à instaurer un revenu universel. Sans doute que la vanité du président Hembise y fut pour quelque chose ; lui qui, comme tous ses prédécesseurs, voulait entrer dans l’Histoire et inscrire son nom au panthéon des hommes et femmes providentiels de France. Vaniteux comme les autres, mais probablement moins idiot : le président Hembise avait compris que les recettes du passé ne pouvaient plus fonctionner face à la crise ; et que, pour marquer son temps et restaurer la « grandeur de la France », il lui fallait être audacieux. Soutenu par l’impulsion populaire et un référendum, il fit graver les principes d’un revenu universel dans la Constitution de la 6e République. L’Allocation Universel de Base était née.
| Article Premier de la Constitution
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l’égal accès à tous les genres aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. La République garantit la préservation de la biodiversité, de l’environnement et lutte contre le dérèglement climatique. La République garantit à tous ses citoyens le droit de vivre dans la dignité à travers une allocation Universelle, Inconditionnelle, Individuelle, Permanente, Inaliénable et Cumulable. |
Il fallut seulement quelques années à l’exemple français pour convaincre le reste de l’Europe. Les entreprises se créaient par milliers. Sans la pression de la rentabilité immédiate, elles purent renouer avec leur rôle primordial : celui de répondre à des problématiques sociales, humaines, véritables. La science et la presse renouèrent avec leur indépendance, partout des artistes déployaient leurs potentiels, des vocations politiques s’assumèrent, jusqu’aux Jeux olympiques de 2052 où les sportifs français brillèrent particulièrement et pour lesquels, dans un excès de confiance et d’euphorie après une décennie de marasme, on attribua les médailles aux passions libérées par l’AUB.
Quand le revenu universel fut adopté par l’Union Européenne, que la Banque Centrale Européenne reconnut et garantit toutes les monnaies locales, Alban arrêta le militantisme politique. Libéré des contraintes matérielles, son père redevenu autonome, il essaya, un temps, de reprendre le projet de roman de sa mère, retrouvé dans une clé USB qui agonisait dans un tiroir. Sans succès. Il retourna dans le Jura plusieurs fois, quelques jours, quelques semaines. Il pensait reprendre l’épisode de ses 20 ans en cours de route, mais la vie avait continué là-bas aussi. Elsa avait un compagnon désormais, un Tahitien qui avait fui la montée des eaux.
Et surtout, elle avait un fils.
***
— Je suis toujours « consultant », dit Alban en mimant les guillemets avec ses doigts. Du moins, aux yeux de l’administration, je préfère me dire que j’aide les gens. Toujours à mon compte. C’est bien, je choisis mes clients. En ce moment j’accompagne une jeune inventrice. Elle vient de Normandie et elle a mis au point un système amélioré pour capter l’énergie des marées, un truc low tech, simple, mais qui résiste bien au sel et qui est facilement réplicable et réparable.
— Ça a l’air chouette. Tu l’aides en quoi ?
— À présenter son projet devant un jury, avec les dossiers administratifs pour lever des fonds, breveter le dispositif, la communication, tout ça …
— Cool ! Et elle te paye ?
— Pas pour le moment, elle vit sur l’AUB.
— Alban au grand cœur !
— Ahah ! Moque — toi de moi, va !
— Sérieusement, dans n’importe quel cabinet de conseil tu serais payé une fortune pour faire ça. J’ai un cousin qui bosse chez GreenConsulting.
— Je ne pense pas que les cabinets de conseil dont tu parles s’intéressent à ce genre de projet, Elsa. C’est tout l’intérêt de l’AUB, ça ne résout pas les problèmes, mais ça donne la possibilité de choisir ceux que l’on souhaite régler.
Alban se tait. Il observe les gens danser un peu plus loin, au rythme d’une musique sans paroles. Les corps projettent des ombres fugaces, les claquements des mains et des cuisses qui jaillissent par intermittence résonnent en lui. Ils sont jeunes et vieux, certains rient, certains se laissent tomber dans l’herbe, fatigués. Certains s’embrassent.
Pourrait-il gagner plus ? Oui, certainement. Parfois, il s’abandonne à cette idée, comme dans le train à hydrogène qui l’avait amené jusqu’ici. Ce n’est pas une question de confort. Alban mange à sa faim, la ferme de son quartier tourne bien, il vit toujours avec son père, mais l’AUB couvre complètement leurs charges, il bénéficie d’une offre culturelle importante, bien souvent gratuite, et, comme beaucoup de gens de sa génération, ses aspirations matérielles sont extrêmement réduites. Son questionnement porte sur l’avenir. Pas le lendemain, mais le surlendemain : le long terme. Même si presque tous les pays du monde se sont grandement décarbonés, la planète continue de se réchauffer, les océans persistent dans leur longue agonie, les animaux disparaissent toujours, les terres s’assèchent les unes après les autres. Sa génération subit de plein fouet le réveil tardif de ses aînés en matière d’écologie. Alors, quand l’angoisse le prend, l’idée de « faire de la thune » ressurgit. Comme un radeau pour un naufragé. Ce serait le moyen de partir en Norvège, ou en Russie. Un moyen de se mettre à l’abri de ce qu’il imagine être le pire et qui ne saurait être évité.
Non, le revenu universel n’a pas résolu tous les problèmes, loin de là. Mais il a donné à chacun la possibilité de choisir sa vie, ses combats. Certains se sont révélés, d’autres ont succombé à la paralysie. Il n’a pas supprimé toutes les violences, toutes les déceptions, toutes les peurs. Il n’a pas non plus empêché les succès, les prises de risque, le panache. Il n’a pas redéfini le bonheur, mais simplement facilité la recherche de ce dernier. Il a au moins soulagé tous les esprits de leurs inquiétudes ancestrales : et demain, que vais-je manger ? Où vais-je dormir ? Serais-je en sécurité ? Et cela seul devrait suffire à le considérer comme un progrès immense pour l’humanité.
Alban regarde Elsa. Ses cheveux, sa bouche, ses taches de rousseurs, son nez en trompette.
Peut-être que les choses auraient pu être différentes, s’il n’avait pas eu peur de voir son père tomber dans l’indigence, autrefois. S’il avait simplement été en mesure de se projeter plus loin que le jour d’après, quand il avait 23 ans.
Alban regarde Elsa. Elsa et ses yeux verts.
Il rejoue son passé. Sous la lumière de la nuit, via l’alcool qui lui monte à la tête, les Moires s’amusent avec les fils de sa vie. Il aurait choisi Elsa, pense-t-il. S’il avait pu. Libéré de la responsabilité de son père, du fardeau de devoir gagner sa vie dans un monde éteint ; son destin réellement entre ses mains, sans cette peur qui lui collait au bide et lui faisait bouillir le cerveau, sans cette crainte qui lui bouchait la vue. Alban se dit qu’il aurait choisi l’aventure humaine.
Mais qui peut le dire avec certitude ?
Qui peut affirmer qu’Alban aurait osé vivre ?









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer




















 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur