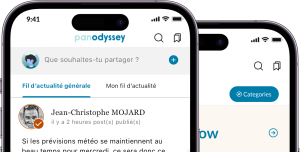Sur l'hypothèse d'un idéalisme onirique
 19 min
19 min
Sur Panodyssey, tu peux lire 10 publications par mois sans être connecté. Profite encore de 8 articles à découvrir ce mois-ci.
Pour ne pas être limité, connecte-toi ou créé un compte en cliquant ci-dessous, c’est gratuit !
Se connecter
Sur l'hypothèse d'un idéalisme onirique
Qu’est-ce que le rêve fait du mot ?
L’empire du rêve s’étend comme un lac aux effets sombres que des diamants éteints éparpillent loin en-deçà de soi. Empire à l’emprise démoniaque, que de multiples dieux et démons hantent au bord de ses précipices et ses ivresses à la beauté disparue. Mais le rêve ne saurait plus être le fruit d’aucun de ses fantoches. Il ne saurait être celui que du seul néant. Comment encore croire à ce que les paroles de ces dieux antiques ne se fassent l’écho que d’un autre qui les leur aurait inspirés ? Et qui d’autre que le néant ne pourrait aussi bien seoir à la venue de l’Être et de sa majesté toute parfaite ? C’est toutefois par lui, par le rêve, que le monde du sens s’installe, sens aux bras ductiles constamment jetés en dehors de cette cage qu’il aura aussi su patiemment confectionner. Dès lors, on peut observer deux rêves s’entrelacer. Celui de nos méditations oubliées, enfouies au cœur de ce lac sans œil, et celui de nos rêves habités, se jetant au dehors les bras jetés, au loin, dans le vague, et qui se fait l’écho habillé du premier. Voilà d’où proviennent ces bras jetés du sens, mais que des barreaux triturent, qu’un mur transparent arrête. Le sens interpelle sans jamais atteindre. Il vise sans jamais toucher. Si les mots restent attirés vers un au-delà, la source de leur tension s’enracine dans le cœur obscur du cachot de la vie, dans cette forge du rêve aux contours sans bords et qui les rive en l’antre onirique contre lequel ils ne cessent de buter, mais sans jamais atteindre ce à quoi pourtant ils ne cessent désespérément de rêver.
Le sens se sera donc ourdi au fond d’un lac sans fond. C’est par lui, par ces méditations oubliées, que commence l’aventure de la signification. La conscience n’en est que le produit tardif, évolué, mais détaché de ce qui l’aura fait naître. Si elle aura permis un retour à nos antiques divinités, ce n’est que par nos rêves habités, ceux qui l’emmènent en l’ouate légère d’un espace diaphane, celui de nos échanges tumultueux, de ce lieu où l’esprit a décidé de vivre. Mais de sa racine, de ce lieu sans-fond, de cet abysse à l’obscurité insondable, rien ne semble désormais plus la rattacher à elle, et pourtant duquel résonne encore des soubresauts telluriques qu’un corps n’aura jamais oubliés. Il s’agit du chant du rêve, de cette mélodie à la basse continue, autour de laquelle nos méditations oubliées auront pu se tisser.
Ce chant du rêve, ces mots tirés de sa forge, chant qui ne peut être entonné que sur les rives de la mort comme l’être du néant, poursuit celui qui y est arrimé comme la hyène suit la charogne, attendant le dernier soupir des élans du rêve, écoutant le moment de leur faiblesse qu’une prière squelettique psalmodiera, faisant se répercuter en écho les lambeaux de la parole, excitant en une dernière danse tous les membres du corps comme en un frémissement gourd, dernière danse divine qui dans l’azur de l’oubliette onirique jettera cette dernière phrase planant au loin comme ce vautour prêt à arracher les derniers lambeaux de toute vie en un seul coup hystérique et sauvage, phrase au chant qui n’a d’autre ressort que celui de s’oublier en dehors de cette cage, déchirant sur son passage la vie en lambeaux en un grand feu dévorant telles des harpies nues suçant les dernières gouttes de la vie, la buvant, cette phrase qui encore résonne, telle cette cloche au marteau tintant, tapant, attaquant tous les côtés de la cloche, qui s’abat encore, ne cesse de piétiner, se jetant aux alentours autant en soi qu’en son dehors, autant nulle part que partout ailleurs… Ce chant du rêve, cette phrase à la basse continue, dont l’acouphène résonne peut-être encore au loin, ne revient qu’à ce rêve immémorial hantant toutes les autres phrases. C’est ce qu’elles ne cessent de poursuivre dans l’épuisement infini de leur diatribe, de leur combat incessant les unes contre les autres, dans ce monde d’apparat aux oreilles éteintes, celui de nos échanges tumultueux, mais dans l’ignorance de ce qui les hante. Leurs bras jetés au loin, sans jamais ne rien atteindre, ces phrases à l’ergot pérorant désespèrent de ne plus pouvoir se nourrir de ce qui les aura pourtant fait naître, vociférant à tour de bras les unes contre les autres, dans cette cacophonie assourdissante, aux atours de pantins désarticulés, mais le dos tourné au chant de leur terre.
La conscience ne saurait donc jaillir du rêve qu’en un oubli herculéen. Elle ne fait que taire ce qui la fait parler. Au cœur de son désir, le rêve s’y sera effondré cloîtrant son illusion rapace en l’oubli vertigineux. La conscience se nourrit de ce qu’elle ignore, qui la hante tout autant qui l’anime. Sa posture reste alors toute de croyance vêtue qu’elle pare du nom de volonté. Chacun de ses élans en est irrémédiablement empreint lui laissant dire que c’est la mémoire qui lui permet de sentir, que c’est sa volonté qui l’ouvre au réel, que ce sont ses sens qui la font rêver, que c’est son imagination qui la font penser. Mais elle sent que derrière chaque sentir se tient roide et caché, derrière chacune des impulsions de sa volonté en une posture hiératique se cache en elle le temps et son étau étourdissant. L’irruption de la conscience au monde se fait sur fond d’un chant ténébreux, celui du temps, de ses stances aux contractions mécaniques. Si la structure de la conscience est prise à la noirceur abyssale de l’oubli, qui fait se cacher en elle ce qui la hante et qui ne peut que lui échapper, sa croyance se structure sur fond de cette dynamique temporelle, par laquelle chacune de ses phrases, chacune de ses injonctions de signification renvoie comme à autant de verbes, comme à autant de mots gros de l’illusion de leurs actions. C’est le temps qui couve en elle le rêve disparu et son chant étourdissant, et dont l’oubli se love au cœur de ses battements, conscience qui ne s’en fait que le simple porte-parole, à l’image de ce singe hurleur dont les paroles restent aphones sur leurs origines, qui restent sans bruit, sans son, sans sens sur ce qui leur aura permis d’apparaître, ce qui ne peut donc que pousser la conscience à crier son impuissance.
Mais que poursuit-elle ? De quoi désespère-t-elle que sa croyance oublie ? C’est faire du mot qu’elle profère ce que la matière ne cesse de lui montrer et qui pourtant ne fait que s’en éloigner. Elle rêve d’avoir devant elle un mur, non pas celui qui ne cesse de reculer devant elle, s’époumonant à le poursuivre, mais tel un bagnard rêvant de sa prison dans l’extase d’un feu passionnel, elle voudrait que ce mur se plante devant elle, dans un temps dont l’incoercibilité ne peut se dire que de la seule éternité. C’est alors faire de l’action de la conscience, par laquelle elle ne cesse d’affirmer, de juger, c’est faire de son dire ce que le problème provoque comme ouverture au temps. Tout problème ouvre, en effet, un temps nouveau dont l’incoercibilité lui permet d’en conserver l’éternelle nature. Mais la conscience ne peut s’arrêter qu’à sa seule croyance, celle qui veut et espère, croyance qui ne peut s’arrêter qu’à ce qu’elle dit, qu’à ses affirmations, incapable de les interroger, incapable de ne pas y croire. Dire qui s’oublie en lui-même, qui relève de la création de la croyance, d’un éternel oubli , sans question, sans problème. Tout ce que la conscience construit, c’est à son oubli qu’elle le doit. Et son oubli, elle le doit au temps, au temps qui passe. Chaque temps qu’elle vit n’est que l’annonce de sa disparition, entraînant avec lui tout ce qu’elle peut faire, comme en une longue traînée se dispersant dans l’abîme insondable du gouffre du temps. La croyance reste donc grosse de ce travail de fossoyeur que le broyage du temps ne cesse d’engloutir. Sa structure n’en est donc que la réplique la plus fidèle, celle qui ne fait qu’oublier ce qui l’aura fait naître. Croire, c’est donc tomber dans l’oubli de soi-même, oubli que le temps ne cesse d’emporter. Tout ce que la conscience peut dire, c’est au temps à qui elle le doit et qui ne fait que passer en elle, à qui elle doit aussi les multiples avatars de sa parole. C’est sa croyance qui lui fait en effet prendre le sens pour un autre, le mot pour une chose, la parole pour le réel, le temps pour l’éternité. Mais croyant qu’en chacune de ses paroles se tient cet autre qui lui fait dire ce qu’elle décline, ce n’est en fait qu’à elle-même que la conscience s’adresse, se disant à elle-même ce qu’elle prend pour un autre. La conscience ne cesse de s’oublier lorsqu’elle adresse au monde ce qu’elle en comprend, ce qu’elle en signifie. C’est sa propre sensibilité qu’elle ne fait que mobiliser et qui ne se fait l’écho que d’elle-même, en ce temps d’un autre qu’elle prend pour le monde mais qui n’est que ce qu’elle prend d’elle-même.
Le temps de la conscience est alors celui de cette valse qui la rassure, la poussant à croire en l’ouverture d’un temps nouveau, mais qui l’écrase dans celui de sa peur. Peur de s’oublier. Mieux vaut se jeter dans l’eau que de se voir frémir sur cette image grimaçante, se jeter dedans pour mieux se retrouver dans ce que l’on prend pour un autre que soi, et ce afin d’en conserver l’impression. La conscience ne cesse donc de faire l’épreuve de son propre néant, de ce qui lui permet de se néantiser, et ce dans l’illusion d’une croyance qui la projette loin par-delà devant elle. C’est ce néant qui favorise par la suite l’accueil d’un autre que soi en soi, de le prendre pour un autre dans l’ivresse de sa croyance, dans le désordre de ses sens. La conscience s’appuie, en ce sens, sur ce qui ploie, ce je qui ne cesse de s’oublier en lui-même. Que voit la conscience dans cette splendeur qui l’attire tout autant qui la disperse, qui la polarise tout autant qui la fait se perdre ? C’est ce je, le fait d’y croire tout en l’oubliant, de s’y perdre tout en s’y reconnaissant, de croire n’y rien comprendre tout en l’ouvrant au monde. Pour avoir pris peur de sa propre peur, de cette peur qui rôde en elle, c’est le seul moyen de se perdre en soi, de ne plus s’y retrouver en ce dédale si chaud, si douillet du drap de sa propre libido. Cette peur qui monte en soi n’aura été que le véritable ressort de ce qui aura été monté de toute pièce, de ce par quoi un monde peut autant s’anéantir, disparaître, que surgir, s’ouvrir. Création géniale faite pour s’oublier, pour se perdre dans le dédale de sa création, assuré de ne jamais pouvoir se trouver, s’y retrouver, ce qui ne cesse de s’isoler dans un néant de solitude mais à la fraîcheur d’un cadavre qu’il croit voir bouger, grâce à ces vents insignifiants de la croyance qui en soulèvent les rares lambeaux déchirés d’une vie se desséchant en un âtre devenu toutefois irrespirable, et dans lequel les dernières braises d’un je suffoquent sous les cendres de ses illusions consumées. Chaque mot proféré ne renvoie ainsi qu’à ces vers, ces vers qui « verminent » en ce cadavre exquis de nos phrases, là où se cache toute identité, toute présence du je, leur laissant dire que seul ce qui bouge vit. Seul le je arrive donc à se pâmer devant ce théâtre sordide tout autant que mortifère de la conscience, à croire s’y reconnaître, et prendre ce site cadavéreux du langage comme étant le véritable mur, celui qui ne cesse toutefois de se rechercher toujours et encore dans l’oubli vertigineux d’un lac sans fond, se croyant s’y voir mais étant déjà parti au loin, loin au-dedans du miroir aux reflets éteints, et qui ne cesse inlassablement tout autant que désespérément d’assiéger ce qui a oublié qu’il ne pouvait que s’oublier. N’est-ce pas, par exemple, ce mur que dresse la conscience en sa croyance ânonnante et dont l’incoercibilité est détournée par le je s’en servant comme d’un pan, d’une cimaise, qui lui permet d’y projeter une image arrachée à l’autre ? N’est-ce pas aussi ce par quoi le je ne cesse de s’oublier en soi par l’autre, s’y employant par ploiement de soi, se ployant sans y faire aucun pli, et par lequel autrui devient son tabernacle, son tombeau ? Néants créés de toute pièce en une illusion sereine, pour oublier d’avoir peur, d’un je dont le jeu le fait se ployer devant toute peur.
Le je se joue ainsi de lui-même. C’est dans le creuset du possible que son imagination fulgure. Dans chaque perception que le possible lui offre, c’est un néant qui se cache. Et c’est lui, ce néant, qui l’accapare comme en un écho lointain, effet de miroir mais à la buée constante. Le néant y est pris comme simple possible et dont tout possible semble même devoir être poursuivi comme son ombre. C’est cette proximité du néant et du possible qui favorise alors tout un jeu de correspondance dans la variation de leur relation. Faut-il seulement s’y repérer, et dresser alors la carte que les possibles auront seulement permis de lever en l’infinité de nuances que le néant peut produire comme jeu avec lui, carte par laquelle chaque possible renvoie aux autres par un jeu d’écho, de résonnance, de filiation, de subsidiarité, de hiérarchie, de concurrence, de rivalité, que le néant aura provoqué dans leur rapport, autrement dit nécessitant d’édifier une architecture capable de ranger la totalité infinie de tous les possibles et les relations que chacun d’entre eux aura pu contracter avec tous les autres. La cascade des possibles se structure alors comme un grand meuble, faisant concurrence avec cet autre qu’est celui de la bibliothèque, meuble dont chaque tiroir est gros de ses propres tiroirs, chacun d’eux renvoyant à une infinité autant constitutive de ce grand meuble que de ce que chaque tiroir peut contenir comme autres tiroirs. Infini infiniment infini aura pu dire Spinoza. Jeu dans lequel le je se complaît, pour s’y retrouver dans ce par quoi ce meuble ne cesse de le faire perdre en lui-même. Effet virevoltant d’un je qui pousse alors à prendre tout néant comme possibilité d’être, et dont la conséquence entraîne alors le je à prendre toute possibilité comme devant nécessairement exister. Et c’est même cette possibilité qui contamine l’être, l’inflexion de ce jeu devenant index, le je infléchissant son jeu à l’être même, l’être devant exister comme cet être créé du néant, de celui que le je aura su logiquement tiré de tous ces possibles, de tous ses possibles. L’étant de l’être devient l’être de l’être aurait peut-être pu dire Heidegger, cet étant pris au possible.
Perdu en lui-même, dans tous ses possibles qui l’entraînent en la valse d’un néant se prenant pour l’être, mais incapable de se retrouver en soi, le je ne saurait par conséquent que se vautrer sur tout ce qui suit une sensibilité en action, s’étaler sur l’ombrage tourmenté d’une pensée pauvre et désuète, tout en triturant la face de l’autre en s’oubliant en lui et pour le masquer de son empreinte. Comment s’oublier ? Sinon en rêvant ! Mais sans pour autant faire du rêve un suicide, sinon le risque est de voir se planter devant soi ce Dieu, le je se prenant alors pour un moi, et dont le processus résulte de celui de la rigidification du néant dont la matérialité est la seule à correspondre à celle de la perfection. Il sera là droit et fier, puissant et plus que réel, ne cessant de ne pas s’omettre en soi, repoussant si loin les débris de ses anciens habits, ceux pris à son oubli qui n’auront alors plus d’autre sort que celui portant à devoir baisser la tête et disparaître on ne saura jamais plus où, et pour libérer cette place dès lors toute dédiée à la seule injonction de son attente, celle d’un espace infini et d’un temps éternel. Mais qui décide ? Ne suis-je le fruit que d’un pur hasard, celui d’un jeu divin de dés et qui gouvernerait le tout, m’épuisant tout autant à croire le contraire ? Ce hasard, ce je dans l’exercice de son oubli ! Et encore, il interfère dans cette vision qui suit mon être. Il englue tout. Ce tout qui disparaît en lui. Comment vivre sans être ce je ? S’éparpiller en tout, être cette substance spinoziste ? Etre dieu devant un autre, comment est-ce possible ? Mais alors, on ne peut faire autrement que d’être englué par ce je dans son éternité en retour, toujours et encore… Le je supprime l’être, le supplantant. Faisant basculer à volonté et à plaisir l’être dans le néant, et inversement, ce qui est encore plus horrible.
Le je ne se serait-il pas alors perdu dans ce rêve ? Il se peut. Mais où s’est-il caché pour avoir réapparu ? Il a fallu s’investir, tout d’abord. Se forcer à s’arracher à soi. Trouver un lieu propice à ce calme étouffant. Le je s’est tu puisqu’il faisait. Dans l’action, il s’est vu maître de son oubli. Cette action qu’il maîtrisait. Il a su aussi transformer ce qui l’environnait. Le changer, le recréer. Mais avant ceci, il a fallu qu’il écoute ce réel, et, là, il était omniprésent, se taisant. Il s’est confondu avec ce tout. Toute vision, toute perception faisait le jeu de ce je dans l’inaction. Mais cela était déjà une action. Ecouter, se remplir l’intérieur de l’extérieur est cette action impossible où le je se pâme de ce pouvoir omniprésent. Et c’est seulement après s’être accaparé de tout ce réel qu’il a commencé à en imaginer un autre. Le plaquant sur celui qui était déjà là. Le je était alors partout dans ce réel. Il a transformé ce qu’il était. Il s’est transformé dans l’insatisfaction de sa puissance dévastatrice. Et c’est là qu’il est entré en action. Mais pourquoi a-t-il fallu posséder ce qui l’entourait avant de le transformer ? A-t-il donc tant besoin de s’affirmer dans sa puissance, pour s’imprégner de l’existence ?
Ainsi le rêve a été l’œuvre de ce je. Ce je en fabriquant un autre. Ou plutôt fabriquant toute une illusion pour voir… Mais voir quoi ? Voir que la conscience peut être inconscience d’une autre conscience… Voir que le je peut fabriquer un autre je inconnu, qui, cet autre une fois créé, soit envahi par le je initial. Ainsi donc être maître de ce qui est et de ce qui n’est pas. Mais l’illusion est de l’ordre de ce qui est. De cet être du non-être. Un corps sans sexe, ange sans désir ni identité. Voilà donc l’être, ce mur transparent, se fuyant loin au-dehors de lui, mais toujours en dedans de soi. Qui se love et se cache en lui, en soi, comme pour se fuir, s’oublier, sans ne jamais le quitter. Illusion dont la texture diaphane relève de la structure existentielle de l’oubli. C’est du corps du je dont il s’agit et dont l’âme ne cesse de chanter l’autre, cet autre en soi par lequel le je s’oublie.
Le rêve est ce qui permet alors de passer à travers le mot, de la brique à partir de laquelle toute phrase se monte, tout discours se dresse. Il arrive ainsi à déjouer le piège dans lequel la conscience s’enferme sous l’impulsion d’un je et ses colifichets d’apparat. Il constitue comme ce vide que les atomistes de l’Antiquité ont su faire intervenir à la compréhension de la nature. S’immisçant dans la brique de tout réel, de toute structure atomique, le vide permettait dans le même temps d’en deviner la forme comme la formation. Il décillait toute l’architecture invisible constituant la matérialité de chaque chose, en découvrait les interstices les plus secrets, en repérait les coutures les plus fines comme les plus improbables. Le rêve aura fait de même révélant la structure sub-représentative de l’activité de la conscience, en en découvrant ce qui s’y cachait, qui d’une inconscience rivée corps et âme à la conscience en remarquait leur étrange convol, leur complicité duplice inavouée, leur jeu d’inversion à l’ambiguïté indissoluble. Ce qui, enfin, ouvrait l’univers du mot face à lui-même, le présentant comme cette nasse dans laquelle le je se presse incontinent et dont se joue le rêve, jeu qui aura tout autant permis de démasquer l’autre, d’y débusquer un autre, un autre masque, celui d’un je avec soi-même et le monde . C’est cette structure atomique c’est-à-dire originaire du je qui aura permis d’en retracer les arcanes, et dont la perception existentielle s’arrête à autre chose qu’à lui-même, mais percevant seulement le sens de son action, de ses bras jetés sans ne rien jamais pouvoir saisir, si ce n’est un monde empreint de sa propre marque, d’un jet sans corps, d’un masque sans âme. C’est donc le je, qui, dans le monde des mots, tombe dans sa propre nasse, qui, sans s’en apercevoir, ne fait qu’exprimer l’élan de ses espoirs, la vitalité de ses impulsions, le frétillement de ses harangues, l’impatience de ses attentes, la brûlure de ses angoisses, le cachot de ses éternités recluses. Le rêve en excède la sphère pour se faufiler à travers la grille serrée que les mots auront su tisser entre eux, tout comme l’eau ne saurait y être tout de même retenue, et faire des élans du je ce tabernacle secret aux atours mirifiques tout autant que mortifères. C’est donc au rêve auquel il faut se confier, à celui qui explore le monde des mots afin de ne pas tomber dans leur nasse, et délaisser le je dans l’ivresse insondable de sa décomposition, dont le suaire suintant la solitude cadavéreuse arrive encore à mélanger à ses odeurs pestilentiels des résidus de myrrhe et d’encens.









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer



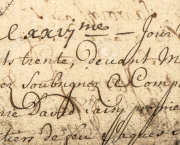


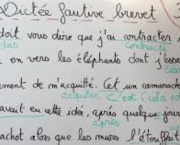
 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur