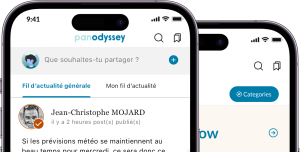Chasseur de chiens
 25 min
25 min
Chasseur de chiens
Je suis chasseur de chiens.
C’est un dur métier. Et il n’y a rien de plus désagréable, de plus agressif qu’un chien qui aboie. Entendre aboyer peut rendre fou : j’ai connu un homme autrefois que cette folie avait conduit au bord du gouffre, et il est mort défenestré.
Je chasse la nuit. De jour, les gens horrifiés s’indigneraient de mon travail. Ils ne comprendraient même pas que c’est pour eux, pour leur tranquillité que je fais tout ça. Pour ne pas qu’une jeune fille s’effraie de croiser un animal en vadrouille ; pour éviter qu’il l’agresse et, qu’étant apeurée elle fasse trébucher son fiancé en se jetant dans ses bras – je l’ai vu de mes propres yeux ! Ils étaient si beaux tous les deux ! Un chien s’est mis à aboyer, il a fait peur à la demoiselle, son fiancé a glissé sur le trottoir en voulant la retenir, il s’est tordu la cheville puis il l’a grondée et elle a éclaté en sanglots ! J’en étais si ému que je n’ai pas pu retenir mes larmes. Voilà pourquoi je fais ce métier et continuerai de le faire, tant qu’il y aura des chiens et des amoureux.
Parfois, lorsque je sens que le chien est bon, que c’est simplement un chien d’intérieur qui s’est perdu et qu’il a l’air de se repentir, je le livre à Jésus. Car je ne suis pas un tortionnaire et je ne supporte pas la cruauté. Jésus aussi a un bon fond ; c’est un collègue de travail en quelque sorte : il est transporteur de chiens. Nous nous soutenons mutuellement, surtout dans les moments difficiles. Je ne résiste pas, de temps en temps, à l’invite de Jésus, et nous allons échanger quelques mots en buvant de l’alcool fort dans un bar qui ferme tôt le matin et qui est excentré. Nous y allons avec le camion de Jésus, accompagné par les gémissements des chiens qui se font entendre à notre descente, juste avant le claquement des portières. Jésus parle beaucoup, et je l’écoute d’abord avec une grande et sincère attention me raconter ses histoires de famille ou bien me parler du Portugal, son pays. Ensuite, mon attention se relâche et je ne peux empêcher ma pensée de divaguer, des images se font et se défont ; elles passent par les chiens, reviennent à mon camarade portugais puis s’envolent encore où bon leur semble, mais j’entends Jésus qui continue de parler, entre deux verres et cela me fait rire. Quand nous remontons dans le camion et qu’il me raccompagne jusqu’à la station d’autobus, je suis gagné par la tristesse : je ne comprends pas comment le transporteur de chiens a pu raconter toutes ces histoires sans que je l’écoute, comment il se moquait bien que je l’écoute ou non. Moi qui n’ai personne à qui parler, je me couche en pleurant. Je me souviens d’une fille avec qui j’ai vécu quelques mois par le passé : elle était si jolie que je pleurais en la regardant. J’étais submergé par une joie immense et une immense tristesse ; c’est un peu pour cela que nous nous sommes quittés, mais je crois bien, cependant, qu’elle ne l’a pas compris. Avant de m’endormir je songe à tout cela en même temps.
Pendant mon travail, le plus souvent, je ne fais pas appel à Jésus. Je finis ma besogne seul, en frappant , frappant encore le crâne canin pour qu’il cesse d’importuner la paisible existence des gens. Avant qu’elle cède, parfois, la petite tête me regarde, ses yeux sont suppliants. Si je me laissais faire, ils en deviendraient émouvants, mais je frappe, je frappe jusqu’à ce que ce soit fini. C’était un supplice , ça ne l’est plus. Certaines nuits, je me dis que je suis une sorte de justicier méconnu, qui fait le bien pendant que dorment les bonnes gens et je crois réellement être en mission pour le Seigneur.
Une fois, il y a eu un Yorkshire : je lui ai filé presque machinalement un coup de pied dans le museau et il est mort sur le coup ! Dès qu’il m’a vu il s’est approché de moi, en gémissant – du moins ai-je cru qu’il gémissait – alors je lui ai flanqué mon pied dans la gueule, comme ça, sans même un haut-le-cœur, et lui, il s’est arrêté de vivre, tout net, sans un cri !
Je n’ai pas eu le temps de m’étonner de voir un Yorkshire égaré en pleine nuit, sur un trottoir, car sa maîtresse est apparue, peu après lui, alors qu’il gisait déjà, la tête dirigée vers la rigole, la langue entre les dents.
C’était une grosse dame, dodue de la poitrine, avec d’énormes fesses ; elle était encore toute maquillée ! Elle a d’abord regardé son petit chien qui m’a semblé soudain minuscule, puis elle m’a vu et elle a longtemps pleuré. Je n’ai rien fait d’autre que la consoler cette nuit-là. J’essayais au mieux de la rassurer, d’être gentil, bien que je ne me sentais pas à l’aise serré dans ses bras. Je lui disais « ce sont des choses qui arrivent, on ne peut pas prévoir », elle geignait « on les aime et ils vous quittent ». Je lui racontais le Paradis des Chiens, m’aidant d’un conte Japonais que j’avais entendu un jour, il y a longtemps, au théâtre, au temps où je vivais avec Rosa. Le théâtre, tu parles ! J’étais gêné, mais elle pleurait. Alors, pour m’en débarrasser, je lui dis qu’il avait eu une belle mort, sans doute à l’image de sa vie, mais elle le traita d’ingrat, l’implorant de revenir immédiatement.
Elle n’a pas su que c’était quand même moi l’assassin. Il faut dire que moi-même j’avais fini par l’oublier.
Je partis sans me retourner puis, comme j’étais assez loin, je jetais des coups d’œil à la dérobée, avec l’impression qu’on aurait pu me découvrir. Elle était accroupie à côté de son chien, le caressant sans doute. Même mort il restait son chien. Peut-être demeurerait-elle là toute la nuit.
Plus tard, comme l’assassin qui revient sur le lieu de son crime, je suis repassé par là ; j’espérais vaguement revoir la grosse dame. Le trottoir était vide, et rien n’indiquait qu’à cet endroit un meurtre avait eu lieu. Les fenêtres alentour ne laissaient entrevoir aucune lumière. Tout dormait paisiblement.
J’ai été un peu triste, étonné aussi de ne pas les retrouver là tous les deux. Elle avait dû emmener le cadavre de son Yorkshire avec elle, et peut-être même s’était-elle couchée puis endormie à ses côtés. C’est bon de dormir au côtés d’un corps chaud, mais celui-ci devait être bien froid à cette heure.
En terminant ma ronde je constatai que Jésus avait une fois de plus œuvrer avec efficacité, et discrétion : il ne restait pas un seul corps de chien dans les rues, pas même une ombre de corps oublié, gisant là comme par inadvertance ; excepté un être tout à fait parfait, nul ne pouvait sentir que quelque chose s’était produit ici ou là , durant cette nuit ordinaire, et qu’un esprit canin flottait parmi les choses, dans les brumes du matin.
Puisque je n’avais pas sommeil et que j’avais encore du temps devant moi, je décidai d’aller au bar de nuit, prendre une pause en attendant de rentrer chez moi. J’étais en paix avec moi-même, je ne pensais pas à mal, je n’avais en tête que de pieuses images, c’est pourquoi je n’ai pas réalisé pleinement qui Pascalhait devant moi, lui la tenant par la taille, elle lui entourant le cou de son bras court et charnu. C’était donc eux : Jésus et la grosse dame, la grosse dame et Jésus ! Ils s’étaient rencontrés ! Effectivement, je vis ensuite et presque en même temps le camion fatigué rangé sur le côté. Sans doute avait-il pénétré dans la rue pendant sa ronde, et sans doute s’était-il arrêté dans le but de ramasser le chien mort, et c’était elle qui l’avait attendri, qui lui avait demandé un soutien de ses yeux suppliants, et il s’était laissé faire, le bon bougre !
Lorsque j’ouvris la porte ils n’étaient entrés que depuis quelques secondes, pourtant je ne les remarquai pas immédiatement. Je cherchais mon souffle, respirais différemment, prenais mes repères. C’est alors que je les vis.
Ils s’apprêtaient à s’asseoir, elle quittant son manteau, lui éloignant la chaise de la table, une de ces tables dans la pénombre que se réservaient sûrement les amoureux. Jésus et la grosse dame !
Je leur fis un signe qu’ils n’aperçurent pas ; aussi j’hésitais à me diriger vers eux, n’osant pas les importuner.
Je suis timide. Le bonheur des autres me fait peur. Je déteste plus que tout perturber les liens ténus qui se tissent à tâtons, les prémices poussives qui sont le lot de toute relation. Un instant, la pensée qu’ils ne m’avaient ni vu ni entendu à cause du bruit et de la foule me mit en mouvement dans leur direction. Mais j’eus mieux fait d’écouter l’intuition de mon cœur. Car, à quelques pas de la table je fis de nouveau signe à Jésus surprenant même à lancer un salut en portugais à mes amis ; ils ne l’entendirent pas. Ils ne levèrent pas les yeux vers moi, qui pourtant étais venu vers eux ; et je restais planté là.
Je crus encore, dans ma généreuse naïveté, qu’ils conversaient intensément et que mon salut, timide après tout, avait été couvert par leurs paroles pleines. Mais ni lui ni elle ne parlait. Ils étaient probablement perdus dans leurs pensées, ou bien abîmés dans une contemplation intérieure qui ne souffrait aucun dérangement ! Moi-même, il m’arrive assez souvent de ne pas entendre les mots que l’on m’adresse, lorsque je suis en train de dialoguer intérieurement.
Je demeurai immobile et pour ne pas avoir l’air trop ridicule, à moins que ce ne fut pour tromper l’attente, je m’en pris au garçon, que j’apostrophai fermement en commandant une pression ; j’espérais, et pour tout dire je m’attendais cette fois-ci à ce qu’ils me reconnaissent. La grosse dame avait allumé une cigarette, elle fumait sans détacher ses yeux de Jésus, tandis que le chauffeur de camion détourna son regard qu’un instant auparavant j’avais cru posé sur moi. J’eus un mouvement de recul instinctif, et, titubant, heurtai quelqu’un qui m’injuria, puis je me sauvai à grandes enjambées.
Dehors, je m’imaginais quelle sorte de relation s’était établie entre le transporteur de chiens et la veuve, ce qu’il était en train de lui raconter à cette heure, quel genre de baratin elle devrait se contenter d’entendre, et à quelles pitoyables plaintes il serait contraint de compatir. Je voyais leurs mains se mouvoir et jouer avec les éléments en présence, leurs bouches se tordre dans un échange verbal fait de ruse et d’amertume. Oui, elle affronterait ses phrases. Au moins autant sur les chiens que sur le Portugal ; et peut-être même elle en serait ravie. Mais il ne lui parlerait pas de sa femme ni de ses enfants. Elle devinera bien quel genre d’homme c’est mais elle s’en fichera ! et ensuite, lorsqu’ils auraient bien bu, ils s’en iraient ensemble, bras dessous, bras dessus, se coucher tous deux sur le mauvais lit d’un hôtel paresseux.
Je jetai un dernier coup d’œil derrière moi. Je vis le camion bancal, abandonné. Je savais qu’une souffrance commune nous unissait, dont il faudrait bien nous débarrasser ; que du moins il partageait mon émotion : il avait l’air amical qu’on les gens compatissants, ceux qui savent pleurer lorsque pleure un être, même s’ils ne le connaissent pas, même s’il n’est pas leur ami.
J’ai compris qu’il valait mieux ne pas nous revoir, Jésus et moi ; aussi je ne suis pas retourné au travail le lendemain, ni le surlendemain. Et, comme ils ont cherché à me joindre, parce que je ne pouvais pas partir sans donner de raisons, j’ai fait le mort. Je suis resté silencieux, assez longtemps pour qu’ils abandonnent d’eux-mêmes cette embêtante idée d’essayer d’en savoir plus ; de toutes les façons, cela n’aurait servi à rien ; d’en apprendre sur mon compte ne leur aurait pas apporté beaucoup.
Je passais toutes mes journées au lit à sommeiller, à lire ou bien à imaginer dans quelles rues je me promènerai la nuit venue ; car, bien entendu je réservais mes nuits à la flânerie. Il n’était quand même pas question que je fasse l’impasse sur cette habitude. Vivre dehors à la belle étoile, l’agitation du jour, son affairisme redoutable s’étant tout à coup tu, restait une activité nécessaire, au même titre que dormir ou respirer. Je n’allais pas m’empêcher de respirer !
Quand je suis dans mon lit, le plus grand des malheurs me semble tout petit ; parce que je refais ma vie à volonté, je crois impuissante la plus méchante des pensées, et rien n’est en mesure de me déstabiliser ; même la plus mauvaise des actions dirigées contre moi. Car je sais qu’avec la nuit, ce sont des myriades de possibilités nouvelles et inexploitées qui vont s’engouffrer dans les rues, venir par les boulevards et les avenues s’éparpiller un peu partout et régner sur la ville. Elles sont comme autant de petites fées jouant à cache-cache avec les hommes, s’amusant de leur maladresse, mais ne se piquant jamais d’être découvertes puisqu’elles se donnent en récompense à celui qui les surprend ! Il suffit d’être là, d’avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et un monde disponible s’offre à nous !
Pourtant je sais que ce monde a un prix, à en juger par le nombre incalculable de convocations, de menaces proférées à mon endroit pour me ramener à la vie diurne. Et tout ceci n’est rien comparé à toutes ces lettres sûrement amicales auxquelles je n’ai pas répondu, à tous ces appels téléphoniques que je n’ai pas reçus.
Les premiers temps, j’ai profité de ce que je n’avais plus rien de précis à faire pour apprécier mes promenades. Mes rêves ponctuaient agréablement les rencontres que je faisais parfois au hasard des rues. De temps à autre j’emmenais un livre avec moi, et je passais ainsi des heures formidables à lire, ici et là ; m’arrêtant quand je me sentais inspiré, repartant lorsque le cours de l’histoire l’exigeait.
Et puis, il s’est passé quelque chose : un attroupement s’était formé autour d’un homme qu’on passait à tabac. Les coups de poing et les coups de pied fusaient, et des bruits insupportables se faisaient entendre à chaque choc, à chaque fois qu’une attaque s’abattait sur le corps, malgré les cris, mêlés de haine et d’épouvante. Bien que prêt à chaque instant, à chaque nouvel assaut, bien que prêt à intervenir, à faire cesser cette mise à mort insoutenable, je restais immobile, pris dans l’étau du refus de voir ce qui se passait sous mes yeux.
La souffrance et la peur. Moi le lâche, le voyeur, j’étais écrasé. Mon propre corps m’abandonnait.
A un moment il m’a semblé, je ne saurais dire, il m’a semblé que c’était Jésus que ces hommes rouaient avec tant de méchanceté. Mais ça n’avait pas de sens ! Puis, en un éclair, la meute se disloqua, comme sous l’impulsion d’un instinct de fuite, plus fort encore que celui qui les avait précipités au combat. Le cercle fut rompu, le rite brisé ; et, tandis que tous se mettaient à courir, je vis avec une horreur béate, dans l’éclatement de la scène, le corps du transporteur de chiens. Il gisait, apparemment sans vie, sur le trottoir. Peut-être avait-il simplement perdu connaissance ? En tout état de cause il fallait qu’on l’emmène à l’hôpital avant qu’il ne périsse des suites de ses blessures ! Mais peut-être était-il déjà mort. Et cette pensée, qui aurait dû me glacer le sang, sous le poids de laquelle je devais tomber à genoux, me troubla bien autrement : il me sembla qu’une flaque de sang l’entourait, dont il était le centre – mais était-ce Dieu possible ? – que des reflets profonds dessinaient d’improbables figures sur sa surface ondoyante.
Je voyais des étoiles tenir des mains d’enfants, je les voyais danser une ronde, puis tournoyer en un tourbillon de lumière et d’amour. Un chœur inouï se faisait entendre de toutes parts. La voûte céleste s’était ouverte et aspirait mon ami.










 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer







 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur