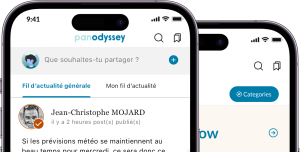Seule la violence...
 11 min
11 min
Seule la violence...
«Seule la violence paie ?»
Pas si sûr…
Seuls les êtres humains qui croient encore au progrès moral de l’humanité sont en mesure d’y concourir. Il me semble qu’aujourd’hui toutes celles et ceux qui se soucient de rendre le monde moins injuste et moins violent ne peuvent que donner raison au philosophe Kant sur ce point. Mais peut-on encore y croire ? Et peut-on tenter d’y concourir - si peu que ce soit - en écartant a priori tout recours à la violence ? Aujourd’hui, certains problèmes sont devenus si aigus et la nécessité d’y apporter une réponse si urgente qu’on ne peut se contenter d’attendre tranquillement que la Justice fasse ce qui est en son pouvoir – le droit international est très dynamique sur les questions environnementales – et que les artistes, les experts et les philosophes, à force de nous alerter, finissent par obtenir que nous sortions de notre léthargie.

Qui a encore le droit d’habiter cette planète ?
Dans ce nouveau contexte, la question est celle de savoir si, face à l’extrême violence que le monde moderne induit et qui nous détruit, à petit feu pour les plus chanceux, avec une célérité et une le brutalité inouïes pour les autres, nous devons continuer de privilégier les stratégies non-violentes, si lentes à porter leurs fruits. Ou si, au contraire, nous devons envisager d’autres options. Certains continuent de préconiser le recours à des formes d’insurrections violentes, des activistes radicalisés refusent de l’exclure, tandis que des communautés immédiatement menacées dans leurs intérêts vitaux se disent prêtes à y recourir. Aujourd’hui les indiens d’Amazonie voient leur survie remise en cause du fait de la destruction de leur habitat, bientôt amplifiée comme le promet le gouvernement de Jair Bolsonaro. Pourront-ils se contenter de lancer des appels désespérés à la communauté internationale ?
Au-delà de ces cas particulièrement dramatiques, le débat opposant les partisans de la non-violence et ceux qui, sans être ouvertement partisans de la violence, restent dubitatifs concernant les chances de réussite des rebellions non-violentes, est particulièrement vif dans le contexte des luttes en faveur de l’environnement. Faut-il respecter la loi avant tout, lorsque des bulldozers viennent abattre des arbres qui abritent des communautés menacées, et qui sont, en outre, si précieux pour la planète tout entière ? Lorsque les autorités décident de saccager des zones humides pour construire des ouvrages inutiles et potentiellement dévastateurs pour l’environnement ? Non, bien sûr… Mais alors, jusqu’on peut-on aller ? La désobéissance civile inclut-elle les moyens violents ? Et la destruction de la planète n’est-elle pas, de toutes les violences, la plus brutale et la plus suicidaire qui soit pour l’humanité ? Si les indiens d’Amazonie prennent les armes pour résister aux bulldozers d’un gouvernement d’extrême droite, qui leur en fera grief ? Leur désir de persévérer dans leur être n’est-il pas légitime et leur résistance à ceux qui programment leur disparition n’est-elle pas du même ordre que celle qui opposa les résistants et les Justes aux nazis ? Leur cas est emblématique. Tout se passe comme si certains chefs d’Etat et capitaines d’industrie s’étaient octroyé, une fois de plus, l’étrange privilège de décider qui a le droit d’habiter sur cette planète.
Dans Le mal qui vient (Cerf, 2018) le philosophe Pierre-Henri Castel estime que, si nous ne vivons peut-être pas encore les débuts de l’« effondrement » de notre civilisation, nous entrons d’ores et déjà dans le « temps de la fin ». Cela signifie que l’échéance – une planète devenue inhabitable pour de nombreuses communautés ou nations – s’inscrit dans un horizon proche. Cette période se caractérise, entre autres, par le choix que font quelques personnes « puissantes et bien informées » de nier l’évidence de la catastrophe à venir pour demeurer le plus longtemps possible les seules à « continuer de jouir du monde ». Face à ce nouveau Mal, celui des débuts de l’effondrement inéluctable, il serait temps, selon l’auteur de ce brûlot, de promouvoir une toute nouvelle conception du Bien : « Il pourrait ressembler à ce qui nous semble aujourd’hui être le mal, car il a des crocs et des griffes, et il implique de se battre contre ceux qui jouiront – ou jouissent déjà ? – de la destruction collective. »
Se battre, certes… Mais avec quels moyens ? Et comment espérer vaincre quand on ne dispose que d’armes dérisoires et de forces dispersées face à la très grosse artillerie des puissances étatiques, toujours prêtes à en découdre, et au front des industriels et des ingénieurs « bien informés » ? Selon une étude de deux chercheuses américaines, les stratégies non-violentes sont paradoxalement, et tout bien considéré, plus efficaces que les résistances armées (a fortiori celles qui ont recours au terrorisme). Mais, pour être efficaces, elles ont besoin d’être soutenues par une part non négligeable de la population concernée (3,5 %) et relayées à l’échelle internationale. Or un tel soutien est moins difficile à obtenir lorsque les communautés mobilisées renoncent à utiliser d’autres armes que celles de la parole et de l’interpellation.
Toute considération morale mise à part, la plupart des jeunes activistes écologistes estiment que la violence est aujourd’hui inefficace et même contre-productive, parce que les observateurs, c’est-à-dire tous ceux qui ne sont pas directement impliqués, désapprouvent a priori toute forme de violence, quelles qu’en soient les raisons. Il est difficile aujourd’hui de gagner l’opinion publique à une cause en brûlant des voitures, en caillassant des gendarmes ou même en vandalisant des boucheries : l’hostilité rencontrée par les activistes vegans en dit assez long sur ce sujet !

D’une « guerre » à l’autre
Il serait donc préférable de se tourner vers des nouvelles stratégies offensives qui ne sont violentes que symboliquement et dans le cadre de combats et de luttes dont le bien-fondé est solidement établi. Le succès inattendu rencontré par le mouvement #MeToo démontre que l’on peut obtenir des changements sensibles en se fondant seulement sur les nouveaux outils de la communication. Certaines opérations spectaculaires et symboliques menées par Greenpeace, Extinction Rebellion ou Alternatiba relèvent de cette même logique. Les actions-limite de certains activistes écologistes vont dans le même sens. Demain, des grands rassemblements pacifiques des jeunes du monde entier en faveur d’une politique respectueuse de la planète porteront peut être enfin leurs fruits.
Ce que ces exemples démontrent, c’est qu’il est possible d’être offensif, tout en s’abstenant d’entrer en « guerre » - à proprement parler - contre le camp adverse, même si celui-ci rassemble des oppresseurs et des criminels avérés. On ne peut que célébrer ici tous ces combats non-violents et couronnés de succès qui ont pour objectifs la défense de zones fragiles (« ZAD »). La résistance des femmes contre l’oppression patriarcale, le combat pour la survie des communautés menacées par les acteurs du dérèglement climatique et tous les lobbyistes du climato-scepticisme, la lutte pour la reconnaissance des droits de toutes les minorités opprimées et de tous les déplacés à travers le monde, ne débouchent pas nécessairement sur des conflits meurtriers. Ce sont des combats d’ordre politique. Or la politique n’est pas la guerre, ni la violence. Tout au contraire, elle demeure le meilleur moyen d’écarter le risque de la première et de limiter les conséquences funestes de la seconde, voire le seul espoir d’envisager un jour d’en venir – au moins partiellement – à bout.









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer










 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur