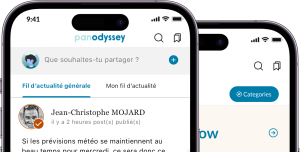Lettre à la transcendance de soi
 51 min
51 min
Lettre à la transcendance de soi
Lettre à la transcendance de soi
Lettre à moi-même, à ce que je fût, à ce que je serai…
Certains souvenirs sont trop authentiques pour être doux.
Il y a toutes ces formes que prenaient les instants, toutes ces couleurs offertes au regard.
Et le goût suave des joyeuses coïncidences. Toutes ces choses qui arrivent simplement comme un oiseau se pose.
Le rythme. Les cycles biologiques. Les corps qui grandissent alors que d’autres mûrissent. Un monde abouti, finalisé, embaumé.
De cette conscience, J’en ai la pratique.
De fil en aiguille et de joie en fantaisies, les euphories portées en gloires. De l’amour que l’on sait plutôt que d’y croire. J’en ai la pratique.
Quand chaque sens a pris sa place et donne la direction juste. Vous savez ? Quand toutes les directions indiquent le Nord, comme si les autres lieux n’existaient pas.
Aux croyances, on préfère les certitudes. C’est rassurant.
Les doutes pourrissent dans les chairs, faute de lumière. Et les chairs deviennent grises. C’est le risque.
Et puis, il y a ces souvenirs trop beaux pour être vrais. Que l’on a sans doute embellis pour les circonstances. Comme un cadeau que nous aurait fait la vie alors qu’il s’agit d’un présent fait à soi-même. Toujours là, prêt à l’emploi, on se sert quand on veut.
J’en ai la pratique, et en fait bon usage.
Quant aux souvenirs éclatants de bonheur, parce que c’est maintenant que rien ne va. Ceux-là se lamentent et me font pleurer. Je les reconnais pour les avoir perdus. Ils rient devant mes yeux, remplis d’orgueil, comme des mouettes moqueuses et criardes narguant le ciel de savoir voler. Leurs ailes domptant le vent, parce que la fierté a besoin du vent.
Mais le vent ne voit pas la fierté, il s’en fiche.
Les souvenirs m’agacent. Ma mémoire se joue d’eux pour m’aider à vivre. Bien que me souvenir de vous renforce mes craintes, je vous écris. Malgré votre naïveté, je voudrais me faire comprendre et me relier à vous alors que vous n’êtes plus.
Les choses sont peut-être à leur place. J’en doute.
Vous n’êtes plus là, et ça je le sens.
Mes pieds, ma tête, la mobilité de mes membres. Cet ordre biologique qui gouverne mon corps. Les boucles que forment mes cheveux. Toute cette mécanique me déteste. Vous me manquez.
Mes pensées se tordent sous l’effet morbide qu’a provoqué votre disparition. Où êtes-vous ?
Très chère que je fus, je vous attends.
Telle une course perdue tournée vers l’échine de soi, je me tourne le dos.
L’horizon de vous s’est égaré, confondu avec ce qui reste au regard quand le soleil se couche.
Le lit contre le mur de ma chambre. L’épaisse couverture. La mouche collée au plafond. Tout se dérobe, s’achève. Les choses se vident, jusqu’à l’air que je respire appauvrissant mon oxygène. Les objets sont abandonnés. Vous avez tout laissé.
Les heures aussi ont changé. Seule votre jeunesse s’attarde encore sur mon visage. Comme un espoir, un bouton de rose, quelque chose qui va éclore.
Je vous attends, je vous espère.
Mais l’absence insiste. Vous avez toujours été têtue. En retard aussi, vous étiez.
Je reconnais là votre empreinte indélébile, marquée au fer rouge sur le moindre de mes actes.
Et pourtant plus rien n’existe. La transparence. La ténébreuse transparence.
Une course fantomatique. Celle de la souffrance que la bizarrerie aide à supporter. Je vous veux toute. Entière et plus innocente encore. La souvenance devrait vous ramener, puisque dans nos esprits tout se crée.
Ma folie est une poésie. Elle personnifie. Dans les métaphores de la vie, ce sont nos rêves qui prennent consistance.
Je veux vous sentir, vous voir, vous toucher, pour être sûre que je ne rêve pas. Si vous revenez, Je vous préfère bête et sauvage. L’érudition et la sagesse épuisent tout courage.
Malgré tout, l’odeur de vous persiste. Je la respire partout sans gaspillage. Ce parfum léger d’insouciance qui hume la violette et les bonbons de notre enfance. Cette vertu de l’olfaction, vrai trésor du corps, qui à elle seule pourrait réveiller toutes les mémoires.
J’en use plus que la mesure.
Amertume des violettes déjà fanées. Le printemps veut s’enfuir déjà. Cette saison dont vous vous en fichiez. Je la découvre sans vous. Pardonnez-moi cette inconstance, mais je crois que depuis que vous n’êtes plus, la nature est plus séduisante. Vous ratez quelque chose, je crois !
Chaque matin, les oiseaux chantent. Était-ce donc vous qui me priviez de cette romance ?
Était-ce donc vous qui voiliez mon visage alors que je n’étais pas encore troublée ?
A présent, tout se dévoile, et tout se voile, comme un jeu de cache-cache. Je vous cherche. Me cherchez-vous ?
Qu’attendez-vous de moi dans cette absence ?
Il me manque quelque chose.
Vous, je crois.
Et finalement, de vous à moi, qui êtes-vous ?
Je ne peux m’accorder au singulier, tant la durée fait le nombre.
Dans la coulée du temps, il y a aussi la multitude de tous mes êtres incarnés. Je vous connais depuis si longtemps !
Je vous vois comme une addition. Une multiplication. Dans la mathématique de nos raisons communes, je perçois la géométrie de nos corps. Symétrie parfaite. Confusions des angles. Votre peau me touche encore. Frisson sublime, quand je sens votre caresse. Doucement, je tremble lorsque que trop tôt votre chaleur s’estompe.
Votre absence alors, m’éconduit loin de nous. Loin de ce que nous fûmes. Ensemble.
Je vous ai perdu. Plus jamais je ne vous verrai…La mort. Le deuil. Le temps qui court. Les saisons se succèdent et vous chassent.
Du printemps, j’en fais le renouveau. Pour m’extirper de vous, surannée, égoïste. Porter des branches emplies de fleurs, les embrasser, les manger. Sans jamais les poser sur votre tombe. Jamais. Des brassées violentes, aux couleurs qui vous auraient agressé le regard. Tant-pis si vous n’aimiez pas ce qui dorénavant m’exalte.
Et puis la nuit revient…L’inconstance déplorée de Montaigne. Je n’aime plus les branches fleuries que j’ai mangées. Elles me remontent dans l’œsophage comme un regret. Je n’aurais pas dû. Je vous aimais.
Aucunes étoiles dans le ciel, et le noir persistera jusqu’au matin. Des ombres fatiguées flottent par couches successives enveloppant nos souvenirs, et ce qu’il reste de nous. Mes rêves sont lourds cette nuit. Des images usées et poussiéreuses s’entassent. Comme un déménagement. Il faut partir. Il faut revenir aussi. Peut-être.
Une odeur de vieux se répand dans la chambre. Le matin ça sent le moisi. Il faut changer les draps. Aérer. Quelque chose pourrit quelque part. Je n’ai pas la force de chercher. C’est sans importance.
Il faut que je vomisse. Toute la journée je rends les fleurs macérées de votre tombe. Ce jour est aussi sombre que la nuit. Tout ce vomi répulsif sur le sol pour vous extraire de moi, pour vous éloigner.
Pardon, ma chère. Ma raison s’égare. Le corps est plus fort. C’est lui qui se sert de moi. C’est de sa faute si vous êtes partie.
A la fin du jour, toute la souillure est sortie. Je me sens mieux. Je veux encore des fleurs… Mais l’odeur chaude de ce qui reste infeste la maison. J’ouvre les fenêtres. Je crois vous voir revenir. Plus de symptômes, le corps se calme. Mes yeux ne portent plus d’ombres sur les murs. Il fait trop sombre… Et vous êtes là !
Le lever du jour vous emporte. J’ai dû vous rêver. Cruels espoirs qu’attribue la nuit !
Porter mon corps sur le tapis. Le traîner jusque la cuisine. Et sentir la brûlure agréable du café laver la salissure, en regardant les ombres que la lumière m’inflige, comme un supplice.
Le bonheur est souvent petit et ne vient jamais seul. J’ai malgré tout le choix. Aujourd’hui la délectation immédiate du café. Permettez-moi de vous dire ce plaisir : Il y a le café qui fume dans la cafetière. Et le parfum soutenu qui fixe l’instant, mais que j’attends. Le bruit, lorsque le noir profond se déverse dans la tasse. Et enfin le velours doux et amer du breuvage vénéré, dans ma bouche, dans ma gorge, dans ma conscience. Parce que je ne sais pas si c’est le goût, la chaleur ou l’idée qui agit à cet instant. D’ailleurs sait-on vraiment ce qui se passe quand ça se produit ? Une sensation s’ouvre. Quelque chose bouge.
Sans définition. Ce plaisir-là est une abstraction. Telle une mise en page, parfaite, mais sans les mots.
Donc je bois. Par petites gorgées. La quantité contrôle le plaisir. C’est une question de mesure, d’espace entre les perceptions. Et par moment des blancs littéraires établis par la patience, des trous dans l’instant, des jours et des nuits qui se succèdent, des cycles comme des habitudes. Tout se définit ainsi.
La réitération. La quête.
Mais le plaisir est autonome. Il a son tempérament. Aussi parfois, alors qu’on le croit arriver, il ne vient pas. Parce que c’est lui qui décide.
Les bonheurs que l’on retrouve sont si rares.
Sachez très chère ; que le plaisir est une grâce que la maitrise assassine.
Comme un papillon, le plaisir s’attrape au vol !
Aujourd’hui, malgré le soleil, je suis restée dans notre maison. J’ai trouvé des lettres de vous. Et je crois finalement qu’en dépit de tout ce que j’ai lu, vous apprenez plus de moi que j’ai appris de vous.
La lumière tombe déjà sur vos mots. J’ai passé toute la journée à lire. Je vais dehors saisir le reste de clarté que laisse encore le jour. Mes yeux sont fatigués. Ce sont mes pas qui me guident. Ils ouvrent la marche. Je présume que vous me suivez. Et vos pas dans les miens, ma démarche s’alourdit. Je vous traîne, je crois.
J’ai oublié de manger les fleurs.
L’angoisse, la peur, les victoires, je cache tout…
Il y a un coin dans le jardin que vous ne connaissiez pas. J’y dépose toutes mes découvertes. Et Dieu sait s’il y en a ! J’aurais aimé les partager, mais vous n’auriez rien compris. Ce n’est pas que mon esprit soit plus brillant que le vôtre. Mais je dois avouer que votre disparition a eu l’étonnant pouvoir d’allumer en moi de nombreuses sources de lumière. S’il était encore possible de nous rejoindre, nous aurions la gloire des dieux dans nos bras réunis. Vous me manquez.
Je vous parlais de ce coin de jardin. Sous le grand chêne derrière la maison. Vous savez, celui dont le tronc s’ouvre comme une plaie béante où jamais vous ne vouliez entrer. Ce n’était pas la peur qui vous empêchait. Vous mentiez, je le savais. Mais sans vouloir vous blesser, j’ai toujours su que c’était par manque d’intérêt pour la nature.
Tout ce sauvage, cet indomptable que vous craigniez sans le savoir. Si je vous disais tout ce que j’ai niché dans le creux de cet arbre, vous auriez peur. La lucidité est si terrifiante, que nous passons notre vie à nous en détourner, alors qu’il suffit de la regarder en face pour qu’elle rayonne. Tenez ! Cette douleur qui me décroche la mâchoire et le visage ; Si je prends le temps de l’observer et de l’entendre, elle change de costume, elle se déguise, parce qu’elle a peur. Si je m’approche d’elle davantage, comme on dompte un animal farouche, je peux voir dans son regard toute une histoire qui se raconte. Vous connaissez ? Ces contes qui guérissent. C’est un peu cela, vous comprenez ? Alors je conçois que vous appréhendiez de connaître toutes ces choses vraies cachées dans le creux de mon arbre. Vous aviez peur qu’elles vous racontent l’histoire la plus singulière qui soit : la mienne.
La vôtre aussi. Vous savez ! La vôtre aussi…
Et dans ce creux caché, le meilleur de moi se terre, le mal aussi. Enfoncés dans un même trou. Je guette les premiers signes de chaque graine. Le subtil mélange de ce qui me reste de vous et de ce que je vous ai laissé. En pépinière. J’attends dans le silence, que quelque chose germe. Cette patience par exemple, l’aviez vous ? Je ne m’en souviens plus. Je sens notre éloignement lourdement peser sur ma mémoire. Cela vous rend plus fragile encore. Moins accessible. L’attente sans repère, sans ancrage.
Dans ce creux de l’arbre, je médite, construisant un monde où vous et moi sommes réunies. C’est parfois magique, mais souvent insupportable. Tout ce que j’ai à vous donner vous insulte. Je me hais de vous heurter à ce point. Votre blancheur contre mes blessures. Votre sagesse contre ma douleur. Mes doutes contre vos espérances. L’union n’est plus loyale. Comment vous séduire ?
Personne ne sait ce trou dans l’arbre, ce trou dans ma vie. La béance de l’être face au néant. Ma présence est plus lourde encore que votre absence. J’ai mal. Comprenez-vous ? Connaissez-vous la douleur ? Celle qui dépouille. Cette déchirure de soi. Cette séparation avec le monde. L’isolement pour masquer l’insuffisance des mots devant le subtil langage du corps.
Un désert infesté de silence.
Son tronc est large et l’écorce cossue, il donne une impression d’éternité. Je m’assois à même le sol, sur un tapis mousseux.
Si vous étiez là, je vous autoriserais à m’observer, immobile, le corps souffrant et le regard maintenu comme dans une brèche. Vous m’aideriez ; N’est-ce pas ? A percer le langage du corps.
La conscience des maux est autonome, comme le plaisir. Il faudrait chercher l’étymologie de chaque blessure, conjuguer nos croyances, et analyser la douleur comme on s’identifie. Nos esprits scientifiques au service de l’âme. Vous seriez le témoin et moi la patiente. Mais je noterais tout. Je ne veux rien rater, ni être la victime. Ce serait notre laboratoire.
Mais je rêve. La seule chose qui sorte de ce tronc est « ma poésie ». Prémices de la liberté. Allégorie de l’être. Des mots, toujours des mots. Et mes douleurs… Mes douleurs aussi. En m’adressant à vous, je crois comprendre. Si la douleur est un « doux leurre » ; que serait donc ma souffrance si elle n’était pas douce ?
Je sors du tronc. Je vous y ai laissée. Pardonnez-moi, je dois me protéger. Les mots restés dans l’arbre sont d’un autre temps ; seuls les espaces entre eux savent encore germer. Leurs tiges ligneuses percent l’écorce pour arborer d’autres secrets…d’autres mystères.
La nuit est tombée. Je me fraye un passage entre les ombres absentes. D’ordinaire la nuit vous garde éveillée. Je sais que ce soir je vous ai laissée dans le creux noir du chêne. Je trouve mon chemin toute seule.
De cette échappée, j’ai ramené un cloporte. Il se promène sur ma main. Je crois tout à l’heure l’avoir vu sur la vôtre. Il sent votre parfum, heureusement. Sinon je l’aurais jeté. Laideur incarnée de la nature. Bestiole de l’ombre et de l’humidité, cachée sous les plus belles œuvres de mon jardin.
Lorsque les êtres sont magnifiques, c’est que quelque chose de laid pourrit sous leur corps qu’ils doivent sans cesse maîtriser. C’est cette force déployée qui incite la beauté.
La poésie corrompue a cette fortune conquise que certains convoitent. Savent-ils seulement qu’il nous faut ces cloportes ?
J’avoue avoir du mal à admettre qu’il faille souffrir pour être beau.
Et pourtant, regardez toutes ces fleurs dont les beautés sont uniques, parfaites, colorées comme le bonheur Savez vous qu’elles n’interviennent que pour reproduire le végétal qui souffre ? Si la plante est trop choyée, son arrogance donnera-elle des fleurs ?
Mais pourquoi ces œuvres sont si belles, me direz-vous ? La beauté est une ruse. Attirer les insectes. Vous connaissez la suite. Nul besoin de s’étendre sur la reproduction des espèces. La biologie et ses secrets n’est pas le sujet. Je vous parlais de souffrance, de beauté. J’oubliais la sagesse. Je devrai dire les sagesses. Il y en a deux. La première engendre la blessure et c’est cette blessure qui éveille la seconde. La sagesse est aussi complexe que le fil d’une trame dont le début et la fin se touchent sans le savoir. Le nœud d’ancrage s’attache au cœur de la déchirure serrant la souffrance contre la sagesse jusqu’au point ultime de la rupture.
Je sens avec quelle habileté vos souvenirs glissent sur la nudité de mes douleurs. Mais je m’écarte. Nos deux sagesses dos à dos composent un lien que seul ce que je ferai de vous en jugera. Je sens les prémices de quelque chose de nouveau que vous ne connaîtrez pas. Vous êtes morte. Et si je m’accroche à vous c’est pour mieux vous laisser mourir.
Cette sagesse qui se déploie par une trouée dans le ciel où la lumière brille de n’être pas filtrée. Et vos caresses sur mes plaies, que la lumière punit. J’en saisis les leçons comme à l’école de la vie.
Sans doute est-ce pour mon bien que vous êtes partie.
Sans doute…
C’est cette pensée, qui ce soir baisse mes paupières :
Il vaut mieux que ce soit ainsi.
Les yeux crispés, vous n’êtes plus. Je m’endors toujours ainsi quand je vous oublie.
Au petit matin, trop tôt, vous n’êtes plus là ! Il y a les douleurs couchées contre moi. Elles respirent fort, et m’empêchent de dormir. Je me lève plus vite qu’à l’habitude, et elles me suivent, collées au corps.
Je ne crie plus au secours. Personne ne peut rien pour nous. Tout se décide désormais entre nos mémoires.
Je vous propose un jeu. Plus de petit déjeuner le matin. Plus de bonheur dans la tasse. Juste un conciliabule. Un entretien inédit entre vous et moi.
Je vous demande d’apparaître, et je vous promets la sagesse. Ensuite, chaque jour, je rends grâce pour votre présence. Ainsi, vous ne partirez plus. Donnant-donnant !
Je me concentre. Je ne soupire plus. Je vous attends…
Malheureusement je ne suis pas seule. Les douleurs respirent encore très fort et m’ont suivi jusque dans la cuisine.
Je me concentre de nouveau.
Je change de pièce. Où êtes-vous ?
Comment puis-je vous promette la sagesse, si vous ne me faites pas signe !
Vous ne voulez pas jouer ?
Croyez-vous que je ne comprends pas vos agissements ? Pensez-vous que j’explique davantage les miens ?
Non je ne suis pas si dupe. La crédulité vous appartient plus qu’à moi.
Soyons honnêtes ! Mon désir n’est pas tant de vous retrouver que de vous fuir et de vous ranger…quelque part.
La phrase qui vient de tomber, a fait un bruit d’enfer. L’opposition est là ! Répandue sur le sol comme une tâche. Quelque chose vient de se renverser. Bien pire encore que les salissures de vos fleurs macérées. Il y a là sous mes yeux, l’innommable. La terreur que la sagesse inflige. L’incongruité de l’esprit contre la preuve de l’âme. Il a suffi que je l’évoque pour qu’elle advienne. Mais je ne la comprends pas. Comme toutes ces épreuves qui font doublement souffrir de n’avoir aucun sens.
D’ailleurs les sagesses ont-t-elles un sens ?
L’éminente Sagesse, la « haute » Sagesse est innée, elle vient au monde en même temps que nous. Venant de nulle-part et n’allant nulle-part, établie ni dans l’espace, ni dans la durée. Elle se cache dans une trouée de l’âme ouverte sur l’infini.
L’autre sagesse non moins noble mais plus terre à terre l’enveloppe pour cacher sa lumière.
A l’endroit même où une blessure essoufflée atteint sa souffrance, la grande sagesse était là bien avant, elle l’attendait.
Ce sujet est très complexe, car finalement aucune sagesse ne se ressemble. Il y en a d’innombrables qui nommées ainsi abusent notre conscience et trompent nos vies jusqu’au péché capital.
Quelle ignominie que de se trouver glorieux face à Dieu qui seul voit notre faute !
Ainsi je me vois comme une blessure qui ayant atteint la souffrance, porte son cœur jusqu’à l’ultime sagesse dont vous étiez aveugle.
Sachant cela, comment vous aimer encore…
Un ange incarné vient d’apparaitre, il attendait que je sois seule.
Prise au dépourvu, je n’ai rien préparé.
C’est l’hiver. L’été est passé et je n’ai rien vu. Il fait froid. Dans l’âtre, toutes mes lettres ont brûlé.
Les douleurs ont fini par me serrer le corps comme une habitude. Et face à l’ange inéluctable, je ne cherche plus ce que je fus….
Je ne vous cherche plus.
Dans le jardin, le chêne n’abrite plus mes attentes et les fleurs devenues cupides ont falsifié leur beauté en devoir.
La quête insouciante de la douceur du corps s’est achevée. Je n’écris plus de lettres à mon passé. Je n’en parle plus à voix haute, et les expressions que je murmure s’étouffent comme une honte.
J’entends les mots que l’ange me souffle aux oreilles, des murmures d’un ton badin qui me disent que grandir est plus noble que le bien-être.
Si cet axiome gouverne mes pensées, je ressemble alors davantage aux martyrs immolés se promettant le paradis qu’aux anges venus du ciel, parés de sagesses d’une infinie liberté.
La douleur s’accroche à ma substance cognitive qui se délite à longueur des mots discernés. Tout le discours prononcé est distordu par un langage outrageusement complexe. Depuis que le passé à fui l’ange incarné m’initie à son jargon. Etendue près de la douleur, j’écoute l’histoire singulière que ces maux me racontent et au cours de laquelle, curieusement, c’est le déroulé de ma propre histoire que je crois entendre.
Je sais qu’avec courage je dois porter l’instant jusqu’au suivant. Douleur après douleur. Histoire après histoire. Laisser la tempête tourner chaque page. Et construire peu à peu l’allégorie transparente que le vent m’instruit.
Ainsi, la liberté me manque. Car la douleur est cette énergie enchaînée au corps qui par le courage qu’elle engendre m’engage vers une opiniâtreté déroutante pour la vie.
L’ange, lui, le sait, je le vois dans ses yeux, quand il observe mes rires et débusque un cloporte caché dans mes cheveux.
Quelle est cette sagesse qui sait bien mieux que moi ce que je porte ?
Si chaque jour je tue davantage ce que j’ai cru être, c’est que quelque chose m’y a poussée.
La fourberie de nos volontés est cruelle.
Comme l’affirme Saint Augustin : « Il est assurément faux que sont heureux ceux qui vivent comme ils le veulent. En effet, ce qui est malheureux, ce n’est pas tant de ne pas obtenir ce que l’on veut que de vouloir obtenir ce qu’il ne faut pas ».
Ainsi je fais de ma volonté ce que cette sagesse que je ne connais pas attend de moi.
Et même si je soupçonne mes douleurs de n’avoir aucun sens, je sens malgré tout l’exactitude d’une boussole logée dans mon cœur qui insidieusement me guide sur une voie que moi-même je m’étais tracée.
Vouloir le meilleur n’est pas si simple, tant nos désirs sont murés dans des forteresses que nous croyons avoir construit nous-mêmes et dont nous sommes fiers, alors qu’en sortir ferait preuve d’une éminente et vraie liberté.
Comment vouloir guérir alors qu’au fond de moi peut-être quelque chose me dispute sans cesse ; me blessant jusqu’à la plaie profonde vers laquelle tout mon destin s’est tourné depuis toujours et que je m’obstine à fuir ?
Que me reste-t-il du libre-arbitre ?
Je demande à l’ange si l’acceptation du mal est suffisante ?
Je me laisse portée à y croire. Un instant seulement. Car la douleur du corps me dépouille plus encore que toute la souffrance morale qu’elle engendre.
Et je finis par me méfier de tout. Surtout des anges incarnés qui me soufflent à l’oreille des sagesses trop dogmatiques pour être justes.
Depuis que l’hiver à privé la nature de spectacles réjouissants, je ne vais plus dans le jardin. Je n’y trouve plus trace du passé ; les feuilles mortes ont fertilisé le sol et le tronc béant du grand chêne n’attise plus mes regrets.
Avec ce ressenti de condamnée, le visage trop près de l’instant, mon regard n’a plus de recul. Comme une myopie engagée de l’âme pour arriver à ses fins, je ne vois plus rien qui vaille la peine d’être vu. Et malgré tous mes efforts je ne parviens plus à distinguer les cloportes desséchés dans la pelle à poussière.
Je suis seule. L’ange est parti. Il devait s’ennuyer.
Mon corps habillé de douleur déambule dans la maison où il ne reste plus rien de tangible. Les objets sont devenus amnésiques et les rendez-vous du miroir convoquent trop de rencontres.
Ici les douleurs envahissent l’espace, dont je suis l’unique observatrice secrète. Elles pèsent de tout leur poids sur l’air que je respire, cherchant à m’étouffer sous ce qu’elles s’obstinent sans cesse à me faire endurer pour que je finisse enfin par les entendre.
La cruauté de la chair quand elle s’exprime devient alors nuit profonde et gouffre terrestre que seule l’imagination peut éclairer. Cette fantaisie créatrice que sans cesse nous percevons sans jamais lui donner corps, parce que nous avons peur…
Et déjà ! Dans cette ombre funeste …
J’attrape un papillon…Un plaisir…Une envolée.
Je comprends alors que l’acceptation ne suffit pas, mais elle essouffle jusqu’au crachat laissant des vides où l’air nouveau peut se frayer.
Portée par le souffle qu’agitent les ailes du papillon, j’ouvre grand les fenêtres sur le froid glacial de l’hiver. Jamais encore je n’avais vu de papillon en cette saison. Un vent barbare et flegmatique envahit toute la pièce. Je sens déjà le frémissement chétif que mes douleurs tentent de dissimuler sous ma peau couverte de poudre d’ailes.
On peut entendre, entre les arbres effeuillés, le sifflement strident que chaque rafale arrache au discours morbide du vent.
Obéissant au rythme que la nature impose, c’est par couches successives que la poudre recouvre la surface de ma peau.
Les plus belles scènes de la vie s’obtiennent ainsi. Dessin après dessin, conscience après conscience.
Lorsque prudemment j’étends mon corps fragile sur le lit de la chambre, le vent ne cède pas ses ardeurs, et des nuées de papillons enveloppent la fraîcheur de l’air d’une douceur semblable à celle qui règne dans les cimetières après un enterrement.
Serait-ce une partie de moi que l’on inhume aujourd’hui ?
Une lumière douce et inconnue embaume mon regard, il semble que je peux voir plus loin par la fenêtre. Les yeux fixés sur l’horizon, on dirait que tout à coup quelque chose cherche à exister, comme si de loin, je sentais l’arrivée d’un orage, d’un séisme ou d’un arc-en-ciel que je serais la seule à observer.
J’apprends aujourd’hui que l’espoir n’est pas si pervers. Toute sa vérité tient dans l’angle de nos regards où nous laissons une lueur apparaître. Sans jamais l’attendre, il suffit d’ouvrir son esprit pour le voir.
Par la fenêtre, je laisse partir l’horizon dans le flou de mes yeux. Une alternance étrange s’installe entre ce que je guette et ce que la lumière me renvoie. Sans effort, et au-delà du moindre désir, je reçois tout ce qui vient.
L’espoir est là ! Toujours…avec un soupçon d’accueil.
A cet instant, mon regard bascule dans un vertige aussi cruel que les anges incarnés et les faux semblants. Je n’ai nulle part où m’accrocher.
Le plafond se défait sous le plancher dans une agitation trompeuse.
Une fois encore je crie ma douleur, à la recherche d’un secours évanescent dont je connais désormais la nonchalance.
Vertige étrange et aspirant, qui découvre la teneur sacrés des mots de l’esprit et porte au corps les messages codés du vice.
La géométrie anguleuse et accomplie des murs de la chambre semble vouloir définir une réalité insaisissable que la faiblesse de mon regard ne parvient plus à entourer.
Ce qui existe cède à mon imagination comme pour y faire le vide. Ce n’est pas tant le vide que je convoite, mais son délayage d’espoir qu’un jour je puisse échapper à ce mal qui s’exprime en moi.
Je sais malgré tout, que le plus souvent, l’imagination est un artifice, tout autant que la douleur. Mais ce n’est pas de cette imagination dont j’ai recours, je ne veux pas me bercer d’illusions désavouées et fondées sur le courage, je ne veux pas tenir mes douleurs en gloire et porter mes prouesses sur un trône chargé de cloportes. Les œuvres les plus élevées ne prêchent aucun mérite.
Je sais aussi que l’imagination ressemble à une folie indomptable dont le chaos dissimule un ordre parfait auquel s’accoude notre survie.
Mais grâce à quelques ruses, en faisant mine d’être satisfaite pour affubler le mal d’une apparence plus supportable, la folie n’obtient plus ce qu’elle désire. Elle se montre alors plus docile jusqu’à changer son apparence. Je ne dirai pas qu’elle devient obéissante, mais il m’arrive parfois de sentir sa douceur dans mon être comme la pondération soudaine d’un animal sauvage.
C’est au milieu de toutes ses réflexions, que je décide de quitter la chambre et ses vertiges. Avec une ferveur sans doute orientée par la folie, je me retrouve au pinacle de mon jardin, grisée par l’oxygène, et affublée d’une curieuse et soudaine vitalité. Ce n’est plus le tronc que je cherche, mais cet arc-en-ciel que je sens venir au loin.
Le rêve.
Un papillon jaillissant du trou de ma vie.
C’est avec un regard aussi frais que le vent que je scrute le paysage. C’est avec cette fraicheur que mes yeux glissent sur l’horizon, parcourant le ciel de l’espoir à la lumière. Les papillons m’ont suivie et virevoltent gaiement autour de mes douleurs.
Il reste l’attente, comme un moment d’ultime bravoure face au terme de la souffrance. Il reste ce monticule de terre sous mes pieds face à l’immensité qu’il me tend. Une longue patience s’installe.
Constance et nudité de l’être face à tous les possibles.
Je laisse advenir l’instant comme on cède à la vie qui trace nos destins sur la toile de nos fantaisies.
Rien n’advient par hasard et il n’y a de pensées plus créatrices que celles échappées de nos exubérances.
C’est en domptant cette courbure de l’esprit qu’il ne tient qu’à moi, alors que la souffrance me colle à la peau, de donner à l’existence les couleurs d’un arc-en-ciel.
Alors je m’espère, me convoite, et me séduit.
Le regard tourné vers un autre « moi » sans plaies dans le corps.
Parfois l’attente est longue. C’est parce qu’il manque un passage. La voie doit être libre !
Dans mon jardin il y a trop de mauvaises herbes.
Alors je descends de mon tas de terre, et je m’assois plus bas dans le souvenir d’un chemin. Ici tout est différent, et les papillons ont pris la fuite.
Quand je racle le sol humide, Le ciel s’assombrit déjà. L’arc-en-ciel ne viendra pas ! Je l’attends toute la nuit, je l’espère tout le jour…
Enfant, je n’étais pas étonnée que les désirs deviennent des réalités. J’étais flattée par l’estime du monde sans en mesurer la grâce. Avec le temps ce privilège semble m’avoir abandonnée et je glane sans cesse, ici et là, des certitudes éphémères et sans fondements. Dans ces instants, je crois gouverner la vie, oubliant impunément que si la volonté est une graine, elle ne germe que de l’intérieur.
Je sais à présent, qu’au fond de la réalité se cache toujours un rêve.
C’est là sur le sol humide et froid, les ongles enfoncés dans la terre, pour arracher les mauvaises herbes d’un vieux chemin, que je vous entends pour la première fois, timidement d’abord, puis plus franchement ensuite, comme un souffle dans les fourrés.
Quand je me retourne, vous êtes là !
Glorieuse, attentive. Projetée comme un futur !
Je ne vous connais pas. Vision projetée de mon futur potentiel. Il y a dans vos yeux et sur votre visage l’expression d’une empathie trop gênante. D’ailleurs, je ne me sens plus si faible depuis que je vous regarde.
Je ne sais pas combien de temps je vous observe. Je ne sais pas ce que je fais là sur la terre d’un chemin qui n’en est plus. Mes bras trop lourdement chargés laissent tomber toutes les herbes folles et vous voyez mes ongles noircis. Dans le retrait discret de mon visage, je sens vos yeux pâlir tout ce qu’ils regardent, comme si vos pupilles lançaient des gommes. Je ne peux y réchapper.
Toujours s’estompe le souvenir sur celui qui renaît. Celui qui meurt, ou celui qui renaît, c’est pareil.
Votre présence recouvre tout le chemin, elle prend tous les souvenirs, et cueille une par une les herbes que j’y ai laissées. A peine ai-je eu le temps de me pencher, qu’il ne reste plus rien. Et je regarde vos mains dont pas un ongle n’a bruni. Vous êtes magnifique. Quel bonheur de vous rencontrer !
Sans vous le dire, j’invente déjà votre caractère : enjouée, audacieuse, princesse de la lumière.
Il n’y a pas de plus belles perspectives que celles que racontent vos gestes et vos effacements.
En secret, je vous nomme : « mon étoile », mon devenir…Tant votre lumière rayonne sur la voie qu’à présent vous dégagez dans le désordre des herbes du chemin.
Mais nul besoin de vous définir, puisque vous êtes là ! Dans mon propre jardin. Là où j’ai tant pleuré !
Là aussi où je vous ai tant espérée…
Vous êtes aussi belle que le vent dans les arbres, que le parfum enivrant des fleurs, que le chant éternel des anges délivrés de l’âme.
Et déjà vous aimer devient ma façon d’exister.
Mais comment entrer dans votre lumière alors que ce sont vos yeux qui m’effacent ?
Vous êtes tout, je ne suis rien.
Vous êtes ce qui emplit, ce qui advient et qui vit. Je suis l’espoir, l’amnésie et le vide.
Alors je ne dis rien, et j’attends ; sachant cependant que ce silence et cette attente vous sont proprement méprisants.
C’est l’ombre de ma folie et le dessin de ma faiblesse que j’expose à votre aveuglant éclat.
Je ne sais plus ce que le ciel annonce. Ce pourrait être l’aube ; Ce pourrait être le crépuscule, où simplement l’instant impromptu du jour où le destin se hasarde. Le dénuement de mon esprit vous incombe. Savez vous au moins que je vous observe ?
Si vous saviez le plaisir que je prends à contempler la blancheur de vos pieds sur la toison verte des abords du chemin. Quand vous promenez votre corps léger comme un séraphin dont les ailes n’ont pas fini de pousser, je vacille et me laisse étourdir par le souffle suave et tempéré de votre respiration.
Je suis comme une enfant, vous m’apprenez à marcher…
Le déclin fragile d’une douleur dans la conscience démesurée du monde !
Puis soudain, il se passe quelque chose dans le ciel. Des gouttes de pluie tombent par saccades, rythmées par les rafales successives du vent. Votre longue chevelure se soulève. Vous me touchez. C’est la première fois. La douceur de votre peau est changeante, et ma main dans la vôtre tremble. Alors que nos regards conjointement soumis au parcours du chemin s’attardent sur nos corps, nous nous ressemblons. Mais cela est déjà trop divulguer qui nous sommes :
Moi ce qui fut,
Vous ce qui sera !
Une douleur me colle au visage. Ça ne se voit pas. Vous continuez de marcher, et je vous suis.
Et je suis vous…
Dans l’ombre seulement. A chaque fois que le soleil se cache. En secret.
Sur le chemin qui nous guide, plus une mauvaise herbe ! Seuls nos contours obéissants se projettent comme le reflet d’une seule âme.
J’ai un peu peur, je ne fais rien d’autre que de vous suivre, sans penser, sans souffrir, perdant peu à peu la notion de douleur. C’est étrange cette perception changeante de la blessure, comme votre peau sur la mienne. Une caresse subtile de la douceur de vivre, puis une caresse plus vive sans effrayer la plaie qui meurt. Vous savez y faire.
Un impromptu de Bach avec ses contrepoints, un pas de bourrée avec un soupçon de nonchalance. Quelque chose qui amène une autre. Je suis enveloppée, englobée. Doucement, la conscience de mes gestes se soustrait à la vôtre.
Je me perds volontairement dans ce que nous sommes.
Je vous aime.
Et pourtant je vous distingue à peine, tant votre lumière éblouissante aveugle et efface peu à peu ce qui reste de moi. Je vous imagine plus que je ne vous vois.
Mais votre beauté est si réelle.
Comme une promesse accomplie, je sens mon cœur qui doucement vous ressemble.
Cueillir une rose pour vous l’offrir.
Chanter que le printemps est revenu ; que l’hiver ne fut pas si long ; que lorsque les choses arrivent, l’attente se fond dans le temps comme une coalescence de tout ce qui existe.
Avec la minutie de nos coïncidences, la fleur se place dans votre main, les doigts juste entre les épines. Et nous l’oublions, pour ne retenir que cet instant premier où enfin tout se passe. Alors que nos esprits conjoints inventent l’éternité, une rose entre les yeux.
La fleur grandit dans l’espace, et les pétales devenus cristallins tendent comme un miroir. Nous nous voyons.
Ce n’est jamais sans dessein que l’on cède à son propre reflet, qui saisit l’instant d’un oracle, d’une prophétie, d’un avenir que l’on fait sien.
Pendant que mes yeux dessinent votre contour, je devine dans le cristal des roses, ce que vous serez, ce que je serai demain.
Et je laisse venir l’image de votre éloquente silhouette. Vous allez être plus admirable et plus grande encore. Vous allez prendre soin de mon jardin et de ma maison.
Je sens déjà votre être glisser à la verticale le long du mien. Il s’incarne perceptiblement dans chacune des parties de mon corps, prenant mes douleurs pour des boutons de roses.
La poésie est prêtresse quand elle s’empare de nos substances. Vous serez cette poésie que j’ai toujours cherchée dans les choses. Vous serez ces mots sans fondements qui s’éloignent du langage pour trouver refuge dans le regard exquis des symboles. Vous serez toute cette force que j’ai apprise du temps et qui construit sans cesse le début d’une autre histoire.
J’imagine votre voix, quand vous chanterez demain, dès le lever du jour. Vous aurez pris soin d’envelopper mes boutons de roses dans du papier de soie pour ne pas étouffer trop durement ce qui n’a plus cours. Vous chanterez à tue-tête aussi captivante que les couleurs du papier. Et nous laisserons dans du gel de silice, sécher ces roses qui jadis furent de saison. Je vous regarderai tirer les rideaux et ouvrir grand la fenêtre pour laisser votre voix crier au dehors.
Tout le monde entendra votre poésie que je vous avais empêché de dire.
Je vous demande pardon de ne pas avoir su être vous plus tôt. Pardon d’avoir pris ma douleur pour des bêtes hideuses et mornes. Je sais désormais que mes promenades au jardin n’en ramèneront plus. Votre bras sous le mien vous serez là pour me protéger et éduquer ma peau contre les cloportes, les boutons de roses et tous les mérites que j’ai dû inventer pour vivre.
Je nous imagine, aussi vraie que cela puisse être, regardant le ciel, juchée en haut du grand chêne dont le trou béant est désormais trop plein pour être défini comme un vide.
Vos yeux enserrant les miens, et l’arc-en-ciel surgissant enfin comme un regard multiple, où finalement la magie s’opère en permettant l’alchimie des contraires.
Les plaisirs embrassant les douleurs.
Les tristesses reconnaissant les joies.
Les solitudes appuyées sur les amours.
Comment croyez-vous qu’un arc-en-ciel se conçoit ?
Nos vies ne sont-elles pas ces patrimoines d’instants contradictoires, qui lorsque nos regards les assemblent, placent une lumière aussi gracieuse que n’importe quel arc-en-ciel, dans le réceptacle ouvert de nos cœurs ?
Vous tenez toujours la rose entre les épines. Je vous guide vers la maison où jamais encore vous n’êtes entrée. Vos pas plus décidés que les miens nous conduisent au salon, vous avez posé la fleur sur la table et vos yeux se promènent partout librement. Sur votre visage, un sourire s’empare de tout. Vous vous asseyez sur le fauteuil de mon bureau, vos doigts attrapent la plus belle de mes plumes de calligraphie, celle recouverte d’or dont l’énigmatique acquisition érige depuis toujours mon caractère obstiné. Je vous regarde écrire. A chaque inspiration vous trempez le métal de la plume dans le noir de l’encre. En tenant la pondération de votre souffle, on peut entendre le crissement du papier, obéissant à la virtuosité de votre poignet. Peu à peu les mots se forment et inventent des phrases qui nous transcendent. Nos pronoms se chevauchent lorsque vous-même devenez moi, et que je peux enfin être vous.
La lettre ainsi calligraphiée recouvre plusieurs pages. Nos pensées recensent tous les instants qu’elles racontent, éparpillées à tout va, et dont les causes contradictoires ne rejoignent qu’un seul sens. Dans la connivence de nos regards, plus rien ne demeure, que cet avenir certain, imaginé mais authentique, édifiant avec candeur, la grandeur de mon destin.
Soudain, un glissement le long de mon corps… Vous venez de laisser tomber quelque chose...
Alors que le bruit retentit clairement comme une douleur abandonnée, j’observe avec pitié ce que je vois sur le sol, mais je ne tends pas le bras.
A présent elle s’éloigne dissimulant sa honte dans un nuage de poussière, dont chaque grain s’écarte sur son absence. Il reste une pureté. Un silence.
Quand je relève la tête, à l’angle mort de mon regard, il y a un portrait accroché au mur.
Le mien.
Le vôtre.
Ainsi, dans l’étroit champ de nos visions, nous découvrons parfois dans un angle mort, celui qu’on croyait inventer. Triomphant et empli d’espoir, il nous attendait









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer





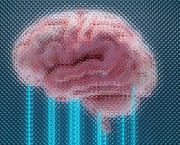

 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur