
Presque rien
 19 min
19 min
On Panodyssey, you can read up to 10 publications per month without being logged in. Enjoy5 articles to discover this month.
To gain unlimited access, log in or create an account by clicking below. It's free!
Log in
Presque rien
Récit écrit au printemps 2022. Connu de 4 personnes seulement.
J'ai voulu le transformer en fiction à cette époque pour le partager. Et puis finalement, non.
Mais j'ai la trouille ...
_____________________________________________________________________________
C’est un souvenir qui n’en est pas vraiment un.
Ce sont des maillons de réflexions, suite à un podcast.
Je suis encore tellement impactée par la fatigue et les douleurs, séquelles du protocole de soins, que ces tout derniers mois, je n’arrive plus à avancer. Tout me semble vain. J’ai du mal à entreprendre quoique ce soit. Comme si mon corps m'empêchait toute action dans le but de me ramener à l’introspection. Peut-être parce après un cancer est-il temps, justement, de ne plus en perdre ? En tout cas, c’est ainsi que j’ai découvert ce podcast, "Ou peut-être une nuit", en n’étant plus capable que de ça : écouter des émissions …
Et c’est en l’écoutant par petits bouts, que peu à peu je prends conscience.
C’est une conscience lourde, une intranquillité, une angoisse sous-jacente au regard de la vulnérabilité des enfants, - possiblement de mes enfants … Une arrière-pensée que je repousse sans cesse, en raisonnant sur le fait que ma maman, face à tout ce qu’elle a entendu et vu en tant qu’éducatrice spécialisée, m’a mis dans le crâne trop d’idées glauques.
C’est une intuition perpétuelle esquivée par des détours : on pourrait dire toute une vie de fuites en avant.
C’est une pensée qui conclut avec calme : « J’ai de la chance, moi. Je n’ai rien vécu de semblable. » Et c’est justement au moment où je me dis cela, que cela remonte.
Je reste debout, figée sur ma terrasse, les yeux écarquillées, pour laisser immerger quelque chose qui avait été lesté dans l’oubli. Parce que j’ai vraiment cette sensation de quelque chose qui refait surface. Verticalement. Comme du fond d’un puits ou de l’océan. Je me dis : « Oui. Oui : il y a eu ça. C’est vrai, c’est bien vrai … »
Comment ai-je pu oublier ?

Je suis dans ma tête, comme devant une boîte qui contient des articles d’un journal vieilli par le temps. Je souffle la poussière, je lis d’une histoire le titre et les grandes lignes qui me sidèrent, me glacent plus je réalise que cette histoire, c’est bien la mienne. Je n’en ai aucun doute.
Oui, mais voilà : elle est à la fois sûre et incomplète. Elle est vraie, mais incroyable.
Lui ? Lui. Lui et moi ?
Je sais que quelque chose est arrivé, mais … Je ne me souviens pas des détails. Alors, c’était peut-être presque rien.
Et puis surtout, - et je ne sais pas si c’est pire -, peut-être ai-je été d’accord ?
Je n’arrive pas à dater. C’est l’époque et la période des étés de liberté, avec ma grand-mère, près de l’étang.
Nous vivons fusionnels. Une entente parfaite : le même âge, les mêmes jeux et quasi jamais de lassitude.
Il est … un des enfants qu’elle n’a pas pu adopter mais qu’elle a élevé. Il est un peu de ce fait mon oncle mais on s’appelle cousin et cousine pour éviter d’expliquer toute son histoire aux autres. Dans les faits, il est comme un meilleur ami, mon meilleur ami, mais de ma propre famille. C’est pratique.
Je ne me pose pas de questions.
Ça se passe une nuit. A quel âge ? 11 ans ? 12 ? Plus tard ? Avant ?
Nous dormons dans la même chambre. Les lits alignés à la queue-leu-leu, contre le mur, dans une pièce rectangulaire.
Ce que je sais : il est dans mon lit.
Ce que je sais : je fais semblant de dormir.
Ce que je sais : je me mets à parler comme une personne qui parle dans son sommeil. Est-ce que je joue ? Nous jouons ?
Je demande si c’est untel qui est à côté de moi. Je ne me souviens pas qui j’évoque. Il dit « oui ». Et, je ressens la joie de le coincer. Je dis « Mais lui, je ne l’aime pas … celui que je préfère, c’est untel ». Je cite quelqu’un d’autre.
A partir de là, je ne sais plus rien. C’est comme des paupières de conscience qui refusent de s’ouvrir. Avec de possibles flashs : de faux flashs ? J’entraperçois ce que ça a pu être mais pas plus… Je me laisse faire. J’obéis. Je suis dépassée. Je découvre une autre peau, entre fascination et écoeurement. Il s’impatiente, je crois. Mais je ne suis vraiment sûre de rien car reviennent surtout les ténèbres : entre l’obscurité de la chambre, mes yeux qui restent obstinément fermés pour continuer à jouer l’endormie et le gommage du reste dans ma mémoire.
Je sais que ma grand-mère finit par apparaître pour nous disputer et couper court à notre veille. Est-il retourné dans son lit à temps ?
Je réalise qu’à un moment, - suite à cette nuit-là ? -, elle décide de me faire coucher dans une chambre à part : dans son grand lit. Et elle, dans un lit d’appoint dans la salle à manger.
 M’a-t-elle demandé de ne rien dire à ma mère ?
M’a-t-elle demandé de ne rien dire à ma mère ?
Je crois bien que oui … Ma grand-mère, que j’adore viscéralement depuis toujours, taisait les lourds secrets. Elle taira longtemps à son propre fils dont l’enfant est schizophrène, la propre schizophrénie de sa mère naturelle.
Oui, elle est capable de m’avoir incité au silence, me faisant comprendre que mes étés de liberté disparaîtraient à jamais si je parlais. Je me souviens d’éclats, où nous nous sommes opposées. Ils étaient rares.Alors, était-ce à cause de cette nuit-là ?
Si elle ne s’est pas emportée en me conseillant de ne rien dire - ma grand-mère donnait peu dans l’échange stoïque -, je l’ai compris toute seule.
Comment ai-je pu taire, terrer si fort cet événement ? M’a-t-il demander lui aussi de ne rien dire ? Ou simplement : a-t-on tous estimé qu’il n’y avait rien de grave à tout ça, puisque nous étions des enfants ?
 Je cherche, je fouille : n’était-ce qu’un jeu ?
Je cherche, je fouille : n’était-ce qu’un jeu ?
Étais-je flattée, interrogative ? … excitée ?
Comment est-il arrivé dans mon lit ? Est-ce que j’ai incité tout ça ? On était si jeunes : trop jeunes, non ? Ça n’était pas vraiment lubrique, n’est-ce pas ? Plutôt innocent et investigateur comme des enfants curieux ? Est-ce que je voulais savoir moi aussi, comment faisaient les grands ? Ce que ça faisait ? Pourquoi je ne me souviens pas ? J’ai eu trop honte ? J’ai préféré oublier ?
J’ai préféré oublier, ça oui.
Alors, je doute … Oui, c’était peut-être juste un « touche-pipi », que je n’ai pas assumé après. Plus je cherche à me souvenir et plus je me dis que ça doit être ça.
Oui mais voilà : un autre souvenir surgit. Et de celui-ci, je me souviens presque de tout.

Quelques temps après, ou peut-être plusieurs mois, « mon cousin » vient chez nous et ma mère comme à l’habitude installe son matelas à côté de mon lit, pour la nuit. Je suis horrifiée. Je ne peux rien dire à mes parents. Je me sens impuissante.
Et avec lui, je ne crois jamais avoir évoqué ce qu’il s’était passé. C’est comme si ça n’avait pas eu lieu. Même si peu à peu, je me rappelle des tensions, de la méfiance entre nous.
Alors, je n’ose pas. Je ne sais pas comment lui dire : « Je ne veux pas. Je ne veux pas que ça recommence. » Mais je le pense très fort. Ça, je m’en souviens très bien.
Je me souviens aussi précisément de la stratégie que je mets en place, débordée de bouffées de panique paranoïaque. Je décide de bouger toute la nuit, pour lui faire entendre que je ne dors pas. Et, véritablement : je ne dors pas.
Est-ce grâce à ma ruse opiniâtre : en effet, il ne se passera rien. Mais, j’ai fait nuit blanche et je me sens folle de manque de sommeil. Folle tout court.
Et si cette nuit de garde n’avait jamais cessé ?
Toujours figée sur ma terrasse, à l’affût comme si la mémoire risquait de filer à l’anglaise, je réalise que cet état de vigilance est un état récurrent chez moi. Un état que j’entretiens pour un oui ou pour un non, la nuit. Je ne m’endors pas tout de suite, habitée par un vague mais tenace « au cas-où ».
Je réalise aussi que pendant des années, j’ai dormi sur le ventre, les mains sous l’oreiller, emmitouflée dans le drap et la couverture. Il fallait que rien ne dépasse du lit. Encore aujourd’hui, même au plus chaud de l’été, je protège d’un drap mes seins et surtout mon bas-ventre.
 À la suite de ces deux souvenirs,
À la suite de ces deux souvenirs,
un dernier remonte de lui-même, inattendu, pour s’associer aux autres. Des années plus tard, une fin d’année scolaire à la fac, un copain de théâtre m’invite à venir en vacances en Corse, dans la propriété de ses parents, avec d’autres membres de la troupe. Au final, nous ne serons que trois garçons et moi, la seule fille.
Première nuit sur la bateau, où déjà nous ne dormons pas beaucoup car nous n’avons retenu que des sièges pour la traversée. Mais, c’est une parenthèse très agréable où les garçons veillent sur mon sommeil quand je tente de me reposer.
Néanmoins, arrivée à la maison de vacances, je commence à n’être plus très à l’aise avec ces jeunes gens que je n’ai en réalité quasi jamais connu, en dehors du cours qu’à des réunions au café. Ils sont extravertis, plein d’humour et complices. Je me demande si je suis à ma place avec eux. Particulièrement, je réalise que je vais être en maillot de bain une grande partie du temps et je ne suis pas à l’aise avec mon corps, même si je n’ai pas de complexes physiques à avoir. Je ne suis pas du tout la jeune femme désinhibée, juste ce qu’il faut, comme toutes celles de mon âge. Comme toutes celles que l’on côtoie au cours de théâtre - vraiment « cool » et que j’admire. En plus, j’ai mes règles et je m’en sens bêtement gênée d’avoir à jeter mes protections devant eux … Je ne veux pas qu’ils le sachent.

La première fois que j’ai eu mes règles, j’ai pleuré d’un franc désarroi et j’ai clairement exprimé à mes parents : « Je ne veux pas grandir. Je ne veux pas devenir « une femme ».
Mon changement physique sera néanmoins dévoilé, peu de temps après, lors de repas créant l’engouement de chaque côté de la famille. Je ne ne cesserai alors d’exploser d’une colère blessée, qui sera reçue à chaque fois avec une hilarité venant minimiser l’indiscrétion commise, ridiculiser, étouffer mes émotions et ma parole. De toute manière, petite, quelle que soit la contrariété ou l’émotion encore plus forte que j’exprime, on me rétorque sempiternellement que je fais ma « mijaurée » ou mon « intéressante ». Et, à vrai dire, après avoir relus plusieurs fois ces lignes et imaginé les réactions et répercussions que cela pourrait avoir sur ma famille si je leurs faisais lire, je ne suis pas loin de m’en sentir à nouveau coupable.
Lors de ce voyage, donc, je crois que mon hôte « a des vues sur moi », comme on dit. Je l’aime aussi beaucoup. Mais, c’est trop pour moi. Je ne suis pas à l’aise avec le fait d’attirer physiquement quelqu’un. Les relations sexuelles, cette inconnue encore pour moi, malgré le fait que j’ai déjà eu des flirts, me donnent parfois des angoisses nocturnes. J’attribue ça au temps qui passe, à la pression sociale et au fait que je me sens anormale de n’avoir pas de vie intime.
 Ces angoisses se matérialisent par un néant … rempli de ténèbres.
Ces angoisses se matérialisent par un néant … rempli de ténèbres.
Vient la première nuit sur place. On m’a attribué une chambre à part. Plutôt prévenant de leur part. Mais tard dans la nuit, je les écoute rire à côté, évoquer mon prénom, avec des blagues un peu lourdes … Alors, je ne maîtrise plus rien et je pars dans des bouffées de paranoïa accompagnées de suées froides qui me déchirent l’âme et le corps. Pour garder le cap, la nuit durant, je ressasse ce que je vais leur dire le lendemain. Il faut que je leur parle. J’ai besoin de leur parler ! Sinon c’est moi qui vais imploser. J’ai trop peur ! Je ne sais pas de quoi mais, j’ai peur ! Peu importe ce qu’ils vont penser de moi. Je vais mettre les choses au clair ! J’attends qu’ils se lèvent et au petit-déjeuner, complètement atomisée de fatigue, je déballe ce que j’ai répété dans ma tête. En face de moi, trois jeunes hommes consternés m’écoutent en silence.
Je leur dis qu’à la maison, ça ne va pas. Et, c’est vrai. Les relations de mes parents entre eux, depuis toujours. Mais aussi de ma mère et moi, depuis longtemps maintenant.
Je leur dis que je ne peux pas envisager une relation avec quelqu’un. Que j’ai eu des impressions vis-à-vis de deux d’entre eux, - rien que ça, madame l’irrésistible !, me suis-je souvent sermonnée après -, que je me sens oppressée. Et… je ne sais plus quoi d’autre. Mais, surtout, je conclue que s’il le faut, je repars.
Mon hôte réagit avec beaucoup de calme et de bienveillance. Il me dit : « Si tu repars, nous aussi. » Ils promettent de faire plus attention à leur comportement. S’excusent d’avoir été si lourds dans leurs propos. Ce sont vraiment des « gentils ». Ils « marcheront sur des oeufs » tout le reste des vacances. Je suis épuisée et j’ai l’impression d’avoir saccagé le séjour : leur séjour… j’ai l’impression tout simplement d’être anormale et franchement ridicule, mais j’ai parlé et je suis soulagée. Je me sens en sécurité. Même si j’ai du chagrin de ne pouvoir être légère. Comme les autres filles. Comme tout le monde.
A la fin du séjour, mes meilleures amies, à qui j’ai écrit ma détresse par cartes postales, me réceptionneront à la sortie du train, pour filer tout droit direction le concert de David Bowie. Elles me diront : « A., tu as peut-être déraillée. Mais, c’est sûr, pour t’inviter, il devait vraiment être intéressée par toi. Ne t’inquiète-pas. Ils s’en remettront. »
Ils s’en remettront, en effet, par l’humour. Quand je revois mes deux comparses de théâtre, ils me racontent pour me faire rire, que le 3e larron, que je ne connaissais pas avant le voyage, se plaignait de ne pas avoir été mis en défaut : « Et moi, alors ? Rien ? Elle ne m’envisage pas du tout ? » J’avais ris. Encore honteuse. Mais, j’avais ris.
Jusqu’à présent, c’est l’épisode de paranoïa le plus aigu que j’ai pu connaître. J’ai déjà eu peur, depuis, de ce que les gens pensent de moi, mais plus de ce qu’ils pourraient me faire.
Enfin je ne crois pas …
Sur ma terrasse, je continue à parcourir les « coupures du journal » de ma mémoire, sans parvenir encore à croire que la première coupure raconte un quelque chose de moyennement joli me concernant …
Je raisonne : « Tu ne sais pas. C’était peut-être pas grand-chose … Tu ne peux pas savoir. Ça ne sert à rien de ruminer. »
Mais, c’est impossible. Je vais ruminer les jours d’après, en spéléologue du souvenir : j’essaie de revoir la chambre, de rappeler les sensations.
Moi, qui suis hyper-sensible au toucher, pour qui chaque geste d’autrui dérange, pèse trop, trop lourd sur la peau, surtout devant, qui refuse d’être bloquée, empêchée de bouger, est-ce depuis cela ?
Je ne suis vraiment pas sûre de ce qui me revient quand j’essaie de me mettre dans la peau de la petite fille aux yeux fermés : une conscience un peu gourde, un corps bloquée par un autre corps qui essaierait de faire … Quoi ? ... De faire quoi ? Bien trop juvénile pour y arriver, non ?
Alors, l’instant d’après, je me dis : « Peut-être pas. Tu n’en sais rien : tu ne te souviens pas. Et, peut-être que je l’ai laissé faire parce que je voulais connaître. Et puis, plus que probablement, ce n’était que des attouchements. Si c’était plus, je m’en souviendrais quand même ! »
Comment être sûre ? La seule chose dont je peux être sûre, c’est que quoique cela ait été : c’était trop pour moi.
Je pense, repense tout cela, parce que je me réfère à l’individu qu’il est et qu’il a été : il n’a jamais été violent ou dominateur avec moi. Enfin, là encore, je ne crois pas… Je voulais tout le temps jouer avec lui, oui. Quand il préférait à moi, mon vrai cousin, un an plus vieux et me délaissait, j’étais tristement furieuse. Etait-ce une forme de dépendance ? Parce que je n’avais que lui pour jouer ? Mais, à réenvisager tout cela avec des yeux adultes, on voit forcement le mal partout…
Pourtant, je me souviens maintenant la pression que m’infligeait justement, mon vrai cousin, sexuellement agressif à l’oral. Je suis sûre qu’il m’a demandé de me montrer nue, de me laisser toucher et que j’ai refusé. Qu’il m’a insultée. De toute manière, il m’insultait régulièrement à sa façon, en m’appelant quotidiennement, entre autre « La fille », avec dégoût et furie.
Je repense à tout cela en rédigeant cet écrit et je me dis que peut-être, poussé par l’injonction de sa condition d’homme en devenir, « mon cousin » - le faux - a voulu tenter l’excursion du seul corps féminin à sa disposition. Peut-être que j’ai donné mon accord cette nuit-là, parce que c’était lui mon préféré ? Et qu’il n’était pas le reste du temps dans la méchanceté pure. Est-ce que j’en avais envie ? Il y a peu de chance. Mais, j’aurais pu croire que je devais le faire. J’entendais souvent ces histoires de découvertes de l’autre sexe. Que « ça » se faisait de se laisser à disposition. Que ce n’était pas grave. Comment savoir quelles en étaient les limites ?
Il était déjà coutume que les garçons, dans la cours du primaire, choisissent une fille et forment un escadron pour foncer dessus et cherchent à la peloter. Moi, je n’aimais déjà pas ça, et une fois, j’en avais tapé un si fort d’ailleurs qu’il s’était roulé à terre, en pleurs. La délégation de garçons était venue me trouver pour me dire que je ne suivais pas les règles du jeu : que je ne devais pas me défendre. Je leur avais répondu : « Mais pour moi, ça n’est pas un jeu. » Si je me rappelle bien, les garçons avaient cessé de jouer à l’escadron.
Je me demande comment lorsqu’on est enfant, on peut avoir le recul nécessaire pour comprendre qu’un acte banalisé, normalisé par le plus grand nombre ne le rend pas pour autant acceptable, encore moins moral ?
Alors, peut-être a-t-il abandonné par la suite toute tentative, lui aussi brutalisé par cette sexualisation impérative pour devenir un vrai mec ?
Est-ce que cela l’excuse pour autant ?
Et moi, est-ce que je peux m’excuser de ce que j’ai peut-être permis ?
Plus tard, je ne me sentirai plus jamais inquiétée par ses actions. Enfin, presque…
Un peu de vigilance, peut-être des fois, à peine, - presque rien, encore une fois - , au coucher le soir, parce que nos chambres sont accolées. Mais plus l’on grandit, plus l’on veille tard, et plus le temps se réduit avec le moment où ma grand-mère vient se coucher, elle-aussi, au même étage. Quand elle monte, sa chambre étant à côté de la mienne, je peux être sereine.
Plus tard, j’ai totalement oublié cet événement. Plus tard, il a toujours été protecteur avec moi. Plus tard, il me fera rencontrer ses groupes d’amis. Je poursuis mes vacances scolaires, en expérimentant la liberté. Grâce à sa présence, j’ai le droit de sortir comme un garçon. Je vis ce que je ne pourrai pas vivre en ville avec mes parents. Je vis mes premières rencontres amoureuses.
Je ne peux pas savoir ce qu’il s’est réellement passé. Alors, j’ai peur d’affabuler, influencée par la parole libérée des femmes, par tous les témoignages qui se font entendre ces dernières années. Mais, je ne peux pas nier que quelque chose est arrivé. Quelque chose qui a déchargé une toxicité dans mon cerveau, mon corps, qui a développé une honte, une inhibition, qui a forcé un secret.
Peut-être qu’un jour, cet écrit remontera jusqu’à lui et viendra-t-il me donner sa version de l’histoire ? S’il s’en souvient.
Peut-être me dira-t-il : « Franchement, ce n’était pas bien méchant. Nous étions des enfants. Et puis, tu n’as pas dit non. »
Qu’est-ce que je pourrais répondre à ça ?
« Est-ce que tu m’as seulement posé la question ? » « Et, est-ce que c’est une question que l’on pose à sa « cousine », même de substitution ? » « Est-ce que c’est moins grave parce que nous ne sommes pas du même sang ? » « Pourquoi ? Pourquoi soudain cette envie ? »
Nous étions si heureux dans nos jeux imaginaires… Et le plus dingue, c’est que nous continuerons encore longtemps à jouer à la poupée, ensemble.
Avait-il fait un pari avec mon vrai cousin ? Ou, l’égo conquérant, s’est-il dit qu’il obtiendrait ce que le plus âgé n’avait pas obtenu ?
Me demanderait-il pardon ? Plus sûrement, me dirait-il que j’ai rêvé.
Oui mais, est-ce que c’est le genre de choses dont rêve une enfant ?

Alors, la seule chose que je veux aujourd’hui, maintenant que ces relents nauséabonds ont refait surface, c’est me permettre de remettre en perspective mon parcours et mes blocages. Ç’est surtout me permettre de me juger moins durement. C’est comprendre un peu mieux le pourquoi de toutes les barrières que j’avais mis en protection et qui m’ont ôtée la possibilité de vivre comme une jeune fille insouciante. Je me méfiais des hommes. On m’avait inculqué de le faire : c’était le discours récurrent à la maison. Partout.
Je me méfias aussi des hommes de ma famille. Peut-être même plus particulièrement.
J’ai grandi dans la banalisation de la sexualité brute et crue - la « baise », comme ils disaient. Il n’y avait jamais aucune tendresse à l’évocation des rapports sexuels. C’était le cul. Le cul faisait tourner le monde ! Le cul faisait rire et envie, les grands. Les adultes, en l’évoquant, ressemblaient à des ogres aigris, en recherche d’orgie. Ils ne comprenaient pas pourquoi, toi, tu ne riais pas. Tu devenais une belle jeune fille, en plus, c’était une chance ! Il fallait t’y préparer, même si tu n’en avais pas envie. Même si tu étais à des millénaires de ça.
D’un côté, le sexe était affiché haut et fort, en mots, de l’autre, - peut-être était-ce pire ? -, il était tapi dans l’ombre, fourbe et tabou.
Je sentais bien qu’un dérapage pouvait vite arriver. J’entendais et comprenais bien les allusions que j’esquivais d’une fausse indifférence, je sentais bien les regards grivois que je faisais semblant de ne pas voir. Que je le veuille ou non ce monde était en train de me rattraper : mais bien sûr qu’il ne me faisait pas envie !
Mais, si je suis honnête par la suite, je ne me souviens pas dans mes amitiés masculines, ni même mes amours avoir subi cette insistance malaisante, voire malsaine.
En écoutant ce podcast, j’ai été frappé par la question du non espace de la parole, du tabou perpétré sciemment dans notre société où domine la culture du viol. Non, ce n’est pas vrai : les enfants ne sont pas en sécurité. Les femmes, non plus. Ce n’est pas une exagération d’hystérique féministe d’affirmer cela. C’est un état de faits, étayé de chiffres.
Est-ce que c’est grâce à tous ces mots écoutés qui incitaient sur la nécessité de parler pour lever l’étendue du problème, pour commencer à l’enrayer, que je me suis sentie inconsciemment en droit de lever le voile sur mon enfance ?
Parce que la culture du viol est entretenue par la culture du silence.
Je tourne autour de cette zone d’ombre depuis si longtemps, sans savoir ce que j’essaie de semer… Je croyais avoir été préservée de cette forme de violence : j’ai tellement été sur-protégée, étouffée et prévenue de l’horreur du monde.
L’homme qui partage ma vie depuis des années maintenant m’assure, lui, l’avoir « senti » depuis le début. Cela reste compliquée pour moi de me dire qu’il y a de ça, dans cet événement que ma mémoire a si bien travaillé à annihiler.
Il existe récits de vie bien pire que le mien. Je ne me sens pas anéantie par cette souvenance. C’est tellement loin.
Ce n’est presque pas moi.
Alors je me dis que s’il est trop tard pour protéger la petite fille que j’ai été, il est encore temps pour tendre la main à la femme que je suis : temps de comprendre que je ne pouvais pas lutter contre ce qui je jouais, dans un cadre familial et sociétal biaisés, ni contre mes propres peurs qui avaient des origines obscures mais réelles.
Et, peut-être est-ce étrange mais pour l’instant, c’est ça le plus important pour moi. Je sais maintenant d’où viennent mes peurs et le gâchis des années de la jeune adulte.
Je ne sais pas si c’est lié mais je me suis souvenue d’une séance avec une sage-femme libérale, pour la préparation à la naissance de mon second enfant. J’avais déjà suivi toute une préparation à l’hôpital, lors de cours collectifs pour la naissance de mon premier.
Cette séance-là, elle me demande de dessiner de profil mon appareil génital. Je me retrouve médusée, face au néant, au noir total. Pour ma première grossesse, j’ai passé des heures en salle d’attente devant des affiches d’ovaires, de trompes, d’utérus, de vagin ! J’ai suivi pour chaque grossesse une préparation basée sur la conscience de son corps, avec une animatrice spécialisée ! Et je suis quasi incapable de dessiner plus que des fesses ! La honte me prend. Je lui reconnais mon désarroi. Et j’impute cela à la naissance par césarienne de mon fils, que j’ai vécu si difficilement… Cette cicatrice - qui sera encore très sensible physiquement pendant plusieurs années - que j’ai à ce moment-là encore du mal à accepter et toucher. Est-ce que mon incapacité à aller regarder en-dedans de mes organes pouvait avoir une autre origine ?
Je ne sais pas s’il y a eu d’autres faits qui sont venus installer ma difficulté à accepter de me laisser toucher.
Un soir, en faisant la vaisselle, je me suis souvenue d’un mariage où un ado, cousin éloigné - le plus grand de la bande d’enfants -, m’avait peloté sans aucune délicatesse, comme les garçons de primaire, et que je n’avais pas aimé ça. Mais, j’étais flattée parce qu’il était le plus âgé - c’était un ado -, et qu’il m’avait choisi parce qu’il me trouvait jolie …

De toutes ces bribes de souvenirs, qu’ils soient traumatiques ou non, le constat est qu’à chaque fois les garçons venaient prendre.
Prendre, pour repartir, satisfaits d’avoir accompli ce qu’on attendait d’eux.
Et qu’en tant que fille, toi, - moi donc - il est rare que tu aies su ou eu les moyens de refuser.
Il m’aura fallu tout ce temps pour vraiment réaliser, comme une évidence désolée, ô combien je suis loin d’être la seule. Je réalise que chaque femme a, de dissimulés à son compteur, somme d’anecdotes et souvenirs plus ou moins aussi nauséeux. Mais bien pire, seront les souvenirs qu’elle aura fait en sorte d’assimiler comme normaux et anodins. Ou tout simplement d’oublier.
Parce qu’aujourd’hui encore, c’est-à-dire en 2022 - dans un pays dit respectueux de l’intégrité et des droits de chaque individu quel que soit leur sexe, chaque petite fille devenue femme mène une vie balisée de ces « presque rien » - que ce soit des gestes ou propos.
Des « presque riens » qui, dans la vie de tous les jours, entachent presque tout.
Aline
Portail https://panodyssey.com/fr/article/poesie-et-chanson/portail-de-bleus-en-mieux-k7mjrdkf6p4p









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribute
Contribute
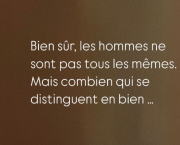












 You can support your favorite writers
You can support your favorite writers






Luce 6 months ago
Si tu as envie, besoin d’échanger en privé, n’hésites pas.
Aline Gendre 6 months ago
❤️