
Partie 2 : La remise en question - Chap. 10 : La migration - Sct. I : Aux origines...
 25 min
25 min
Partie 2 : La remise en question - Chap. 10 : La migration - Sct. I : Aux origines...
Le touriste ne fait que passer, le migrant est là pour rester - au moins quelque temps.
L'humanité migre depuis la nuit des temps. Tout comme elle voyage aussi depuis la nuit des temps. Mais de la même façon qu'elle n'a pas toujours voyagé de la même façon, elle n'a pas non plus toujours migré de la même façon. En tout cas pas dans les mêmes circonstances, pas dans le même contexte, et pas non plus avec les mêmes conséquences.
Un voyage sans retour
Sans doute voyager était-il plus difficile autrefois, et ceci explique sans doute cela.
Mais si les gens ont toujours "voté avec leurs pieds" quand le régime politique, les convictions religieuses du prince ou plus simplement leurs propres conditions de vie ne leur convenaient pas, ou plus, il ne faut pas oublier non plus qu'autrefois, quand les gens migraient, c'était définitif.
Ils n'étaient pas supposés rentrer dans leur pays d'origine à un moment donné.
Même en cas d'exil politique, même quand ils fuyaient la guerre, et même en sachant qu'au gré du temps et des circonstances, un régime politique, ça change, ou tout au moins ça peut changer, et même si une guerre, ça finit toujours par se terminer un jour - même si par ailleurs ça peut aussi parfois mettre beaucoup de temps à le faire.
Déjà, l'information ne circulait pas à l'époque comme elle le fait aujourd'hui. Elle circulait via des crieurs publics qui allaient de ville en ville selon un certain circuit (ce qui prenait du temps) et les nouvelles qu'ils colportaient étaient surtout celles qui concernaient leur région d'activité. Autant dire qu'une fois qu'on était arrivé assez loin, les nouvelles de sa région ou de son pays d'origine mettaient du temps à parvenir aux oreilles - si elles le faisaient jamais.
Mais surtout, voyager était à l'époque beaucoup trop compliqué et beaucoup trop dispendieux pour permettre aux gens de faire des allers-retours à leur guise. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait se le permettre.
Alors aussi bien de la part des migrants que de la part des populations qui se retrouvaient en train de les accueillir, il fallait bien faire avec.
Certes, les sociétés des siècles passés étaient aussi beaucoup plus stables que nos sociétés modernes, du moins sur la durée d'une vie humaine. Après tout, l'histoire de l'Europe compte bien une guerre - entre la France et l'Angleterre - qui a duré cent ans, ce qui a tellement marqué les esprits que la postérité lui en a donné le nom pour l'identifier parmi les autres - et Dieu sait s'il y en a eu beaucoup rien que dans l'histoire de l'Europe, sans même compter celle des autres continents (qui n'est certainement pas moins fournie en matière de conflits entre pays, entre régions ou même entre villes). C'est dire si à l'époque, les choses pouvaient vraiment perdurer très longtemps et s'il était normal que les gens n'y eussent pas pris l'habitude de trop compter sur un éventuel changement. Même la guerre, théoriquement l'état d'instabilité par excellence dans un pays, pouvait se révéler y être un état stable (ce qui n'a pas changé partout dans le monde, d'ailleurs, même à l'heure actuelle, puisque le conflit qui enflamme le plus l'actualité en ce moment a dépassé les trois quarts de siècle d'existence).
Quoi qu'il en soit, toujours est-il qu'en ces temps-là, quand on s'en allait, c'était pour la vie. Qu'il se soit agi de se réfugier dans une autre principauté parce que "cuius regio, eius religio" ou d'aller chercher fortune dans ce qu'on appelait alors le "Nouveau Monde". Ou même, bien plus anciennement encore, de se mettre à la recherche de terres plus fertiles, de pâturages plus abondants, ou bien encore de forêts plus denses et plus giboyeuses qui se prêtaient mieux à la cueillette et à la chasse.
Après tout, c'est bien ainsi, et pas autrement, que l'espèce humaine a fini, au cours du temps, de loin en loin, par peupler la quasi-totalité de la planète Terre.
Bon, ça se comprend : faire des centaines de kilomètres à pied, à dos d'animal ou en véhicule tracté par un animal de trait, cela représentait de très longs voyages qui tenaient tout autant de l'exploration et de la recherche d'un nouveau territoire d'établissement. Il s'agissait d'explorer de nouvelles terres qui étaient encore loin d'être cartographiées, dont personne ne connaissait l'étendue ni les ressources ni non plus les dangers. Ce n'était pas le genre de randonnée qu'on faisait par plaisir, surtout dans les conditions de l'époque avec des routes qui étaient plutôt de simples chemins et puis toute l'insécurité qui allait avec. Pire encore si les régions que l'on devait traverser étaient en guerre. Rien à voir avec les mêmes trajets ne serait-ce qu'en train : il en fallait du temps pour parcourir à peine quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres.
De la même manière, et encore pire peut-être, traverser l'océan ne se faisait pas tous les jours ni tous les ans non plus : c'était un voyage dangereux et hasardeux où beaucoup laissaient la vie dans les naufrages, qui durait des semaines voire des mois, et qui se faisait de toute façon dans des conditions très inconfortables, ce qui veut dire que la plupart du temps, on ne le faisait qu'une seule fois dans sa vie. Même descendre ou remonter les fleuves pouvait s'avérer difficile et dangereux : après tout, certains sont impétueux, ou sujets aux crues, ou encore ponctués de rapides, de cascades ou de chutes, tandis que d'autres sont marécageux et se révèlent traîtres pour les bateliers non avertis ni entraînés. Après tout, même si l'être humain peut s'adapter temporairement à un milieu aquatique et plus durablement à un milieu humide, et même s'il a accès aux deux chaînes alimentaires aquatiques et terrestres, l'homo sapiens reste quand même à la base une espèce terrestre - et même, à vrai dire, essentiellement tropicale. Seul son génie pour se créer des outils et pour reproduire autour de lui des conditions adaptées à sa survie lui ont permis avec le temps - et beaucoup d'ingéniosité - de s'adapter à des habitats souvent inattendus pour lesquels il ne semblait pas vraiment taillé au départ.
Il n'en reste pas moins que de tels efforts étaient, sinon l'œuvre de toute une vie, à tout le moins une entreprise de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Ce qui signifie que quand on s'en allait, surtout aussi loin, c'était pour y rester et ne jamais revenir. Et si on n'était pas prêt à ça, on restait chez soi. D'autant plus que même si l'on arrivait à bon port, rien ne garantissait jamais que tenter l'aventure ailleurs serait couronné de succès - c'était bien pour cela que c'était une aventure. On risquait de tout perdre. C'était un quitte ou double. Un pari.
C'était un aller simple. Un voyage sans retour. Quelle qu'en était l'issue. C'était sans doute pour cela qu'autrefois, on disait que "partir, c'est mourir un peu".
On ne sait pas ce qu'on peut avoir...
Voilà de quoi faire passer sérieusement le goût de l'aventure à la plupart des gens, surtout s'ils étaient amoureux de la sécurité et conscients de leurs responsabilités vis-à-vis d'autrui (de leur famille par exemple) : même si la vie était difficile chez soi, la plupart trouvaient qu'elle restait quand même moins risquée que tout quitter pour partir vers l'inconnu sans avoir la moindre idée de ce que l'on allait trouver au bout du chemin. Comme on dit : "on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on peut avoir". C'était faire le choix de la sécurité, du familier et du déjà connu. On ne partait que quand ce n'était vraiment plus possible de rester.
Ce n'était pas du vrai conservatisme ni du vrai traditionalisme, ce n'était pas l'attachement à un passé, à des traditions, à des racines, à une histoire ou à une identité, et même pas à des habitudes qui étaient devenues avec le temps une seconde nature. C'était plutôt la peur du changement, ou plutôt la peur de l'inconnu. La peur que le changement devienne pire que ce qui existe déjà et qu'on y perde au change. Ou la peur de ce qu'on ne connaît pas parce qu'on ne sait pas quels problèmes il peut poser ni comment les gérer. Ce qu'on a n'est peut-être pas terrible, mais au moins on le connaît, on s'y retrouve et on sait se débrouiller avec. On y est préparé. On gère. On a appris à le gérer. C'est ça la différence.
Et ainsi se développe la conviction que "l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs" - et que savoir se débrouiller avec ce qu'on a, c'est ça la vie, c'est ça la vraie vie et c'est même tout le but de la vie.
Prendre un nouveau départ
Quand on franchissait quand même le pas d'aller refaire sa vie ailleurs que là où on était né et où on avait toujours vécu jusqu'alors, ceux chez qui on arrivait ne savaient pas trop d'où on venait. On transportait de ce fait avec soi toute une part de mystère - d'autant plus si pour une raison ou une autre, il s'agissait d'un passé dont on était peu désireux de parler (ce qui est souvent le cas s'il s'agit d'un contexte que l'on a dû fuir). Il y a en effet fort à parier que si l'on avait franchi un pas aussi difficile à franchir, c'était la plupart du temps par nécessité de survie et que l'on n'était donc pas exactement envahi par la nostalgie. Les histoires du bon vieux temps dans le pays natal n'étaient pas forcément ce qu'on avait le plus envie de raconter le soir à la veillée au coin du feu. Ou alors, si nostalgie il y avait, elle faisait tellement mal qu'on préférait encore, non seulement la garder pour soi, mais même l'oublier et ne plus jamais s'en souvenir. Puisque de toute façon, il était hors de question de retourner dans son pays natal un jour.
Mais quoi qu'il en soit, quand on arrivait "là-bas", c'était pour s'y intégrer et pour y faire souche, en famille ou avec des habitants de l'endroit. Et une immigration réussie, c'était l'assimilation à la population locale - à telle enseigne que les gens en oubliaient que l'on pouvait avoir quelques différences visibles. Ou alors ils estimaient juste qu'elles faisaient partie de sa personnalité et que l'on n'en était que plus unique. Quand ils y faisaient allusion, c'était sur un ton plutôt amical. Quand on avait adopté leurs traditions, leurs us et coutumes, même dans ce qu'ils avaient de plus exigeant, on avait gagné leur respect. On était considéré comme un des leurs. Voilà comment les choses se passaient autrefois, et voilà aussi comment elles étaient censées se passer. C'était quelque chose que personne n'aurait jamais eu l'idée de remettre en question.
En petit comité
Dans un tel contexte, migrer, même à la recherche d'un monde meilleur, se faisait rarement en masse. C'était à chaque fois une initiative individuelle, ou tout au plus familiale. Communautaire à la rigueur. Même la colonisation des Amériques - du "Nouveau Monde" - ne s'est faite que progressivement. Il a fallu attendre, en gros, le dix-neuvième siècle pour que l'on commence vraiment à assister à des déplacements massifs de population, même dans le cadre de la colonisation européenne du monde, toutes puissances confondues - guerres de conquête mises à part bien entendu. Pourquoi ? Parce que c'est à cette époque-là que l'on a pu voir des progrès notables en matière de technologies de déplacement et de transport - des progrès tels qu'ils rendaient même le retour au pays d'origine tout à fait envisageable, ce qui était en soi une véritable révolution qui a sans nul doute désinhibé pas mal de monde et les a encouragés à tenter l'aventure de l'"ailleurs" parce qu'elle devenait tout d'un coup plus facile (après tout, si on échouait, il devenait possible de revenir à son point de départ ou même d'aller tenter sa chance encore ailleurs). Auparavant, il s'agissait d'initiatives existantes, certes, mais sporadiques et dont le volume était peu en rapport avec le désir que les gens pouvaient avoir de quitter un environnement peu favorable.
Il en découle que ces déplacements de population restaient trop faibles pour avoir un impact notable sur leurs contrées de destination. Certains individus pouvaient avoir un impact en raison de leurs connaissances techniques, scientifiques ou intellectuelles, de leur activité littéraire ou artistique ou de leur esprit d'entreprise. Mais la plupart d'entre eux se fondaient dans la foule, et ils étaient trop clairsemés pour avoir un impact du seul fait de leur nombre ou pour se regrouper selon une origine commune. Du moins quand il s'agissait de déplacements spontanés.
Le trafic d'esclaves
Car, oui, il est vrai que tous ces déplacements n'étaient pas forcément spontanés ni dus à des initiatives individuelles, familiales ou même communautaires.
Il existait bien toute une migration forcée avec le trafic d'esclaves, et ce trafic existe depuis la plus haute antiquité - il est censé être aboli officiellement depuis le vingtième siècle mais dans les faits, tout prouve qu'il existe encore et qu'il est même beaucoup plus important que ce qu'on croit, sauf que de nos jours, cela se passe sous le manteau et qu'il n'existe plus de marchés d'esclaves officiels en tant que tels sur les places publiques comme autrefois - mais c'était là la seule façon dont un pays quelconque pouvait recruter de la main-d'œuvre en dehors de son territoire, et c'était une main-d'œuvre privée de liberté, privée de moyens, privée de ressources, très encadrée, étroitement surveillée, le plus souvent maltraitée, exploitée jusqu'à l'abus, corvéable à merci, et dont les liens même familiaux jusqu'aux plus proches étaient régulièrement brisés parce que dans le commerce des esclaves, on n'hésitait pas à séparer ni à disloquer des familles. On vendait le père d'un côté, la mère de l'autre, le fils d'un troisième et la fille d'un quatrième, pas même nécessairement tous en même temps d'ailleurs, et seuls peu de gens - en tout cas parmi les "maîtres" et parmi les trafiquants - avaient l'air de s'en émouvoir.
Mais même si d'aucuns y voient des points communs avec le recrutement de travailleurs étrangers jusque dans leur pays d'origine, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Les esclaves étaient achetés, vendus, échangés, ou alors enlevés, kidnappés - et considérés comme des objets, comme des machines, comme des marchandises. Comme des outils de travail. Il y a dans leur cas une dimension de contrainte, et aussi toute une dimension de dégradation et de déshumanisation, qui n'existent pas dans le cas des travailleurs migrants. Les travailleurs migrants, eux, sont recrutés tout à fait officiellement moyennant un minimum de garanties. Personne ne les prive de leur liberté - en tout cas pas la plupart du temps, même si dans certains pays, des pratiques telles que la confiscation du passeport du travailleur migrant par son employeur confinent effectivement à l'esclavage puisqu'en l'empêchant de la sorte de quitter son pays d'accueil - même pour rentrer dans son pays d'origine - et même de s'y déplacer en dehors d'un lieu de travail où il est logé sur place (et dans quelles conditions), on restreint sa liberté et que tout se passe comme si à l'instar de l'esclave d'autrefois, il n'était plus qu'un outil de travail captif qui appartient à son employeur. Mais ce n'est pas le cas standard du travailleur migrant.
Mais selon le modèle migratoire des siècles passés, le trafic d'esclaves mis à part, les travailleurs migrants n'étaient pas recrutés dans leur pays d'origine depuis leur pays d'accueil. Ensuite, comme ils y arrivaient isolés et pas en masse, ils s'assimilaient naturellement à la population locale. Enfin, leur pays d'origine n'intervenait jamais en tant que tel dans le processus de migration, sauf peut-être pour le freiner en empêchant les candidats migrants de sortir du pays.
Puis vint la révolution...
Mais avec le dix-neuvième siècle et surtout avec le vingtième, avec la révolution industrielle et plus encore avec celle des voies de communication et des moyens de transport et de déplacement, tout change.
La (relative) facilité de voyager que ces moyens induisent mettent désormais l'aventure de l'"ailleurs" à la portée de foules entières qui n'y avaient jamais pensé jusque là et qui ne l'auraient probablement jamais envisagée autrement qu'en rêve sans cela.
Mais cette (relative) facilité de voyager, en rendant le retour aux lieux d'origine tout aussi envisageable, a également changé dans l'esprit de beaucoup de gens le projet de départ de la migration.
Car il ne faut pas s'y tromper : si jusqu'au dix-neuvième siècle, on partait pour toujours et sans espoir de retour, à partir du dix-neuvième et surtout au vingtième, on part désormais avec le projet de revenir un jour. On ne part plus pour s'établir ailleurs pour toujours là où la vie est meilleure, on part ailleurs pour y faire fortune puis pour rentrer chez les siens une fois fortune faite. S'établir durablement et définitivement à l'étranger n'est plus tout à fait le projet de départ. Ce n'est plus du tout le même narratif.
Et ça, ça change tout.
Et pas seulement pour les migrants eux-mêmes.
Car si les "Nouveaux Mondes" ont encore besoin d'immigrants pour les peupler, pour autant qu'ils aient l'esprit d'entreprise et le désir de mettre les mains dans le cambouis et de contribuer à la construction de ces nouveaux pays, d'autres pays d'accueil, eux, qui sont loin d'être des "Nouveaux Mondes" et qui sont d'ores et déjà bien peuplés, n'en ont pas moins besoin de main-d'œuvre pour faire tourner leurs industries qui se développent et prennent de l'expansion... et sont tout contents d'en trouver dans des contrées restées largement rurales, où les perspectives d'emploi sont limitées et où les habitants commencent tout doucement à rêver de s'enrichir.
C'est ainsi que l'on a vu des habitants de régions rurales ou moins industrialisées quitter leurs campagnes pour aller travailler dans les mines et dans les manufactures et les usines, notamment après la fin de la Première Guerre Mondiale - ce qui a provoqué au cours des décennies le déclin des régions rurales.
Crédit image : © Franz Roubaud, "Cossacks crossing a Ford", huile sur toile - Sotheby's









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Colaborar
Colaborar


































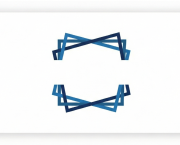

 Puedes apoyar a tus escritores favoritos
Puedes apoyar a tus escritores favoritos





