
"Il"
 33 min
33 min
"Il"
Une légende montagnarde sur le plus terrible des monstres.
Je courais à en perdre haleine, la peur au ventre. Je ne ralentissais pas malgré les ombres de la nuit. La clarté de la lune, pleine, suffisait à guider mon chemin. Mais même sans elle, je n’aurais réduit mon allure pour rien au monde, quitte à me rompre le cou. Comment aurais-je pu, sachant ce qui m’attendait s’Il me rattrapait ?
La terreur me conférait un goût rance d’eau croupie dans la bouche. J’avais l’impression que ses effluves acides me rongeaient de l’intérieur, mais elle décuplait aussi mon énergie. Loin de la combattre, je la laissai m’envahir, profitant de ce surplus d’adrénaline pour courir à la limite de mon équilibre, creuser la distance, et peut-être survivre… Peut-être…
Cette dernière pensée raviva en moi les images du massacre. Je secouai violemment la tête pour les chasser de mon esprit. Ce n’était pas le moment, je devais me concentrer sur ma fuite, utiliser ma peur pour me guider et m’insuffler la force nécessaire, sans pour autant m’abandonner à une vaine panique.
Avec la tombée du jour, la température avait brutalement baissé, comme c’était souvent le cas dans nos montagnes à la sortie de l’hiver. Mon souffle haletant se transformait en une volute de fumée légère qui se dissipait dans mon sillage. Chaque nouvelle foulée forçait une haleine chargée d’angoisse, chaude et fétide, hors de mes poumons. J’espérais en secret qu’Il ne puisse prendre vent de mon odeur, sentir ma peur, et traquer mes empreintes dans la neige. Quel monstre ignoble, je ne pouvais pas me laisser rattraper, je devais fuir de toute la vitesse dont j’étais capable.
Juste quand je ne pensais pas pouvoir aller plus vite, la pente se raidit et m’emporta, j’accélérai de plus belle. Rasant un immense rocher abrupt au plus près, j’aperçus l’orée de la forêt de pins. J’arrivais en zone inconnue. Nous les montagnards n’avions pas pour habitude de descendre si bas. Cette lisière marquait la frontière de notre territoire, une limite qu’aucun d’entre nous n’avait franchie depuis des générations. Mais ce soir, le couvert de cette végétation plus dense représentait sans doute mon seul salut, je n’hésitai pas un instant et je dardai toutes mes forces dans sa direction.
Mais emporté par mon élan et trahi par une fatigue grandissante, je pris une foulée trop courte et perdis l’équilibre. Aussitôt entraîné par la vitesse et la gravité, je me retrouvai à faire la culbute. Un tour sur moi-même, presque sans toucher le sol. Un second tour, accompagné cette fois d’un nuage de neige pulvérisée. Et pour conclure cette chute hasardeuse, un violent choc à la tête. J’eus juste le temps de penser, Cette fois c’est fini, Il va m’avoir, avant que tout ne devienne lointain et que je sombre dans l’inconscience.
C’est le froid qui me reveilla. Au moins, j’étais toujours vivant. Je savais d’instinct que plusieurs heures s’étaient écoulées, une bonne partie de la nuit en fait, à en juger par la pâle ligne rose qui dessinait une timide déchirure sur l’horizon à l’est. Cela expliquait la température glaciale et mes membres transis.
Je me frottai le côté de la tête, là où une douleur sourde irradiait. Pas de sang, et le contact froid de la neige avait dû prévenir l’apparition d’une bosse sérieuse. Je me redressai lentement, engourdi. Autant la peur donne des ailes, autant quand elle se dissipe, elles sont bien vite coupées et vous laissent vidé de la moindre parcelle d’énergie. Chacun de mes muscles me faisait souffrir, j’avais si froid que j’en frissonnais, moi, un montagnard endurci pour qui les hivers n’avaient plus de secrets. Passer une nuit dehors, seul et sans abri, enfreignait trois règles fondamentales de la montagne, je m’en tirais donc à bon compte.
Je ne sais par quel miracle j’étais encore en vie, sans doute avait-Il perdu ma trace, ou abandonné la traque en attendant le lever du jour. Dans ce cas je devais repartir, mettre le plus de distance possible entre ce monstre et moi avant qu’il ne retrouve ma piste. Vaine réflexion, je me sentais toujours trop faible pour tenir debout.
Je restai assis un instant, appuyé contre une souche qui ne devait pas être étrangère à mon mal de tête lancinant. Trop épuisé pour maîtriser mes pensées, je commençai à divaguer, me remémorant les terribles événements des derniers jours.
Le boiteux avait disparu depuis un moment. C’était un paria asocial auquel personne ne prêtait plus attention. Il s’éclipsait parfois, errant en solitaire de par les coteaux à la recherche de sa jeunesse perdue. Mais il gardait le bon sens de toujours refaire surface pour partager le repas familial. C’est précisément son absence à la lippée qui avait inquiété le patriarche. Moi je l’aimais bien le boiteux, il m’avait souvent donné de bons conseils, et il me racontait des anecdotes sur mes parents. Aussi m’étais-je promptement porté volontaire pour partir à sa recherche, au cas où quelque chose lui serait arrivé.
Le patriarche s’y était opposé. Comme d’habitude, une idée ou une suggestion qui venait de ma part ne pouvait s’avérer que sans intérêt à ses yeux. Mon cher oncle avait beau m’avoir recueilli à la mort de mes parents, il ne m’en avait pas moins fait clairement comprendre durant toute ma jeunesse que j’étais le « fils de son frère » et pas le sien. Sa femme tenta bien d’intervenir en ma faveur — elle au moins m’avait toujours inclus dans la cellule familiale —, mais son tyran d’époux la remit bien vite à sa place.
Ce ne fut qu’un peu plus tard lorsque le rouquin — son fils légitime, pour le coup — émit la même idée que moi, que le patriarche décida du bien-fondé de cette proposition. Classique… Bien sûr, ils partirent tous les deux en sauveurs sans moi, et en me faisant bien comprendre à quel point mon aide s’avérait inutile.
Quand ils revinrent à l’aube, seuls et la mine déconfite, personne ne posa de questions. Nous nous doutions tous que le boiteux était mort. La montagne pouvait se montrer impitoyable, elle clamait son dû de temps à autre, je le savais mieux que personne. Leur comportement paraissait cependant étrange. Si le rouquin se trouvait sous le choc — on le serait à moins —, le patriarche, lui, semblait presque effrayé. Je ne fus pas le seul à m’en rendre compte. Sous les questions incessantes de sa femme, il finit par révéler que non seulement le boiteux était bien mort — ils avaient découvert son corps au pied des deux pics —, mais que sa disparition n’avait rien d’accidentel ; ils l’avaient retrouvé dépecé !
À ce mot, les plus anciens rentrèrent la tête dans les épaules. Certains tremblant, d’autres affichant un regard vague tourné vers quelques souvenirs inconnus des plus jeunes. Le patriarche n’en menait pas large et sursautait au moindre bruit. Leurs réactions me paraissaient étranges et disproportionnées, aussi m’étais-je décidé à rompre le silence inconfortable qui s’installait :
— Un ours peut-être ?
— Ce n’est pas un ours, répondit la matriarche.
— Et pourquoi pas ? C’est un peu tôt dans la saison, mais la faim pourrait en avoir sorti un d’hibernation prématurément ?
— Ce n’est pas un ours, répéta-t-elle sur le même ton glacial.
Je savais qu’en réalité, les agressions de ce géant étaient bien moins nombreuses qu’on le laissait croire. À moins de mettre en danger sa progéniture — ce qui pouvait difficilement être le cas à la fin de l’hiver — ou d’aller volontairement l’ennuyer dans son antre, cet animal avait peu d’intérêt à nous attaquer. Je cherchais cependant une raison à l’ignoble sort du boiteux, aussi persévérai-je avec une autre théorie.
— Les loups des plaines alors ?
Quelques têtes se redressèrent à cette mention. Les loups des plaines ont toujours eu une place importante dans le folklore des montagnards. On les dépeint assoiffés de sang, monstres hideux capables de doubler de taille, s’en prenant aux plus jeunes qui s’égarent ou qui ne suivent pas les conseils de leurs parents… Des légendes bien sûr, à n’en pas douter pour inciter les plus téméraires à respecter les règles du clan et ne pas trop s’éloigner. Un outil d’éducation efficace pour protéger les jeunes des dangers de la montagne.
Le patriarche avait repris du poil de la bête, et ce fut lui qui me répondit :
— Et quand as-tu vu les loups des plaines pour la dernière fois ? interrogea-t-il sur un ton narquois.
Je haussai les épaules. Ces loups ne montaient jamais jusqu’ici, je ne les avais d’ailleurs jamais vus moi-même pour être honnête, ou peut-être une fois, une lointaine silhouette furtive entr’aperçue à l’orée de la forêt de pins en contrebas du plateau.
— Il y a bien quelque chose qui l’a dévoré, le boiteux ? lançai-je avec défi. Il ne s’est pas fait attaquer par un chamois tout de même ?
— Dévoré ? Qui te parle de dévoré ?
Je regardai le patriarche avec un air suspicieux.
— Il n’a pas été « dévoré », reprit-il en élevant la voix. Il a été « dé-pe-cé » !
Il avait nettement appuyé ses propos et cette fois les plus âgés montrèrent des signes marqués d’appréhension. Les plus jeunes, comme moi, étaient restés incrédules.
— « Il » est revenu, déclama alors le chef d’un ton solennel. J’ai vu ses traces autour du corps.
Un long murmure d’angoisse monta, concrétisant les craintes des plus anciens. De mon côté, j’essayais de comprendre. Quand le patriarche et son fils étaient rentrés, j’avais spontanément traduit « dépecé » par « dévoré », le boiteux avait sans aucun doute été attaqué par une quelconque bête sauvage affamée. Mais juste « dépecé » ? Cela n’avait aucun sens, pourquoi commettre un acte aussi abominable ? Et surtout, qui avait bien pu faire une chose pareille ?
— « Il », qui ça « Il », interrogeai-je ? C’est ignoble, qui irait arracher sa peau au boiteux ?
— « Il », répéta le patriarche comme une diatribe. « La bête sans nom »… Il est de retour… Point ne bougez, restez terrés, car si vous vous éloignez, vous serez dépecés…
Il avait déclamé comme un illuminé. Au point que pour un instant il m’était venu à l’idée que peut-être lui et son fils s’étaient arrêtés pour manger quelques champignons en chemin — certains possédaient des propriétés pour le moins « stupéfiantes » dans nos montagnes. Je me pris à imaginer que tout ceci n’était qu’un cauchemar. Ils n’avaient pas retrouvé le boiteux, et ils hallucinaient à cause des champignons. Le vieux serait sans doute bientôt de retour sain et sauf, avec une de ses histoires abracadabrantes à nous raconter.
Ce fut la voix de la matriarche, bien plus calme que celle de son compagnon qui me ramena à la terrible réalité :
— « Il » est donc revenu, le monstre est là…
La terreur des anciens envahissait les lieux, je pouvais la sentir sourdre de leurs carcasses tremblantes. Je ne comprenais rien.
— Mais de quoi parlez-vous, lançai-je ? « Le monstre » ? Quel monstre ?
Elle tourna son regard vers moi, plus triste qu’effrayé. Je devinais sa lutte intérieure, une hésitation profonde sur ce qu’elle devait, ou ne devait pas me dévoiler. Elle reprit son souffle, baissa les yeux, et laissa tomber comme un couperet :
— Le monstre qui a tué tes parents…
Tout se figea autour de moi. Je restai un long moment pantois, à ruminer la soudaine révélation. On m’avait toujours dit que mes parents étaient morts emportés par une coulée de neige et je n’avais jusqu’à ce jour jamais eu de raison de remettre cette histoire en cause.
— Tu étais petit, tu ne t’en souviens plus, reprit-elle au bout d’un moment. Nous étions partis pour le lac durant une belle journée d’été. Chacun se prélassait sans souci, lorsque d’un coup Il a surgi de nulle part. Immense, aussi haut qu’un ours adulte dressé sur ses pattes, le pelage d’un vert terne comme les mousses qui couvrent les rochers en automne, ses yeux noirs, démesurés et brillants tels les reflets de l’eau du lac. Son cri avait à peine retenti que ton père était déjà terrassé. Ta mère s’est jetée sur le monstre, mais il était bien trop rapide.
Je restai là, suspendu à ses paroles, à revivre des faits qui avaient quitté ma mémoire depuis longtemps.
— Comme tu étais près de nous en train de jouer avec notre fils, je vous ai attrapé tous les deux et nous avons tous fui. Personne n’a eu le courage de retourner au lac avant le lendemain.
Elle baissa la tête, et le ton, avant de reprendre, hésitante :
— Et quand nous y sommes finalement retournés, nous avons… Tes parents, ils… leur peau… ils avaient été…
— Dépecés ! acheva sèchement son conjoint avec un regard dément.
Les plus jeunes gémirent d’effroi et les plus anciens tressaillirent d’horreur. Moi, je sentis une colère sourde monter du plus profond de mes entrailles. On m’avait donc menti toutes ces années. Et de toute évidence, on continuait de plus belle.
— Combien étiez-vous ? demandai-je d’une voix blanche.
La matriarche me regarda d’un air étonné, comme si ma question n’avait pas de sens.
— Le jour de votre petite balade au bord du lac, combien étiez-vous ? criai-je.
Elle sursauta légèrement devant mon ton, mais répondit.
— Tes parents, nous et quelques autres, mais quelle importance ?
Cinq échines se baissèrent à la mention de « quelques autres », et j’espérai que c’était de remords qu’elles se courbaient.
— Quelle importance ? rétorquai-je. Vous étiez donc sept adultes ? Sept, et personne pour venir en aide à mes parents ? Vous me dégoûtez…
— Tu ne comprends pas. Le monstre, il…
— Le monstre ! Celui que vous avez inventé pour couvrir votre honte ? Celui-là ?
— Mais…
— Assez avec vos mensonges, assez !
J’avais hurlé si fort que tous les yeux dardés sur moi s’étaient écarquillés. Je voyais rouge, et avant que je ne me jette sur elle, je fis volte-face et partis en courant, écœuré.
Ainsi, c’est cela les valeureux montagnards ? pensai-je en poursuivant ma course. Une bande de pouilleux qui laissaient les leurs se faire tuer par un ours enragé, et qui, non contents, allaient ensuite inventer des fables sur des monstres pour justifier leur lâcheté ?
Lorsque je jugeai me trouver suffisamment loin pour ne pas être rattrapé, je réduisis mon allure pour continuer au pas. Poursuivant ma route toujours dos au clan, je donnai libre cours à ma rancœur. En début d’après-midi, je rejoignis le coteau qui menait aux deux pics et l’escaladai, bien décidé sur le moment à ne jamais revenir en arrière. Je n’avais que faire des montagnards désormais. Ce groupe de lâches et de menteurs pouvait bien garder leurs terres, j’irais en chercher d’autres ailleurs, trouver un clan plus brave, en fonder un moi-même s’il le fallait, mais je ne voulais plus entendre parler d’eux.
C’est à ce moment qu’une odeur âcre m’assaillit. Senteur unique qui dès les premiers effluves m’envahit les papilles d’un goût métallique : l’odeur du sang. Au détour d’un petit éboulis en partie couvert de neige, je vis d’abord la tache rouge écarlate sur le fond immaculé du manteau blanc. Puis j’aperçus la dépouille mutilée du boiteux. Sa tête demeurait intacte, la langue légèrement sortie avait tourné bleu, mais son corps… La peau en avait été entièrement arrachée, laissant apparaître la chair à vif, parfois même la musculature et les tendons. J’eus peine à réprimer un haut-le-cœur. Hagard, je restai de longues minutes à regarder le cadavre meurtri, comme hypnotisé, ne sachant plus que penser.
Se pouvait-il que toute cette histoire fût vraie ? J’essayai d’imaginer une autre explication, mais n’en trouvai pas cette fois-ci. Le boiteux avait bel et bien été dépecé, et pas un ours, pas un loup, pas un lynx n’auraient pu faire une telle besogne. J’avais besoin de réponses. Malgré ma récente décision de quitter le clan à tout jamais, je me ravisai et me retrouvai bientôt à parcourir le chemin en sens inverse pour revenir vers les miens.
Bien avant d’arriver, je sus que quelque chose n’allait pas. Le silence pesait trop lourd, l’atmosphère stagnait trop chargée. Je gravis le dernier monticule d’un pas lent, sur le qui-vive, et découvris alors l’horreur : le clan avait été massacré.
Les montagnards gisaient tous là, leurs corps mutilés privés de peau, masses sanguinolentes laissées à découvert sur l’étendue neigeuse. Au milieu des cadavres, me tournant le dos, Il se tenait accroupi au-dessus du rouquin, tout à sa besogne. Il décollait la peau à l’aide d’une longue griffe acérée, tandis qu’il tirait par à-coup pour finir de la séparer des chairs pourpres encore fumantes. Chaque secousse faisait bouger la dépouille du rouquin dans un macabre soubresaut, comme s’il était toujours vivant et parcouru de convulsions.
Un long frisson me traversa devant ce funeste spectacle. Tous les poils de mon corps se hérissèrent et je ne pus réprimer un petit cri d’horreur. Il m’entendit et se retourna vers moi en se relevant. La matriarche avait eu raison, le monstre se dressait, immense, aussi grand si ce n’était plus, qu’un ours, mais celui-ci n’était pas vert terne comme elle l’avait décrit. Son pelage paraissait blanc sale, parsemé de taches gris clair, sans doute une mue saisonnière comme celle des lapins de notre région. Ce camouflage le rendait encore plus dangereux, capable de se fondre avec le paysage été comme hiver. Ses yeux terrifiants, énormes et noirs, dans lesquels je voyais le soleil couchant se refléter sans que jamais ils ne cillent, me captivaient. Il amorça un mouvement vers moi, et le reste se révéla purement instinctif de ma part. Tout d’abord, je sentis un fin jet d’urine me tremper l’intérieur de la cuisse, incapable de maîtriser ma vessie plus longtemps. Ensuite, je détalai en courant, la peur au ventre…
Deux choses me ramenèrent à la réalité en un éclair : le souvenir de cette indicible frayeur, et la silhouette qui venait de surgir au-dessus de moi au bord du plateau : celle du monstre !
Je me remis aussitôt debout, ne pensant plus à mes muscles endoloris, ma tête qui tambourinait, ni même au froid. Je contournai la souche et filai vers la forêt. Ralenti par sa masse, j’avais peut-être une chance de distancer mon assaillant en zigzaguant entre les troncs.
J’entendis son cri déchirant retentir, pareil à la clameur de l’orage, mais ne perdis pas un instant à me retourner. Je me réfugiai sous le couvert des sapins avant que sa plainte sèche n’ait fini de résonner contre les parois de la montagne. Aussitôt, je bifurquai sur la droite, passai de justesse sous un arbre abattu et décidai cette fois de réduire ma course afin de ne pas m’étaler de tout mon long comme la nuit dernière. La peur me reprenait, et avec elle cette légèreté salvatrice s’infiltra dans chacune de mes fibres musculaires.
Un crochet sur la gauche et je sautai d’un seul bond par-dessus un petit cours d’eau gelée. Je ne savais pas où j’allais, mais je prenais garde à ne pas tourner en rond et revenir sur mes pas. M’insinuant entre les troncs, traçant ma piste entre la végétation sèche, je poursuivis ma course. Bientôt les pins se clairsemèrent quelque peu et avant que je n’aie pu réaliser, je me retrouvai à découvert au bord d’une vaste plaine. J’hésitai un instant à retourner sous les arbres, mais c’eût été rebrousser chemin et risquer de tomber nez à nez avec Lui. Aussi, je redoublai mes efforts pour traverser cette étendue de rase campagne au plus vite et rejoindre les bois qui se trouvaient de l’autre côté. Je parvenais à mi-chemin lorsqu’une vision inattendue brisa mon élan ; à l’orée de la forêt, une douzaine de silhouettes venaient d’émerger. La meute des loups des plaines !
Arrêté net, je restai haletant au milieu de l’espace découvert. Devant moi se tenaient les loups des plaines, avec toutes les histoires de mon enfance sur leur cruauté. Derrière moi, le monstre arrivait, avec son cri mortel et sa griffe acérée pour arracher la peau de ses victimes. En face, ils m’observaient sans bouger, attendant de toute évidence que je prenne une décision sur ma direction. Je réfléchis un court instant à mes options. Mais le choix s’imposait de lui-même. Ceux des plaines ne pouvaient pas être pires que le monstre. J’avais été témoin de sa férocité, alors qu’on m’avait juste conté la leur.
Je repartis en avant, droit sur la ligne de loups qui se dessinait devant moi. Au fur et à mesure que je m’approchais, je les vis se déployer en demi-cercle. Un frisson me parcourut l’échine, je reconnaissais la formation classique pour se refermer sur la proie égarée ou rabattue. Si je persistais sans rien faire d’autre, ils sonneraient l’hallali, et ce serait fini pour moi. Je m’arrêtai en pénétrant dans leur périmètre, je savais d’instinct qu’ils me réduiraient en pièces si je continuais à courir. Je m’abaissai en signe de soumission, me pliant à leur code et espérant ainsi les apaiser et leur communiquer mon désarroi. J’esquissai même deux brefs jappements maladroits pour appuyer ma cause.
Ils tendirent tous le cou, mais ce n’était pas sur moi et mes simulacres que leurs regards se portaient. Ils fixaient un point loin derrière moi. Je n’eus pas besoin de me retourner pour vérifier ce qui avait captivé leur attention. Je relevai la tête d’un coup, et sans me soucier d’être compris ou non, je hurlai :
— C’est le monstre, laissez-moi passer, fuyez, il arrive !
Aussitôt, les douze du clan des plaines firent demi-tour et détalèrent, la queue entre les jambes tout comme moi. Je bondis sur mes pattes et m’élançais à leur suite, tandis qu’ils fonçaient dans le bois en aboyant à leur tour :
— Fuyez ! Il arrive ! Le voilà, c’est… l’Homme !









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Colaborar
Colaborar









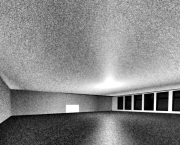
 Puedes apoyar a tus escritores favoritos
Puedes apoyar a tus escritores favoritos





