
Uchronie
 26 min
26 min
Uchronie
Où tout se met en place
Nous sommes à Hollywood, dans les années 70. Un jeune cinéaste travaille sur le scénario d'un film de science-fiction. Derrière une trame générale assez classique de lutte du bien contre le mal, le film est ambitieux. Il aborde la politique, le combat entre la liberté et l'autorité d'un état centralisateur, convoque Œdipe et la psychanalyse, le tout sur fond de combats dans l'espace avec engins interplanétaires. Le projet est ambitieux, mais le scénario n'avance pas. C'est brouillon, confus, plat, il manque un fil conducteur, bref : ça ne fonctionne pas. Le cinéaste en perd l'appétit, le sommeil, sa vie de couple part en vrille. Inquiet de la tournure que prennent les choses, un de ses amis, Steve, lui propose de sortir un soir, juste le temps de se changer les idées, cela ne pourra que lui faire du bien. Le jeune cinéaste ne veut pas, ne peut pas, il a trop de travail. Justement, Steve lui dit qu'il vient de lire un ouvrage qui pourrait l’intéresser. Il le lui prêtera, il y trouvera peut-être des idées. De guerre lasse, le jeune cinéaste accepte. De toutes façons, au point où il en est, ce n'est pas une soirée qui va changer grand-chose. Ils conviennent de se retrouver le vendredi suivant, dans un bar de Santa Monica.
Le jeudi soir, Steve l’appelle au téléphone. Il est bêtement tombé dans l’escalier, il s’est cassé la jambe. Evidemment, il ne pourra pas venir. Le cinéaste, sans oser l’avouer, est soulagé : il vient de gagner une soirée. Pourquoi voulait-il le voir, déjà ? Ah, oui, ce bouquin qu’il voulait lui prêter... Bah, peu importe. Le rendez-vous est annulé et chacun reprend le fil de ses activités, l’un avec son plâtre, l’autre sa machine à écrire. Quant au livre, plus personne n’y pense.
Le jeune cinéaste se remet au travail. Il parvient tant bien que mal à terminer un scénario mal ficelé et à fonder la société qui sera en charge des effets spéciaux – particulièrement spectaculaires, du jamais vu, avait-il promis. C’est une filiale de la société de production qu’il a créée quelques années plus tôt. Il trouve les financements qui manquent et boucle un budget de dix millions de dollars, sans compter la fabrication des nombreux produits dérivés qu’il a prévus, dont les maquettes des vaisseaux spatiaux et l’achat de licences pour la diffusion du film en cassettes VHS. Pour l’époque, c’est colossal. Le tournage peut commencer, les premières scènes sont tournées en Tunisie. Vous l’avez deviné, bien entendu, le cinéaste s’appelle George Lucas et le film s’appellera « Star Wars ».
Il sort dans quelques salles à Los Angeles et dans la région et c’est un bide. Même s’il a déjà deux films à son actif, dont le premier a – déjà – été un échec commercial, Lucas est encore un inconnu. Pour lui, le bouche-à-oreille est primordial, et dans le cas de Star Wars il est catastrophique. Les spectateurs sortent des projections atterrés par la puérilité de l’histoire, le manichéisme des personnages et l’indigence, pour ne pas dire la mièvrerie du scénario – la princesse qui tombe amoureuse du fermier, franchement… Quant aux combats dans l’espace et aux effets spéciaux, même si, c’est vrai, ils sont spectaculaires et mettent en œuvre des techniques encore jamais utilisées, ils tombent à plat, n’arrivent pas à trouver leur place.
Lucas est effondré. Ce deuxième échec est l’échec de trop, sa carrière est fichue, il le sait. Il renonce la mort dans l’âme à ce cinéma qui le faisait rêver et grâce auquel il voulait tant faire rêver les autres. Il revend ses sociétés pour une bouchée de pain et achète une cabane au bord de la plage de Malibu ; il passera le reste de ses jours à vendre et à réparer des planches de surf. Les projets qu’il avait avec d’autres cinéastes, Steven Spielberg notamment, tombent à l’eau, « Star Wars » sera resté moins de trois semaines à l’affiche.
Où tout va de mal en pis
La ruine de George Lucas est aussi celle de la Twentieth Century Fox. Déjà fragilisée par plusieurs films à gros budgets, elle ne s’en relèvera pas. Il ne se vendra que quelques dizaines de milliers de cassettes de « Star Wars », malgré une campagne de publicité qui fera tout pour faire oublier l’échec de la sortie en salles. Quant aux maquettes des vaisseaux spatiaux, elles trouvent leur place dès le début, non pas dans les chambres des petits Américains, mais au palmarès des objets les plus ringards. La chute de la Fox envoie du jour au lendemain des centaines de scénaristes, machinistes, techniciens et acteurs au chômage. Dans le monde du cinéma, c’est une déflagration. Dans celui du divertissement, cela ne vaut guère mieux.
La science-fiction est désormais un genre qui a mauvaise presse. Si on voulait forcer le trait, on parlerait presque de malédiction. Tous les projets de films sont abandonnés. A vrai dire, ils sont souvent dystopiques et n’intéressent plus une jeunesse américaine qui vient de sortir de la guerre du Vietnam et n’a envie que de s’amuser, consommer, conduire vite et faire l’amour. La mode est aux fims de gangsters, dans la lignée du Parrain, de Coppola, aux westerns et aux films d’aventure. Les budgets sont certes plus petits, mais les héros ont les pieds sur terre, et non dans l’espace. La culture des armes, si prégnante aux Etats-Unis, n’y est pas pour rien : on peut prendre le sujet par tous les bouts, les Américains restent bec et ongle fidèles au colt et à la winchester, ce ne sont pas des sabres-lasers ou autres gadgets ridicules qui vont les en détourner.
En 1968, avec « 2001, A Space Odyssey », Kubrick avait bénéficié de l’engouement du public pour la conquête spatiale et le programme Apollo. Cinq ans après Apollo 17, cet intérêt s’est émoussé, notamment à cause du coût pharaonique de chaque mission spatiale. Lucas poursuivait sans doute avec son film un double objectif : offrir à moindre coût un dérivatif au programme de la NASA, et réconcilier les Américains avec l’espace et la technologie. L’échec du film ruine ces deux ambitions. L’espace n’a plus la côte, il revient cher et ne sert à rien. L’Amérique a prouvé sa supériorité technologique sur l’Union Soviétique – et de quelle manière ! – il n’y a aucun intérêt à continuer la compétition. Certaines sociétés prévoyaient d’envoyer en orbite des satellites qui serviraient de relais pour les communications : cela serait moins coûteux que de tirer des milliers de kilomètres de lignes téléphoniques. Cela pourrait même être amorti par la transmission d’émissions de télévision, des films à forte audience ou même des rencontres sportives. Malheureusement, depuis l’échec de « Star Wars », le monde du divertissement, de l’entertainment, comme on dit là-bas, est frileux, pour le moins. Les projets de satellites civils sont remisés dans les cartons. Dans cette deuxième moitié des années 70, l’Amérique acte sa supériorité technologique, culturelle et sportive et se replie sur elle-même, dans ses frontières et au ras du sol.
La période est pourtant marquée par la course aux armements nucléaires à laquelle se livrent les deux superpuissances. Etats-Unis et Union Soviétique y consacrent des budgets colossaux. Des deux côtés, les militaires ont des projets de missiles intercontinentaux et de satellites armés ; leur théorie est que celui qui dominera l’espace sera aussi capable d’imposer sa force partout ailleurs. Aux Etats-Unis, ces projets sont portés par Harold Brown, le Secrétaire à la Défense de Jimmy Carter, mais les Républicains sont vent debout. En dépit de signaux alarmants qui montrent clairement que l’Union Soviétique s’engage dans la même voie, ils font barrage au projet, arguant de son coût phénoménal – ce qui est recevable – et de l’échec de Star Wars – ce qui l’est moins. Ronald Reagan, un Républicain qui avait brigué l’investiture du Parti à l’élection de 1976, est particulièrement véhément et va même jusqu’à déclarer : « Nous n’avons pas besoin d’une Guerre des étoiles qui, après avoir ruiné nos studios de cinéma, ruinera le peuple Américain » (San Francisco Chronicle, 18 mars 1979). Il faut dire qu’en tant qu’ancien acteur et gouverneur de Californie, il a été doublement affecté par le séisme qui a touché l’industrie du cinéma. Sous la pression, l’administration Carter s’incline. Les missiles intercontinentaux et le projet de bouclier spatial sont abandonnés. Seule la conception des missiles Pershing-II est maintenue ; leur déploiement est prévu pour 1982 ou 1983.
Les Soviétiques, de leur côté, continuent en secret leur effort de guerre et, tout en poursuivant le déploiement massif de leurs missiles balistiques SS-20, développent leurs propres engins intercontinentaux, que le monde découvrira bientôt sous l’appellation de SS-30. Les Américains ne veulent pas du ciel ? les Soviétiques y déploient en douce une galaxie de satellites militaires de communication. En cas de conflit, cette flotte permettra de faire transiter de grosses quantités d’informations, d’un point de la planète à un autre, quasiment à la vitesse de la lumière. Si les Etats-Unis avaient pu lancer les satellites espions qu’ils avaient prévus, ils auraient pu détecter l’opération, peut-être même y réagir. Malheureusement, privés de la technologie adéquate, ils ne sont au courant de rien, et ne soupçonnent rien. Fin 1979, le ciel – ce ciel que Kennedy avait défini comme « la dernière frontière » et qui ne fait plus rêver grand monde – leur tombe littéralement sur la tête lorsque les Soviétiques passent à l’attaque. Dotés d’un armement qui leur permet de tenir en respect aussi bien les pays européens que les Etats-Unis, et avant que ceux-ci ne terminent la mise au point des fusées Pershing-II, ils envoient leurs chars déferler sur la Finlande, la République Fédérale d’Allemagne et l’Autriche, et une pluie de SS-30 sur les Etats-Unis, tout en prenant soin d’éviter les grandes métropoles. L’attaque est massive, mais elle n’est pas définitive. Le message est clair : nous ne l’avons pas fait, mais nous pouvons le faire, nous pouvons vous anéantir ; toute défense est inutile, une riposte nucléaire serait suicidaire. En Europe, l’Union Soviétique reste fidèle à son intangible ligne de conduite : n’envahir un pays que s’il est limitrophe d’un pays déjà sous contrôle. Le mur de Berlin est démantelé, les deux Allemagnes réunifiées dans une grande République Démocratique d’Allemagne. En comparaison, le front ouvert en Afghanistan, mais pour de toutes autres raisons – il ne s’agit pas d’ajouter de nouveaux territoires à leur influence, mais d’empêcher un pays d’en sortir – semble anecdotique.
Les Etats-Unis, bien que liés aux pays d’Europe par le traité de l’Atlantique Nord, sont dans l’incapacité de réagir et de prendre la défense des pays agressés. Le timing suivi par les Soviétiques est en tout point parfait : une situation économique difficile d’une part – l’Occident subit de plein fouet le contrecoup du second choc pétrolier, initié par un changement de régime en Iran –, une situation militaire défavorable et des équipements essentiellement stationnés en Allemagne de l’Ouest, donc désormais sous contrôle soviétique d’autre part. Sous la pression d’opinions publiques ouvertement anti-américaines depuis la guerre du Vietnam, la France et l’Angleterre ont toujours traîné des pieds pour installer sur leur sol des missiles américains.
Où la résistance s'organise
Les Etats-Unis ne ripostent pas, mais ils prennent la tête du combat. La propagande se déchaîne, les budgets militaires repartent à la hausse, le mot d’ordre est à la fermeté. Sur ce point, le président Jimmy Carter est exemplaire. Lui que ses ennemis politiques accusaient de lâcheté se révèle un leader inflexible et sans pitié. Sa fermeté et sa rigueur se manifestent en premier lieu à Téhéran, où il envoie la CIA libérer les otages de l’ambassade américaine – dédaignant ce qu’elle appelle un « non-événement », l’Union Soviétique ne se donne même pas la peine de réagir – puis en politique intérieure. Le Parti républicain est vilipendé, tous ceux qui s’étaient opposés à l’effort de guerre, Ronald Reagan en tête, voués aux gémonies. Aux élections de 1980, c’est une marée bleue qui déferle sur le pays : le Parti démocrate arrive en tête dans quarante-cinq des cinquante-et-un états de l’Union, remportant 489 Grands Electeurs sur 538 – contre 49 au Parti républicain. Jimmy Carter est réélu haut-la-main, Reagan jeté aux oubliettes de l’Histoire. Honni par les Démocrates et par une immense majorité de la population, il est à deux doigts d’être déféré devant la Cour Suprême pour activités anti-américaines.
En Europe, les partis de gauche, socialistes et sociaux-démocrates en tête, payent très cher leur anti-américanisme et leur mansuétude envers les mouvements pacifistes. Accusé d’intelligence avec l’ennemi, le Parti Communiste est interdit en France, en Espagne et en Italie. Les partis de droite arrivent en tête à toutes les élections : Valéry Giscard d’Estaing est très largement réélu en 1981 – 68,2 % contre 31,8 % au second tour contre François Mitterrand –, Margaret Thatcher déploie au Royaume-Uni une politique économique et sociale extrêmement violente pour la classe ouvrière.
La résistance s’organise. Privés d’une opposition de gauche réduite à peau de chagrin, les partis au pouvoir en Europe imposent une augmentation prodigieuse des budgets militaires, développent avec les Etats-Unis des programmes de collaboration et de renseignement, misent sur le développement de supercalculateurs, relancent les projets de conquête spatiale qui avaient été enterrés. Une navette spatiale, baptisée Lafayette en hommage au héros français de la guerre d’Indépendance, est lancée à Cap Canaveral en 1991, soit à peu près dix ans après la date initialement prévue. Dans le discours qu’il prononce au pied du Capitole, devant plus de deux millions de personnes, le pasteur Jesse Jackson, élu puis réélu à la suite de Jimmy Carter, déclare : « La plupart de mes prédécesseurs ont eu l’habitude de dire avec emphase : "L’Amérique est de retour !" Aujourd'hui, je vous le dis solennellement : non seulement nous sommes de retour, mais nous ne partirons jamais ! » Ce « We’ll never leave » devient pour tous les Américains la deuxième devise des Etats-Unis après « In God we trust ». Il figure sur les bâtiments officiels, est gravé au fronton du Capitole, du Lincoln Memorial et de l’obélisque érigé à la mémoire de George Washington ; il est imprimé sur les billets de banque, marqué sur chaque munition fabriquée par les usines du pays, brodé sur les casquettes de base-ball.
Nul doute que l’Union Soviétique aurait aimé profiter plus longtemps de sa situation dominante, mais minée par la corruption et une administration inefficace, victime de guerres d’indépendance menées à ses marges par d’anciennes républiques musulmanes, incapable de gérer un empire aussi vaste, entraînée par les Etats-Unis dans une surenchère militaire qui la rend exsangue, elle s’effondre sur elle-même, laissant la place à une multitude de petits états que se disputent des apparatchiks sans foi ni loi. A la chute de l’URSS, le monde stupéfait découvre l’existence des « étoiles noires », plusieurs gros satellites géostationnaires dont certains étaient positionnés à l’aplomb des Etats-Unis. Leur but était bien sûr de relayer les informations des armées soviétiques mais aussi de brouiller les communications américaines et européennes. En cas de conflit, les armées occidentales, privées de moyens de communication, auraient dû être littéralement paralysées. A ce jour, on ignore pourquoi ces satellites n’ont jamais fonctionné. L’hypothèse la plus plausible est qu’ils étaient tout simplement dysfonctionnels et qu’aucune technologie n’avait été prévue pour en déboguer l’informatique embarquée.
Où le lecteur est un peu perdu
Au début des années 2000, George Lucas est toujours un peu amer, mais il est riche. S’il est le premier à reconnaître qu’il n’est pas un bon scénariste – il a encore du mal à digérer l’échec de Star Wars – il a en revanche un indéniable sens des affaires. Il a vu venir la mouvance écolo et l’essor des sports qui rapprochent l’homme de la nature. Il a su se diversifier. La petite boutique de Malibu est désormais un maillon parmi beaucoup d’autres dans une grande chaîne de magasins qui proposent des équipements, des vêtements et des livres autour du surf, bien sûr – le logo de GL Sports (George Lucas Sports Ltd) est inspiré d’une planche de surf – mais aussi de l’escalade, de la randonnée, du trekking et du VTT. La marque vend même des chaussures de running, allant jusqu’à concurrencer Nike sur ce secteur très stratégique.
Lucas et Spielberg sont restés amis. Ils se voient toujours, même si tous les deux ont abandonné le cinéma. Spielberg se partage entre deux passions, l’archéologie et la paléontologie, un domaine qu’il adorait au lycée et pour lequel il a eu un véritable retour de flamme. C’est un spécialiste reconnu des grands prédateurs du Crétacé, notamment le tyrannosaure – le T-Rex – et le vélociraptor. Il parcourt le monde pour donner des conférences qui connaissent un grand succès, grâce en particulier aux représentations des dinosaures en images de synthèse, extrêmement réalistes, qu’il propose au public. Conférences qu’il a l’habitude de conclure en regrettant que la technologie ne soit pas plus avancée, et que les coûts de calcul soient si élevés, car il aimerait faire un film avec des dinosaures. On lui demande : « Un film qui se passerait à l’époque des dinosaures ?
- Non, je pense plutôt à un film qui se passerait bien à notre époque, mais avec des dinosaures…
- Comment est-ce possible ? Comment voulez-vous que des dinosaures aient pu survivre jusqu’à notre époque ?
- Je ne sais pas encore. Mais on peut par exemple imaginer une équipe de scientifiques découvrant dans les glaces de Sibérie un corps de dinosaure parfaitement conservé. Et trouvant le moyen de le ramener à la vie. Ou de le cloner. On a réussi il y a quinze ans à cloner une brebis. Pourquoi ne parviendrait-on pas à cloner un dinosaure ? »
A chaque fois, le public est enthousiaste, le conforte dans son idée qu’il y a peut-être là une idée à exploiter. Les projets de cinéma n’ont pas totalement quitté l’esprit de Steven Spielberg.
Où tout s'explique
Un matin de juin, Lucas reçoit un coup de téléphone : son ami Steve – celui qui s’était cassé la jambe dans l’escalier, vous vous souvenez ? – vient de mourir, sa compagne a trouvé dans ses affaires un livre avec un post-it sur lequel il avait écrit : « pour G. Lucas ». Elle le lui envoie par la poste, il le reçoit deux jours plus tard. Cela fait plus de vingt ans, mais il fait quand même la connexion avec ce bouquin que Steve lui aurait prêté s’il n’avait pas fait cette mauvaise chute. Le livre s’appelle « The Hero with a Thousand Faces », par un certain Joseph Campbell, un universitaire spécialiste des mythes. Lucas n’en a jamais entendu parler. Il le feuillette machinalement. Campbell y développe la théorie selon laquelle tous les grands récits, de « L’Odyssée » au « Seigneur des Anneaux », obéissent à un schéma narratif identique, qu’il appelle le voyage du héros. De manière très simple, le héros est au début un personnage quelconque, plutôt insignifiant, qui vivote dans un univers qui n’est pas le sien et où il s’ennuie ferme. Puis il reçoit l’appel de l’aventure, un message ou un événement qui l’arrache à son monde terne et ordinaire pour le projeter dans une mission où, après une litanie de péripéties – parfois un peu ennuyeuses – il finira par triompher du Mal. Il est aidé dans sa quête par un mentor, généralement un vieillard qui finit par se sacrifier et par quelques autres aventuriers qui seront ses compagnons de route et grâce à qui il deviendra un homme accompli – oui, à cette époque, le héros est en général un homme – maîtrisant les règles du combat. Bien que vainqueur, il ne sort pas indemne de son aventure : profondément changé, il rentre au pays et jette aux orties tout ce qui faisait sa vie d’avant pour devenir une espèce de vieux sage que quelques pèlerins viennent parfois consulter.
Lucas est sidéré. Il comprend ce que Steve avait voulu lui faire passer. S’il avait lu ce livre au moment où il en était encore à travailler sur son scénario, il y aurait trouvé la trame et le fil conducteur qui lui manquaient. C’est une évidence : avec sa dimension mythologique et universelle, cette trame était le support idéal pour agréger tous les concepts et les idées qu’il avait voulu aborder. Privé de cette colonne vertébrale, son film ne pouvait être qu’une succession pesante de poncifs et de lieux communs.
Il s’en ouvre à Spielberg, qui tombe des nues. « Si je connais "The Hero with a Thousand Faces" ?, bien sûr, voyons ! C’est même moi qui avais suggéré à Steve de te le faire passer. Je suis étonné qu’il ne l’ait pas fait… »









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Colaborar
Colaborar






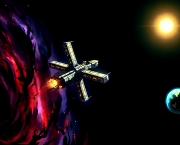


 Puedes apoyar a tus escritores favoritos
Puedes apoyar a tus escritores favoritos






Jackie H hace 2 meses
Passionnante plongée dans un univers alternatif qui aurait très bien pu exister...
Le destin tient à si peu de chose parfois. Un choix, parfois un micro-choix. Un événement fortuit. Peu de chose peut suffire à changer radicalement l'histoire du monde et le cours des choses.
Très bien construit en tout cas. J'ai apprécié les références à toute cette époque que j'ai vécue.
J'ai beaucoup aimé.
Vincent Martin hace 2 meses
Merci Jackie pour votre commentaire.
L'uchronie n'est pas un exercice facile, mais je me suis beaucoup amusé à réécrire une histoire du monde qui aurait pu basculer à la suite d'un événement mineur et à des années-lumière de la géopolitique.
Merci encore pour feedback et votre gentillesse.
Harold Cath hace 2 meses
Amusant de découvrir votre écrit, sachant que j'ai utilisé en partie le Fabula Deck (basé sur le voyage du héro) pour l'ossature de mon 1er roman. Écrire ce n'est pas que de l'imagination, il subsiste une part de techniques à acquérir. Merci pour votre texte.
Vincent Martin hace 2 meses
Merci Harold pour votre commentaire.
Cette histoire de voyage du héros me fascine depuis que je l'ai découverte, par hasard, sur un podcast. J'ai trouvé amusant de la placer dans une nouvelle.
Merci pour votre feedback.