
Fusion
 27 min
27 min
Fusion
 Alain Péters est un musicien réunionnais. Enfin était : 1952-1995. Auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, touche-à-tout, démesuré, un peu mystique, il laissera derrière lui une œuvre fondatrice dans l'histoire de la musique réunionnaise. Fait d'autant plus remarquable qu'il n'a enregistré de son vivant que vingt-deux morceaux, et encore dans des conditions bien particulières, presque malgré lui, loin des studios, avec un petit magnétophone quatre pistes, jouant tour à tour de tous les instruments tel un homme-orchestre, encouragé et aidé simplement de quelques uns de ses amis, Jean-Marie Pirot en particulier. Mineure en termes de volume, confidentielle dans sa production et sa diffusion, son œuvre aura pourtant un impact considérable et trouvera un écho inattendu chez les autres musiciens de l'île qui la garderont vivante et la feront perdurer jusqu'à nous.
Alain Péters est un musicien réunionnais. Enfin était : 1952-1995. Auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, touche-à-tout, démesuré, un peu mystique, il laissera derrière lui une œuvre fondatrice dans l'histoire de la musique réunionnaise. Fait d'autant plus remarquable qu'il n'a enregistré de son vivant que vingt-deux morceaux, et encore dans des conditions bien particulières, presque malgré lui, loin des studios, avec un petit magnétophone quatre pistes, jouant tour à tour de tous les instruments tel un homme-orchestre, encouragé et aidé simplement de quelques uns de ses amis, Jean-Marie Pirot en particulier. Mineure en termes de volume, confidentielle dans sa production et sa diffusion, son œuvre aura pourtant un impact considérable et trouvera un écho inattendu chez les autres musiciens de l'île qui la garderont vivante et la feront perdurer jusqu'à nous.
Contrairement à ce qui a pu se passer avec d'autres styles de musiques estampillées « world », la Réunion n'a pas bénéficié d'une distribution massive qui aurait permis à sa musique d'être portée jusqu'à nos oreilles. Les Antilles ont su, sous l'impulsion initiée par Kassav', imposer le zouk hors de leurs frontières. Des groupes ou des artistes tels que Frankie Vincent, la Compagnie Créole ou Zouk Machine ont suivi les sillons tout tracés par leurs prédécesseurs, et leurs noms aujourd'hui ne sonnent pas inconnus à nos oreilles. La Jamaïque a exporté son reggae bien plus loin et bien plus durablement que tous les autres pays. Pour en arriver là, le producteur Chris Blackwell a dû modifier le son roots de Bob Marley pour l'adapter au public européen, faisant éclater le groupe des Wailers au passage, mais ceci est une autre histoire. Parfois, ce sont aussi des musiciens européens qui sont allés ailleurs à la recherche de sonorités plus exotiques, ou plus authentiques, tels les Beatles en Inde, à la rencontre de Ravi Shankar.
Au cours de son histoire musicale, la Réunion n'a pas connu d'artistes affichant une telle volonté de conquérir le marché métropolitain. Et les quelques tentatives d'aller chercher en ces lieux des sons différents n'ont pas été aussi déterminantes que celle des Beatles, alors en pleine gloire, et ce n'est pas peu dire, avec leur escapade indienne. Il faut chercher du côté de Maxime Le Forestier qui, à la fin des années 80, reprend Ambalaba (encore qu'on ait affaire ici à un séga d'origine mauricienne) ou de Bernard Lavilliers proposant sur son album Baron Samedi (2013) une version de Rest' la maloya, une chanson signée Alain Péters, pour entendre parler de cette musique. À ces quelques rares exceptions près, les Mascareignes ne se sont pas imposées.
Cela dit il ne faut désespérer de rien. Le regain de vitalité du vinyle aidant, on voit de petits labels très spécialisés se lancer dans la réédition, sous forme de compilations de 45 tours le plus souvent, de ségas et de maloyas quasiment oubliés. Le séga est le genre musical historique des Mascareignes, il trouve ses origines dans l'histoire de l'esclavage et la mixité qui en a découlé, schéma que l'on retrouve dans toutes les musiques créoles et qui est le résultat de la rencontre de l'Europe et de l'Afrique en un ailleurs fait d'espoir, de fuite ou d'appât du gain pour les uns et de déportation, d'aliénation et de perte de racines pour les autres. Les instruments traditionnels sont des percussions : le tambour roulèr, le triangle et le kayamb, une sorte de caisse faite de tiges de roseau et remplie de graines que l'on secoue dans un mouvement horizontal. Le chant est une sorte d'incantation. Le maloya, quant à lui, est vraiment spécifique à la Réunion. Le mot lui-même est assez récent puisqu'il n'apparaît qu'au début du vingtième siècle, même s'il recouvre une réalité bien plus ancienne. Les deux genres se ressemblent, et les musiciens eux-mêmes ont tendance à utiliser un terme ou l'autre assez indifféremment, la différenciation étant surtout lubie de spécialiste. Pour aller vite, on pourrait rapprocher le maloya du séga traditionnel. Ce sont deux musiques incantatoires, plus profondes car venant d'un passé lointain, qui auraient vocation à la transmission du savoir et des règles, à la prière, tandis que le séga moderne serait plus léger, plus folklorique. Et pour aller encore plus vite, on parlera de séga à Maurice et de maloya à la Réunion.
Le label Strut a donc édité deux compilations : Soul Sok Séga, consacré à la musique de l'île Maurice, et Oté Maloya consacré à la musique réunionnaise. Le label suisse Bongo Joe a lui deux disques à son actif, une compilation de maloya co-éditée avec le label Folkwelt, Soul Séga Sa, et une compilation de dix titres d'Alain Péters (on ne peut pas vraiment parler d'un album), Rest' la maloya, co-éditée avec Sofa Records. Avant cette dernière sortie, on ne trouvait plus aucun enregistrement d'Alain Péters, les éditions précédentes, cassette et CD, n'étant plus disponibles. Il ne s'agit bien sûr que de petits tirages, de petits cailloux jetés dans de petites mares, pas de quoi envahir les ondes radios ou faire exploser les vues sur youtube, mais qu'à cela ne tienne. Ne boudons pas notre plaisir d'avoir au moins eu la possibilité de découvrir cette musique hautement aimable, à la cadence chaloupée toute particulière et réputée injouable.
Dans ce paysage musical-là, cette petite mare, Alain Péters a une place tout à fait singulière. Souvent dans leurs œuvres, les artistes réunionnais ont fait montre d'un fort sentiment d'attachement à leur terre natale, qu'ils voient comme un Éden, paradis perdu dans les eaux, d'où une certaine nostalgie qui parfois point alors qu'ils ne sont pas forcément exilés : Mon île (Jacqueline Farreyrol), Mon île était le monde (titre d'un film documentaire de Jacques Baratier sur le poète Jean Albany), Pays Bourbon (Philippe Pauvrèze). Rien de tout ça chez Alain Péters. Le sentiment est peut-être là, sans doute, mais il ne sera jamais exprimé d'une telle façon. Sa poésie ne s'arrête pas aux apparences. Tout juste s'il regrette, dans sa chanson Caloubadia que le rhum n'ait plus le même goût qu'avant. Ce sera tout pour la nostalgie. Son paradis perdu est ailleurs que sur terre.
Dans les années 50 et 60, le maloya est fortement réprimé par des autorités qui voient en lui une menace de par sa résonnance avec le courant indépendantiste. Les musiciens sont surveillés de près et parfois le simple fait d'avoir en sa possession des instruments prohibés (les traditionnels kayamb et roulèr) peut vous conduire en prison. Mais le maloya vient du fond des âges, sa pratique est chevillé à l'ADN d'un peuple qui se veut libre, sans forcément vouloir aller jusqu'à obtenir l'indépendance. Ce n'est pas incompatible. Vouloir le réprimer, c'est vouloir réprimer le tonnerre, les forces telluriques qui font jaillir la lave brûlante du volcan. Sa pratique perdure donc de façon clandestine. C'est en plein milieu de cette période contradictoire du jeu du chat et de la souris que naît Alain Péters, en 1952. Dès ses treize ans, il joue de la guitare dans les orchestres de bal. Bien sûr, on ne joue que de la musique d'ambiance, pas de maloya si controversé, mais il y a fort à parier que cette musique de résistance, venue d'Afrique avec les esclaves et mélangée aux cultures indiennes, malgaches et européennes dans les plantations de canne à sucre a sonné à ses oreilles, et à un âge où ces choses comptent.
Avec les années 70, les avancées technologiques aidant (la cassette permet de copier et de diffuser plus facilement de la musique), le rock et les sons psychédéliques vont envahir le monde. C'est l'onde de choc post-Woodstock, l'écho de l'année 68. La Réunion n'y échappera pas. Les guitares électriques déferlent sur l'île. Alain Péters accueille facilement ces nouvelles sonorités. Il les intègre à son univers. Il joue tantôt de la guitare et tantôt de la basse avec les groupes Pop Decadence puis Satisfaction. Le nom de ces formations donne d'emblée le ton. Fini les orchestres de variété. On branche les guitares, on joue plus fort, utilisant tous les nouveaux effets possibles. Mais jouer comme Jimi Hendrix a aussi ses limites. Il faut aller de l'avant.
Le véritable bouleversement aura lieu en 1976 avec Caméléon, groupe formé par René Lacaille, Narmine et Élie Ducap, Jean-Claude Viadère, Loy Ehrlich et Alain Péters. Caméléon ressort le maloya des placards où on l'avait confiné et lui incorpore les nouvelles sonorités venues des scènes anglo-saxonnes. Synthèse parfaite qui voit se mêler les instruments traditionnels aux guitares et basses électriques les plus modernes. Le maloya se teinte de rock. Les genres fusionnent.
M. André Chan-Kam-Shu est le propriétaire du cinéma Royal à Saint-Joseph, au sud de l'île. Il aménage au sous-sol un studio d'enregistrement. C'est là que vont se retrouver tous les jeunes musiciens du coin influencés par les Stones et autres Jimi Hendrix aussi bien que par Brassens, forts de leur expérience des bals et mis au chômage de force par l'invasion massive des sonos. Aux membres de Caméléon s'ajoutent Bernard Brancard, Hervé Imare, Joël Gonthier.
Une bande se forme. Il va alors se passer quelque chose de magique, un moment de grâce créatrice comme on en rencontre parfois : à New-York par exemple, au Chelsea Hotel où se côtoient Lou Reed, Patti Smith, Allen Ginsberg et Bob Dylan, ou un peu plus tard au CBGB, au tout début du mouvement punk, avec Blondie, Television, les Ramones. Bouillonnement explosif. Chacun arrive avec ses propres bagages, rejoint un tout, et le tout devient plus grand que la simple addition des parties qui le composent. Il réagit. Tout le monde est poussé en avant, plus loin, plus haut, comme galvanisé. Il y a communion, fusion. Alors on se met à faire des disques à tout va, et Caméléon est le groupe de studio attitré, qu'ils accompagnent d'autres chanteurs ou qu'ils enregistrent pour leur propre compte.
En ces lieux de mixité et d'échange va avoir lieu une rencontre décisive avec le poète Jean Albany. Entre 1937, date de son départ de la Réunion, et 1984, date de sa mort, Jean Albany vit principalement en métropole. Il y fait d'abord ses études (licence de droit, Science Po et chirurgie dentaire) avant d'être mobilisé lors de la seconde guerre mondiale. Mais sa terre natale lui manque. Pour y pallier, il développe le concept de créolie, façon de garder vives en lui ses racines. Le mot qu'il invente est significatif. Il ne s'agit ni de créolité, qui serait une manière de revendiquer une sorte d'identité, avec ce que cela comporte de farouche et d'indépendantiste, ni de créolitude, qui ne serait qu'attitude superficielle, posture, mais bien de créolie, une manière d'être créole qui s'inscrirait pour elle dans le monde, sans l'exclure, et sans s'en détourner. Noble idée qui recouvre une conscience collective propre à maintenir la solidarité réunionnaise malgré la diaspora. Cela passe tout d'abord par l'utilisation de la langue créole, ce que Jean Albany mettra en pratique dès son premier recueil de nouvelles, Zamal, publié en 1951.
C'est lors de l'une de ses nombreuses visites dans le sud de l'île, alors qu'il vient de faire part à son ami Alain Vidot de son désir de mettre de la musique sur ses poèmes, qu'Alain Gili (écrivain) et Alain Séraphine (artiste plasticien) le conduisent au Royal pour lui présenter les musiciens.
Alain Péters avait alors déjà commencé à écrire des chansons en français, mais le déclic se produit avec cette rencontre. L'aval de Jean Albany le libère et lui permet d'oser écrire en créole. Il joue maintenant de la basse au sein du groupe Caméléon et en est l'un des piliers. Sa position est mieux définie. Il n'ose toutefois pas encore prendre le micro et c'est Hervé Imare que l'on entend sur La Rosée si feuilles songes, premier 45 tours du groupe en 1977. La face B est une composition de Loy Ehrlich, Na voir demain, avec toujours Hervé Imare au chant. Le disque est sous-titré Le Séga. Comme quoi la frontière est mouvante entre séga et maloya, même pour les principaux intéressés qui usent aussi facilement d'une appellation ou de l'autre. Preuve que la distinction n'est pas d'une si grande importance. Il y a dans La Rosée si feuilles songes déjà toute la grâce d'Alain Péters, qui dépasse d'une tête le reste de la production réunionnaise de l'époque : il convoque ici le cyclone et la mémoire d'Ulysse, se tenant loin de l'image d'Épinal de l'île ensoleillée et des palmiers sur la plage, loin de la variété. Cette chanson est représentative de la fusion rock/maloya : sans écraser le reste, la guitare électrique est très présente, en particulier à la fin du morceau, lors d'un long passage instrumental, elle se coule en douceur au reste de l'orchestration, sans s'imposer. Les arrangements sont justes, précis.
La collaboration des musiciens et du poète se poursuit l'année suivante, en 1978, avec la parution de la cassette Chante Albany, aux éditions Diffusion Royale. Sur les dix-sept pistes que contient cette cassette, dix sont des textes mis en musique et chantés par Hervé Imare, Jean-Michel Salmaris, Pierre Vidot ou Alain Péters. Un an plus tard, ce dernier s'est tout de même décidé à donner de la voix. Les sept autres pistes sont des textes lus par Jean Albany, mais je ne sais pas s'il y a un accompagnement musical ou non, n'ayant malheureusement jamais réussi à mettre la main sur cette cassette, ni sur la réédition CD qui a suivi.
Le phénomène à l'œuvre avec cette cassette n'a rien de nouveau, mais il est toutefois assez emblématique pour mériter qu'on s'y arrête un moment. Il s'agit de la mise en musique d'un poème. Prenons comme point de départ un texte écrit sur un support physique, livre, cahier, feuille volante ou tablette, peu importe, pensé pour un lecteur à la fois, deux ou trois à la limite mais on va dans ce cas vite se heurter à des limites concrètes : vitesse de lecture, texte murmuré ou suivi du doigt, ce qui peut entraver la concentration, donc la compréhension. Ce texte renvoie toujours le lecteur à lui-même. Sa diffusion, même massive, empêche une adhésion de masse. Il fonctionne toujours au cas par cas. La lecture à voix haute permet, elle cette adhésion immédiate et plurielle. C'est d'ailleurs ce qui prime en poésie, si l'on en revient à sa forme originale : elle est parole avant d'être écrit. En récitant le texte à voix haute, on touche simultanément un auditoire plus large : une classe, une salle et, si on ajoute un micro, un ampli et des enceintes, un stade tout entier. Le poème recouvre alors sa dimension incantatoire, sa fonction magique originelle. Avec les moyens de diffusion modernes (enregistrement numérique et mise en ligne instantanée), on peut en un seul coup potentiellement toucher le monde entier. Potentiellement seulement.
En vérité, une voix nue récitant dans le silence est peu diffusée, car peu écoutée. Il faudrait vraiment beaucoup de charisme à l'orateur, beaucoup de technique aussi et un sujet brûlant. Et même si toutes ces conditions sont réunies, la portée du discours restera confidentielle à l'échelle du monde. Avec de la musique c'est autre chose. La musique habille le texte et l'emporte plus loin qu'aucun orateur ne pourra jamais le faire. Elle donne au texte une portée magique. C'est sans doute cette particularité-là qu'avait en tête Jean Albany quand il a commencé à penser à mettre de la musique sur ses poèmes. Comme tout poète, il sait que la musique rend aux mots leur dimension sacrée. C'est l'enfance de l'Art poétique : « De la musique avant toute chose ». Pour réussir, elle doit puiser à l'intérieur du texte les ressources rythmiques inhérentes à sa forme pour élargir l'audience au maximum.
Contrairement au roman, dont les contours et le corps même sont sans cesse en mouvement, ce qui empêche la fixation dans la mémoire (on peut retenir quelques passages, quelques phrases éparses, mais le reste est noyé dans un ensemble mouvant où chaque mot efface le précédent), le poème, dans sa forme première (avant l'imprimerie, peut-être même avant l'écriture) est fait pour être mémorisé, récité et transmis. Il doit l'être. C'est sa seule possibilité d'exister dans le temps. Il dispose pour cela d'atouts évidents : musicalité interne, rythme propre, rime (un vers appelant automatiquement le suivant). Ce qui fait que n'importe qui, avec plus ou moins de facilité cependant, peut apprendre un poème par cœur, c'est-à-dire le faire sien. C'est plus compliqué avec un roman.
En transformant les poèmes de Jean Albany en chansons, car c'est bien de cela dont il est question, Alain Péters va leur donner une portée universelle. La musique ne fonctionne alors plus seulement comme un accompagnement, ce qui serait le cas d'une bande originale de film par exemple, mais elle épouse le texte pour ne plus faire qu'un avec lui. Le phénomène fonctionne aussi dans l'autre sens. La musique emporte le texte au-delà de ses propres limites mais elle obtient autre chose en retour : de la légitimité. Le poème justifie la chanson. C'est une interaction gagnant-gagnant, un mariage de raison, un cercle vertueux. Si la fusion réussit, le poème et la musique deviennent un tout uni, une chanson.
La musique offre à un poème la possibilité d'être hissé hors d'un contexte scolaire, écrit, fermé, et de prendre un nouvel essor, sans classement, sans pedigree. Le texte est dépouillé de son contexte, comme décharné avant d'être reconstruit, recouvert et doté d'un supplément d'âme. Elle permet aussi d'élargir son public : sans Alain Péters et tous les musiciens du Royal, l'œuvre de Jean Albany serait restée encore plus confidentielle qu'elle ne l'est.
Par ailleurs, aucun chanteur n'est jamais tenu de mettre un poème en musique. Cette pratique est de l'ordre du choix, elle est donc révélatrice d'une esthétique personnelle. En cela, elle en dit tout aussi long sur l'intime et la personnalité du chanteur que s'il avait lui-même écrit ses paroles. Puisque l'exercice relève d'une démarche spécifique, volontaire, et non contrainte, courante mais pas non plus prépondérante, d'un véritable choix donc, il faut y prêter la plus grande attention.
Ainsi Alain Péters a décidé, sur les vingt-deux chansons qu'il a enregistrées, d'adapter et de conserver quatre textes de Jean Albany, ce qui représente près de 20% de son œuvre personnelle. Le pourcentage augmente si l'on considère que sur ces vingt-deux morceaux, deux sont des instrumentaux (Maya et Complainte pour mon défunt papa), pas vraiment des chansons donc. Quatre chansons sur vingt. Les 20% sont atteints. Ce n'est tout de même pas rien.
Ces quatre chansons sont Plime la misère, La Pêche Bernica, Mon joli, mon joli marmaille et Bébett'coco. Elles ne détonnent pas dans l'ensemble de l'œuvre, au contraire, elles s'intègrent à merveille, aussi bien, voire mieux que s'il les avait écrites lui-même. Elles font donc partie du patrimoine musical dont la Réunion peut s'enorgueillir. Depuis 2009, le maloya est classé au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco. La créolie de Jean Albany, Alain Péters l'a faite sienne. Chez lui, pas de nostalgie mal placée pour une sorte de paradis perdu mais une poésie pure, loin de la variété, une profondeur sans esbroufe dans les paroles aussi bien que dans le chant et les orchestrations. Dans ses attitudes comme dans ses choix, on sent qu'Alain Péters a maîtrisé son œuvre de bout en bout, malgré les apparences d'une vie décousue. D'une chanson à l'autre reviennent les mêmes rêveries, comme ce goût immodéré de la vavangue, c'est-à-dire de l'errance, mais une errance positive, l'inverse de la perdition, une manière d'être et de laisser le monde arriver jusqu'à soi, une ouverture des sens et de l'esprit. À son tour on pourrait le fondre dans un ensemble plus vaste encore.









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Colaborar
Colaborar


















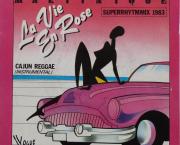


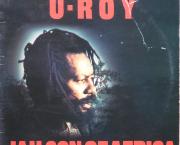



























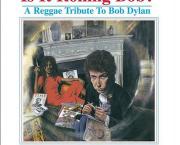










 Puedes apoyar a tus escritores favoritos
Puedes apoyar a tus escritores favoritos





